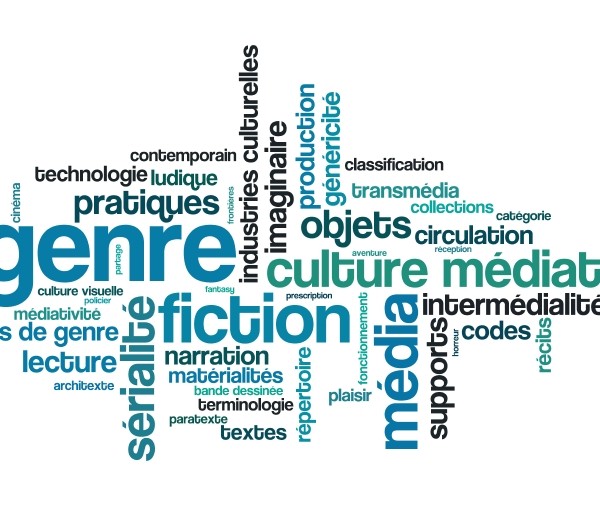Détails
17 novembre 2015
Présentation
Cette journée d’études doctorales est organisée par Aurélie Huz et Nicolas Perez-Prada, avec le soutien de l’équipe EHIC et de l’ED 525, avec la participation de Matthieu Letourneux (Université de Paris-Nanterre).
Genres et médias : la convergence des problématiques liées à ces deux objets de recherche se manifeste d’emblée par le jeu des dénominations utilisées pour évoquer certains objets de notre culture de masse contemporaine. Ainsi « paralittérature », « littérature médiatique », fictions « industrielles » et « sérielles » sont aussi désignées comme « fictions de genre » – qu’il s’agisse du roman policier, de la science-fiction, de la fantasy, du roman sentimental, de l’horreur, etc. Dans cette expression se cristallise et se révèle une affinité étroite entre la question de la généricité́ et le caractère médiatique (c’est-à-dire souvent intermédiatique) des fictions de grande consommation.
Le projet de cette journée d’étude est d’interroger cette conjugaison entre pratiques génériques et pratiques médiatiques dans le régime contemporain de la fiction, afin d’ouvrir de nouvelles perspectives à la compréhension des modes de production, de circulation et d’appropriation des objets culturels. Pour ce faire, on souhaite s’inscrire dans le prolongement et au croisement de deux perspectives de recherche très productives depuis une trentaine d’années. D’une part, le renouvellement et le perfectionnement des outils de saisie des genres par les études littéraires depuis les années 1980 (esthétique de la réception et phénoménologie de la lecture, approches pragmatiques du genre, « savoir » et « compétences » générique. D’autre part, le développement massif des études médiatiques et la revalorisation de l’attention portée aux supports comme matrices technologiques, sémiotiques et socio-économiques de notre culture.
Les enjeux de ce questionnement appellent deux remarques. Premièrement, face au constat selon lequel la question générique serait devenue incongrue dans l’univers théorique et esthétique contemporain (Macé, 2004), on note sa persistance (et peut-être sa transformation) massive dans certains secteurs de la production fictionnelle contemporaine – par exemple dans les fictions de l’imaginaire : notre culture médiatique est une culture de genres. Deuxièmement, ces terminologies génériques, à la forte visibilité dans l’espace culturel, dépassent largement le cadre de la littérature et sont généralement partagées par plusieurs supports ; la circulation transmédiatique des récits et des univers de fiction assure de fait une communauté culturelle et la reconnaissance du genre par-delà les frontières médiatiques (cinéma, littérature, jeux vidéo, bande dessinée, etc.).
Plusieurs pistes s’ouvrent alors à la réflexion croisée entre genres et médias, déployant la diversité des usages génériques et attestant la prégnance de cette catégorie dans notre rapport à un certain type de fiction.
On pourra étudier comment le genre des « fictions de genre » s’incarne dans une véritable culture matérielle. Le jeu du paratexte, les collections éditoriales avec leurs formats et leurs codes graphiques, les illustrations de couverture, les jaquettes, les affiches publicitaires et tout l’arsenal d’une culture visuelle partagée sont autant d’éléments qui sollicitent et construisent des « imaginaires génériques» très riches. En cela, ils modèlent la fiction dans sa matérialité même et constituent des outils de classification et de prescription pour la promotion des produits par les industries culturelles. On peut également s’intéresser à la variabilité de ces assignations génériques, pour des raisons liées au marketing (stratégie de placement de produit, public-cible visé) ou du fait d’évolutions historiques : la canonisation des « classiques du genre » (l’œuvre de Philip K. Dick pour la science-fiction par exemple) s’accompagne ainsi souvent d’un glissement générique hors des collections spécialisées et d’une « entrée » en littérature générale.
Au-delà de cette dimension matérielle du genre, comment écrit-on ou lit-on « dans le genre » (Letourneux, 2010) ? Comme catégorie architextuelle, le genre est un principe de régulation de l’acte de lecture, un horizon d’attente et une compétence acquise par l’expérience collective (dimension mémorielle et collective de certains genres devenus de véritables cultures partagées) et individuelle (apprentissage d’un devenir-lecteur). On pourra ainsi s’intéresser à la manière dont certaines œuvres jouent avec les « codes du genre » (quel qu’il soit), recyclent ou déplacent un répertoire générique (formel, thématique, narratif) constitué au fil du temps et, ce faisant, révèlent le rapport spécifique que les fictions médiatiques entretiennent avec leur genre. En effet, face au constat d’un découplage progressif entre généricité́ et littérarité́ au cours du xxe siècle (Macé, 2004) – les récits « légitimés » rompant avec le les classifications génériques – il semble qu’on puisse et qu’on doive interroger l’idée d’une généricité propre aux productions culturelles médiatiques dans leur ensemble. De fait, les œuvres « de genre » ne fondent pas leur valeur en conflit ou en rupture avec la généricité (l’originalité comme légitimité), mais à l’intérieur du système générique lui-même (Letourneux, 2010).
Cependant, n’existe-t-il pas des spécificités génériques selon les médias ? Chaque support possède une « médiativité » (Gaudreault et Groensteen, 1998), c’est-à-dire un potentiel expressif propre, ce qui impose de penser des fonctionnements génériques différenciés. Le genre n’aurait alors ni les mêmes mécaniques ni les mêmes enjeux en littérature, au cinéma, ou en bande dessinée. On pourra étudier la structuration du système générique d’un média précis : ainsi, la profusion terminologique servant à désigner les types de jeux vidéo (action-RPG, tactical-RPG, survival horror, Doom-like, pour ne citer que quelques exemples qui montrent d’ailleurs la prévalence de l’anglais dans la constitution des catégories) témoigne d’une généricité extrêmement active, productive et proliférante qui tranche avec les pratiques génériques en littérature ou au cinéma – ce qui peut être mis au compte du caractère récent de ce nouveau support, mais qui relèverait aussi de la position intermédiaire du média entre fictions ludiques et fictions narratives. Mais on pourra aussi comparer, à travers des supports différents, les processus génériques regroupés sous un même nom : si l’on parle bien de romans, de films ou de jeux vidéo d’horreur, cette appellation générique prend-elle la même valeur dans les trois cas ? Recouvre-t-elle les mêmes réalités ?
Ces propositions ouvrent enfin à la prise en compte de « l’effet-genre » qui est au cœur des dispositifs textuels et des processus lecturaux des récits de grande consommation. Car le rapport émotionnel que nous entretenons avec ces fictions relève largement d’un « plaisir du genre » (Genette) qui réside dans la dialectique de l’attente et du comblement, de la variation dans la répétition. Ouvrir une bande dessinée historique, c’est non seulement avoir au préalable un certain nombre d’attentes par rapport à ce type de fiction, mais jouir, au cours de la lecture, des stéréotypes et/ou des écarts par rapport aux représentations que l’on se fait du genre ; c’est être sensible à la manière dont l’œuvre convoque le genre, l’actualise, s’y inscrit ou en déplace les attendus, etc. Des études de cas pourraient ainsi montrer comment ce travail du genre, et notamment sa dimension plaisante et ludique, orienterait plus fortement la réception dans les genres « contraints » de la culture industrielle que dans les récits de la culture « légitime » (Baroni et Macé, 2007).
Ces pistes ne sont bien sûr pas exhaustives et invitent à envisager dans toute leur diversité les relations croisées entre les fonctionnements médiatiques de notre culture et la diffusion très large de « fictions sans frontières » (Gaudreault et Groensteen, 1998) fondées sur une généricité massive.
> Consultez l’appel à communication
> Consultez le programme