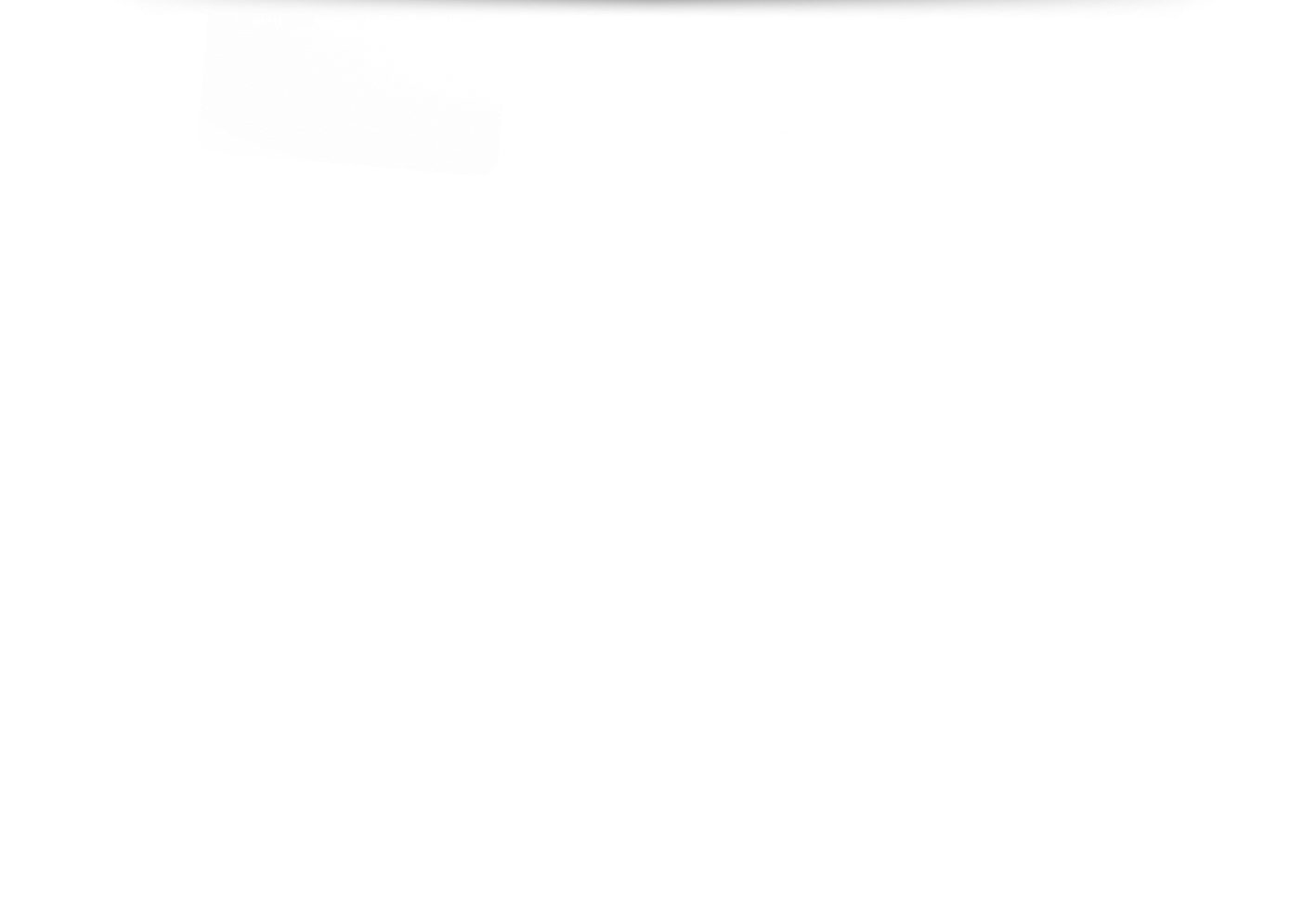Thèse soutenue de Freddy GNANGNON
Epidémiologie du cancer du sein au Benin et en Afrique Sub-Saharienne
Contexte : l’incidence du cancer du sein en Afrique subsaharienne, bien qu’en nette augmentation, est l’une des plus faibles en comparaison aux autres régions du monde. Cependant, les taux de mortalité y sont parmi les plus élevés reflétant un pronostic particulièrement péjoratif. Le diagnostic à un stade tardif expliquerait en partie cette léthalité. Pourtant, les données sur le stade au diagnostic, l’accès au traitement et la survie des patients atteint de cancer du sein en population générale en Afrique subsaharienne sont rares. Le Bénin, pays de l’Afrique de l’Ouest ne fait pas exception.Outre la détection tardive liée au manque de programmes dédiés de dépistage dans la plupart de ces pays, la forte mortalité relative du cancer du sein en Afrique subsaharienne peut être attribuée à un accès limité aux thérapies systémiques (chimiothérapie, thérapie ciblées, Immunothérapie), à la radiothérapie et aux soins chirurgicaux de qualité. Par conséquent, réduire le stade du cancer du sein au moment du diagnostic et améliorer l’accès à des soins de qualité pourraient être essentiels pour améliorer la survie des femmes atteintes du cancer du sein en Afrique au Sud du Sahara. La plupart des pays d’Afrique subsaharienne étant à faible revenu, les ressources sont limitées et par conséquent, des choix raisonnés s’imposent.Le but ultime de notre travail est de contribuer à la réduction de la mortalité liée au cancer du sein en Afrique au Sud du Sahara par la proposition de stratégies optimales et adaptées.
Objectifs spécifiques : (i) contribuer à l’estimation de la mortalité liée au cancer du sein en Afrique subsaharienne, (ii) identifier les principaux facteurs pronostiques du cancer du sein en Afrique subsaharienne, (iii) évaluer l’accès aux traitement loco-régionaux et systémiques, (iv) estimer le gain de survie qui résulterait de l’implémentation de différentes stratégies de détection précoce en association ou non à des stratégies visant à l’amélioration de l’accès aux soins, (v) faire une évaluation économique des différentes stratégies.
Méthodes et retombées attendues : Il s’agira, dans un premier temps, d’effectuer une revue systématique et une méta-analyse en vue préciser la mortalité et les facteurs pronostiques des cancers du sein sur le continent Africain. Les principales base documentaires (MEDLINE, Embase, Web of Science, Google Scholar ) seront consultées pour identifier les sources pertinentes. Ce travail préliminaire contribuera à pallier le manque d’information sur le sujet dans la littérature africaine sub-saharienne. Il s’agira, ensuite, d’évaluer le stade au diagnostic, l’accès au traitement et pronostic des cancers du sein en population générale au Bénin.
Finalement, il sera possible d’évaluer l’impact de stratégies de détection précoce et d’accès au traitement sur la réduction de la mortalité liée au cancer du sein au Bénin et en Afrique Subsaharienne en général. Nous adapterons des modèles de microsimulation pour projeter les résultats de deux stratégies de détection précoce seules ou en combinaison avec cinq programmes d’accès au traitement. Une évaluation économique des différentes stratégies sera réalisée.
——————————————————————————————————————————————– Mots clés :Cancer du sein, Mortalité, Afrique subsaharienne, Prévention, Stratégies
[Janvier 2020 – Septembre 2024]
——————————————————————

Freddy GNANGNON
Doctorant freddy.gnangnon@unilim.fr
——————————————————————
Sous la direction de :
Pierre-Marie PREUX
Directeur de la thèse PU-PH – U1094
——————————————————————
 Articles –
Articles –  Colloques –
Colloques – Posters
Posters
——————————————————————
En co-tutelle avec

——————————————————————
 Parallèlement, le doctorant participe à une étude sur les prédispositions génétiques au cancer du sein dans la population béninoise. Ce projet vise à identifier les mutations génétiques délétères, constitutionnelles et acquises, responsables de certains cancers du sein au Bénin. Ce Projet rentre dans le cadre de la diversification des axes de recherche de l’ UMR 1094 Inserm.
Parallèlement, le doctorant participe à une étude sur les prédispositions génétiques au cancer du sein dans la population béninoise. Ce projet vise à identifier les mutations génétiques délétères, constitutionnelles et acquises, responsables de certains cancers du sein au Bénin. Ce Projet rentre dans le cadre de la diversification des axes de recherche de l’ UMR 1094 Inserm.