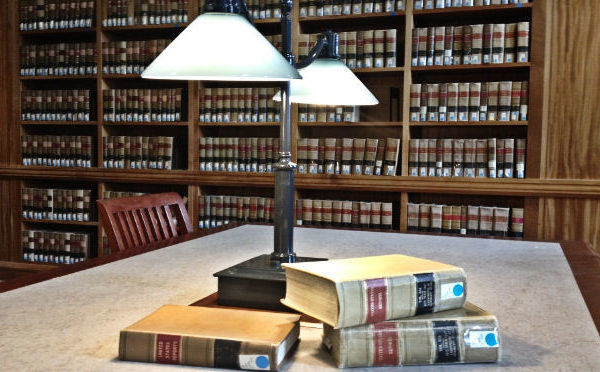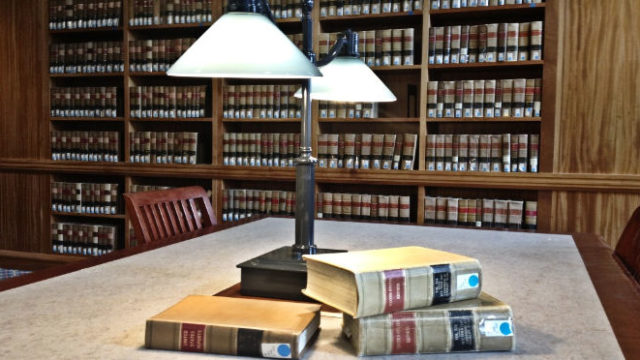
NOTES DE LECTURE : Procédures judiciaires et vérité
Procédures judiciaires et vérité
Notes de lectures à propos de Berti (Daniela) et Tarabout (Gilles), « La vérité en question. Idéal de justice et technique judiciaire en Inde », in Ben Hounet (Yazid) et Puccio-Den (Deborah) dir., « Autour du Crime », Cahiers d’Anthropologie sociale, n° 13, Paris, éd. de l’Herme, 2016, p. 117-133.
Pascal Texier,
Université de Limoges
OMIJ (IAJ)
IiRCO
Les Cahiers d’anthropologie sociale rendent compte des travaux réalisés dans le cadre du laboratoire du Collège de France dirigé par Philippe Descola. Le numéro 13, paru en 2016 sous l’intitulé « Autour du crime »[1], est entièrement consacré à une thématique jusqu’ici peu traitée par l’anthropologie classique. En abordant les questions de l’intentionnalité, de la vérité et de la preuve, les huit contributions témoignent à l’évidence de ce que peut apporter l’approche anthropologique du phénomène criminel. Le travail proposé par Daniel Berty et Gilles Tarabout[2] est particulièrement suggestif sur bien des points. En premier lieu, il interroge la question de la vérité, si souvent présentée comme constituant le fondement et le but de toute activité judiciaire. En second lieu, il examine comment la forme procédurale conditionne directement la capacité de la justice à produire une « vérité » qui n’est pas toujours conforme à la réalité des faits ni même aux exigences du droit. S’agissant des champs d’études de l’IiRCO, on soulignera tout l’intérêt de faire porter l’analyse sur la procédure accusatoire dont on sait le rôle, tant en matière de justice pénale internationale que de processus transitionnels. Enfin, le double choix d’une approche anthropologique et d’un contexte culturel complexe comme peut l’être celui de l’Inde s’avère particulièrement stimulant. Le décryptage et la compréhension des mécanismes à l’œuvre dans le processus judiciaire montrent bien comment la recherche d’une plus grande efficacité des mécanismes de gestion de conflit implique qu’on ne se limite pas aux seules voies offertes par le droit. La conjugaison des analyses juridiques et ethnographiques témoigne des jeux subtils qu’entretiennent processus juridiques et corps social, chacun construisant sa propre vision des faits et poursuivant des buts différents. Le juge doit alors se livrer à un travail de conciliation entre univers culturels et normatifs parfois bien différents, exercice auquel le juge de Common Law et sans doute plus habitué que celui de Civil Law.
Pour illustrer leur propos, les auteurs s’appuient sur la pratique des juridictions indiennes, cours supérieures comme tribunaux de premier degré. Ils remarquent que les contours et la fonction du concept de vérité peuvent y recevoir des acceptions bien différentes.
Les cours supérieures tiennent parfois des discours idéalistes, mêlant les approches philosophiques, morales, religieuses, culturelles ou légales en s’appuyant sur des corpus éclectiques, associant textes sanskrits anciens, penseurs et écrivains indiens ou occidentaux contemporains. De telles considérations peuvent paraître bien éloignées de l’approche pragmatique des juges du fond, mais le fait même qu’elle soit incluse dans des arrêts émanant de cours supérieures leur confère une autorité auxquelles les juges de premier degré ne sauraient se soustraire. Pour les juridictions inférieures, la situation est particulièrement complexe, puisque face aux injonctions éthiques des cours suprêmes, il leur faut compter avec des témoins qui se récusent, au point que dans certains cas, il leur devient difficile de rendre un verdict de condamnation, alors même que les juges sont persuadés de la culpabilité de l’accusé. Comment, dans ce cas peuvent-ils échapper aux foudres des juridictions supérieures qui n’hésitent pas à stigmatiser ceux qui, renonçant à chercher activement la vérité, se contentent d’être « des spectateurs silencieux ».
Les auteurs décrivent avec minutie le traitement d’une affaire criminelle devant une juridiction indienne de premier degré. La procédure y est de type accusatoire, c’est-à-dire selon la formulation de John H. Langbein, mettant en œuvre une logique de « combat » à l’inverse de la procédure inquisitoire, fondée sur une logique de la « vérité »[3]. Autrement dit, les caractères spécifiques de l’adversary criminal trial, conduisent plus à chercher à vaincre l’adversaire qu’à établir la vérité. De là toute l’importance que revêtent les stratégies développées par l’ensemble des parties à l’instance : magistrats (juges et procureurs), avocats, et témoins. C’est dans ce cadre qu’il convient d’analyser les revirements de témoins qui refusent de confirmer à l’audience les déclarations antérieurement faites à la police. Selon les auteurs, il ne faut pas chercher dans les errances des témoins, ainsi que le faisait le discours colonial, un mépris notoire pour la vérité qui affecterait le peuple indien. Il convient plutôt d’y voir la conséquence de mécanismes sociaux et de valeurs jugées plus dirimants que le respect des lois étatiques. Face à ces attitudes contre-intuitives, pour qui se limite à une approche strictement juridique, le procureur est dans l’impossibilité de rassembler les éléments de preuve permettant de fonder un verdict de condamnation. Quant au juge, bien qu’il soit conscient de la réalité des faits, il est obligé de faire consigner dans la dactylographie de l’audience la version exprimée en cours d’instance, qui seule aura une valeur probante. Cependant, pour ne pas être qualifié de « spectateur silencieux », le juge peut essayer de peser sur la manière dont les débats sont transcrits.
Bien qu’orale, la procédure criminelle suivie en Inde fait un large usage de l’écrit ; c’est ainsi que les dires des témoins sont retranscrits, selon un schéma de questions-réponses permettant au rédacteur de mettre en évidence les points qui lui paraissent les plus importants. S’agissant d’un document jouissant d’une certaine performativité, sa rédaction doit être suffisamment technique[4] pour permettre des opérations de qualification juridique. Dans certains cas les dires des témoins devront faire l’objet non d’une simple transcription, mais d’une véritable traduction du sens commun vers le sens technique ou, comme dans la procédure analysée, d’une langue dans l’autre[5]. Chacune de ces opérations contribue à construire, voir infléchir, le récit judiciaire dans un sens qui peut ne pas être en exacte conformité avec celui qu’entendaient donner les parties auditionnées. Comme on le voit, le traitement procédural des faits peut générer un écart entre la vérité factuelle, telle qu’énoncée par les témoins, et la vérité judiciaire produite par la procédure. À cette première série de raisons techniques susceptibles de nourrir la pluralité des récits, s’en rajoutent d’autres qui se font l’écho de préoccupations davantage sociales que judiciaires.
En effet, toutes les auditions ne sont pas nécessairement retranscrites, comme, par exemple, celles réalisées à l’occasion de certaines phases de l’instance, qualifiées de « confidentielles ». Dans le cas étudié[6], les auteurs observent qu’avant de procéder à l’audition des témoins, le procureur interroge de manière « confidentielle » la présidente de l’assemblée communale du village — pradhan — qui, dans les fonctions électives qu’elle exerçait, jouissait d’un véritable ascendant sur les autres témoins. Interrogée sur le fait de savoir si la victime était effectivement maltraitée par le mari, elle revient sur ses précédentes déclarations en affirmant que non. Dès lors, le procureur comprend qu’il ne pourra plus compter sur son appui pour défendre l’accusation et que probablement les 10 autres témoins risquaient bien de tenir la même position en se transformant en hostile witnesses. Poussant plus avant les investigations, le juge demande alors si les suicides sont fréquents dans la communauté, mais la Pradhan lui répond que la victime ne s’est pas suicidée et donne des détails donnant à entendre que le cas serait accidentel. De ce dernier échange, on peut déduire qu’un récit alternatif a probablement été construit par le conseil de la défense que les autres témoins ont presque certainement accepté de suivre. En effet, des négociations conduites hors prétoire permettre de prendre en compte d’autres impératifs que ceux que le droit étatique accepte de prendre en compte. Pour la mère de la femme, victime des maltraitances de son mari, il peut apparaître plus opportun d’étayer la thèse de l’accident, en se désolidarisant de l’accusation. Que lui importe que la violation du droit ne soit pas sanctionnée si, en évitant que le gendre ne soit incarcéré de longues années, elle peut mettre ses petits enfants à l’abri de la misère en leur conservant un pères. En outre ce choix crée une sorte de dette du mari envers la famille de l’épouse, grâce à qui il a pu échapper aux foudres judiciaires. Comme on le voit, si le récit alternatif profite en premier lieu à la défense, il n’est pas dépourvu d’intérêt pour la parenté de la victime. Dès lors, quelle légitimité y aurait-il pour les autres témoins à soutenir une position que les parents repoussent.
La puissance qui est ici concédée au récit alternatif réside dans le fait qu’il ne cherche pas à régler les conséquences d’un fait passé, mais à gérer la situation future de ces « victimes » survivantes que sont les enfants : si la voix de la morte peut résonner avec force dans le prétoire, hors de celui-ci elle doit céder le pas à celle de sa progéniture. C’est donc en fonction d’une analyse ex post que les faits sont réinterprétés et transformés de suicide en accident. Si le récit alternatif se distingue du récit judiciaire par un rapport au temps différent, il s’en écarte également en ce qu’il se contente de standards moins élevés que ceux que requiert la justice, c’est ainsi que la vérité doit céder le pas à la plausibilité. Toutefois, pour que le récit alternatif puisse contribuer efficacement à la gestion du conflit, il doit passer par le filtre judiciaire et emprunter le même cheminement, cohérent et logique, car le système procédural ne se nourrit pas d’affirmation, mais de démonstration.
Comme on le voit, ces regards croisés portés sur la construction du vere dictum judiciaire conduisent à s’interroger sur la capacité du procès à établir la « vérité historique ». Ce qui a été observé, au niveau élémentaire d’une cour criminelle indienne de premier degré, peut-il être étendu à d’autres juridictions, notamment en matière de justice transitionnelle ou de justice pénale internationale, dont la capacité à établir la vérité historique a souvent été mise en avant, depuis Nuremberg[7] ? Si l’on en juge par les multiples difficultés que doivent affronter les procureurs, notamment pour obtenir des témoins à charge crédibles et constants, il est certainement très légitime de se poser la question. Par ailleurs, les mécanismes et logiques mis en œuvre dans la procédure accusatoire favorisent l’importation, au sein même, du prétoire des stratégies d’attaque/défense, portées par des parties agissant plus en tant qu’acteurs sociaux que comme protagonistes d’un débat juridique. Il en résulte une situation d’hybridation marquée, à la fois, par la soumission aux normes de la société locale et le respect formel des règles de la justice d’État[8] ; autrement dit, la vérité judiciaire se contente parfois d’enregistrer la vérité sociologique[9]. Toutefois, l’assimilation peut n’être pas totale et, dans cet espace contraint que lui offre le cadre procédural, le juge peut retrouver une certaine part de liberté en jouant, une fois encore, sur la transcription des débats ; entre autres formulations possibles, il peut faire préciser qu’avant d’être entendu, le témoin a été confronté à ses déclarations antérieures. Cette sorte de palimpseste peut éveiller la curiosité des cours supérieures et les inciter à confronter les dires. Pour qui sait lire la transcription des débats, il existe donc des éléments signalant la coexistence des deux récits et permettant la déconstruction de l’un par l’autre. Si le verdict peut difficilement dire la vérité historique, il peut du moins, par la manière dont il documente les débats, ouvrir la voie à sa découverte, par d’autres que les juges, par ceux dont c’est le savoir-faire et la fonction : les historiens.
[1] Ben Hounet (Yazid) et Puccio-Den (Deborah) dir., « Autour du Crime », Cahiers d’Anthropologie sociale, n° 13, Paris, éd. de l’Herme, 2016, 165 p.
[2] Berti (Daniela) et Tarabout (Gilles), « La vérité en question. Idéal de justice et technique judiciaire en Inde », in ibid., p. 117–133.
[3] Langbein (John H.), The Origins of Adversary Criminal Trial, Oxford 2003 (réimpr. 2010), p. 1–2.
[4] Les auteurs donnent, p. 125, un exemple particulièrement significatif. Le juge, cherchant à déterminer ce qu’auraient pu être les causes d’un éventuel suicide, demande à la mère si, à l’occasion du mariage de sa fille, elle « a donné ce que tout le monde donne selon la coutume : de la vaisselle, des affaires, etc. ? » La mère se contente de faire un signe affirmatif de la tête, que le juge fait transcrire de la manière suivante : « j’ai aussi donné suffisamment de dot sur la base de mon statut au moment du mariage de ma fille. ». On voit comment un mode d’expression non verbale, d’acquiescement générique, est transformé en une formulation technique de soumission aux règles coutumières.
[5] Les témoins s’expriment en hindi, tandis que la cour use de l’anglais.
[6] Il s’agit d’une affaire de morts suspectes par pendaison d’une femme vraisemblablement maltraitée par son mari, dans l’état de l’Himachal Pradesh. La mère de l’épouse fit enregistrer un First Information Report contenant une accusation, portée contre son gendre, qu’elle suspectait d’avoir harcelé sa fille en demandant des compléments de dot. Les audiences se sont déroulées d’octobre 2006 à juin 2007, le procureur convoquant 11 témoins, alors que la défense n’en produisit aucun.
[7] Selon la formule du procureur américain au procès de Nuremberg, Robert Kempner, les audiences du tribunal de Nuremberg auraient constitué « le plus grand séminaire historique jamais tenu dans l’histoire du monde » : cité par Hazan (Pierre), Juger la guerre, juger l’Histoire : Du bon usage des commissions Vérité et de la justice internationale, Paris, 2015.
[8] Ce processus a été particulièrement mis en lumière par Bilmes (J.), « Rules and Rhetoric: Negotiating the Social Order in a Thai Village », Journal of Anthropological Research, 31 (1), 1976, p. 44-57.
[9] Le concept de « vérité sociologique » a été dégagé par Just (P.), « Let the Evidence Fit the Crime: Evidence, Law, and “Sociological Truth” among the Dou Donggo », American Ethnologist, 13 (1), 1986, p. 43-61.
BP 23204
87032 Limoges - France
Tél. +33 (5) 05 55 14 91 00