
Les revues prédatrices : comment les reconnaître et s’en prémunir ?
Introduction : un peu d’actualité…

Ces derniers mois, l’association saugrenue entre un moyen de transport plutôt répandu, la trottinette, et un médicament utilisé communément en rhumatologie, mais dont l’utilisation problématique dans le traitement contre le SARS-CoV-2 a enflammé les débats sur les plateaux de télévision comme sur les réseaux sociaux, l’hydroxychloroquine, a permis de mettre sous le feu de l’actualité une autre maladie, s’attaquant non pas au corps humain mais à l’édition scientifique : le fléau des revues prédatrices.
En effet, pour prouver le caractère prédateur et le manque de sérieux d’une revue, de facétieux enseignants-chercheurs en sciences de la vie et de la santé ont frappé fort avec un amusant canular : sous les pseudonymes de Didier Lembrouille, Nemo Macron, Otter F. Hantome, Manis Javanica (nom du pangolin selon la nomenclature linéenne) ou Sylvano Trotinetta, ils ont produit une étude parfaitement fumeuse sur l’hydroxychoroquine comme moyen de prévenir les accidents de trottinette. Alors que cet article n’aurait jamais passé l’étape de l’évaluation par le comité de lecture d’une revue sérieuse, il s’est retrouvé (contre espèces sonnantes et trébuchantes) au sommaire de l’Asian Journal of Medicine and Health. Le TrottinetteGate était né, et le phénomène des revues prédatrices était porté à la connaissance du grand public.
Mais les revues prédatrices sont pour les chercheurs quelque chose de beaucoup moins amusant dans leur quotidien. En tant que publiants, ils doivent s’en protéger, et doivent disposer des outils nécessaires pour s’en prémunir. Le présent article leur donne quelques pistes.
Quelques rappels
Petit rappel sur le circuit de publication d’un article
Avant toute chose, il convient de se rappeler comment fonctionne normalement le circuit de publication dans une revue scientifique :
- L’auteur soumet son manuscrit (preprint) à la revue.
- Le comité de rédaction choisit les relecteurs / reviewers de l’article parmi les pairs de la communauté scientifique.
- Les relecteurs / reviewers relisent l’article à l’aune de divers critères de qualité scientifique (peer-reviewing).
- Après cette relecture, les relecteurs / reviewers acceptent ou refusent le manuscrit.
- Si le manuscrit est accepté, les releteurs / reviewers indiquent soit qu’il est accepté en l’état (c’est plutôt rare), soit qu’il est accepté moyennant certaines modifications, mineures ou majeures.
- Une navette entre l’auteur modifiant son article et les relecteurs / reviewers se met en place, jusqu’à une version qui met tout le monde d’accord : le manuscrit accepté éditeur / le postprint.
- Cette dernière version du manuscrit est envoyée à l’éditeur qui relit (pour les coquilles) et compose le texte : une fois ce travail achevé, il envoie les épreuve à l’auteur pour validation. Une fois les dernières corrections de forme faites par l’auteur, celui-ci donne sa validation, son bon à tirer (B.A.T.).
- L’article est enfin publié dans sa version éditeur (reprint), mis en ligne en version numérique et/ou publié au numéro en version papier.
Le contexte de l’émergence de l’open access
L’avènement de l’open access constitue un bouleversement majeur pour l’édition scientifique, jusqu’ici inscrite dans un système de lecteur-payeur, et de publications scientifiques accessibles grâce à des abonnements souscrits par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
On rappelle qu’il existe trois voies de l’open access :
- Les revues qui suivent la voie dorée sont nativement en accès libre sur le site de l’éditeur, moyennant finances : l’auteur-payeur paie l’éditeur des frais de publication (en anglais article processing charges ou APC) pour rendre librement et gratuitement accessibles ses articles dès leur parution.
- Les revues qui suivent la voie de platine combinent un accès libre et gratuit aux revues pour leurs services de base, tant pour les auteurs que les lecteurs, et un accès payant pour les lecteurs dans le cadre de services premium supplémentaires (génération de pdf, epub, etc.).
- Dans le cas de la voie verte, l’auteur dépose le manuscrit de son article (preprint et/ou postprint) sur une archive ouverte (HAL par exemple), afin de rendre cette version de sa publication librement et gratuitement accessible.
Les pièges de la « voie dorée »

La voie dorée est en train d’être choisie par de nombreuses revues scientifiques qui suivaient jusqu’ici un modèle économique « classique » de « lecteur-payeur » et d’accès sur abonnement.
Or, certaines officines peu scrupuleuses vont essayer de faire du nouveau modèle « auteur-payeur » caractéristique de la voie dorée une rente de situation.
Ces officines douteuses ne chercheront absolument pas à promouvoir, valoriser ou pérenniser les résultats de la recherche. Leur but est uniquement le profit économique, le leur, sans aucune dimension scientifique.
Comment reconnaître une revue prédatrice ?
Une revue prédatrice ne se présente pas forcément sous des traits patibulaires, en tout cas repérables au premier abord !…
D’ailleurs, des centaines de revues prédatrices sont passées à travers les mailles du filet pour se retrouver indexées dans la très sérieuse base base de données Scopus, selon un article publié dans la revue Nature en février 2021.
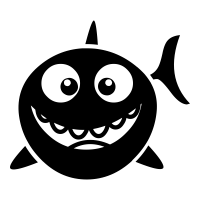
Les principales caractéristiques d’une revue prédatrice
Plusieurs éléments permettent de caractériser une revue prédatrice :
- Ce sont des revues au contenu pseudo-scientifique faisant très peu (en vrai : pas du tout) cas des questions de qualité et d’intégrité scientifique.
- Leur fonctionnement est opaque.
- Elles ne répondent pas aux recommandations éditoriales, notamment :
- celles du Committee on Publication Ethics (COPE) ;
- en sciences de la santé, celles de l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).
- Les délais de publication sont très – beaucoup trop ! – courts.
- Le contrôle des contenus publiés est très superficiel voire nul.
- Il est possible d’y rencontrer des articles plagiés, ou s’appuyant sur des résultats truqués.
Les conséquences pour les chercheurs qui publient dedans…
Si par malheur, en tant que chercheur, vous avez publié dans une revue qui se trouve être prédatrice :
- Votre réputation risque d’en prendre un coup…
- Vous risquez de devoir rétracter votre article.
- Votre article ne sera pas pris en compte dans vos évaluations ou celles de votre laboratoire.
Bref, voilà des conséquences pour le moins fâcheuses…
Divers outils pour éviter de se faire piéger
Pour déterminer si la revue à laquelle vous souhaiteriez, en tant que chercheur, soumettre un article est sérieuse ou douteuse, il existe divers signaux qui sont autant de feux verts et de feux rouges.
Les signaux d’alerte

- Vous recevez directement une invitation à publier su votre boîte mail (l’invitation atterrit parfois directement dans le dossier des spams). D’ailleurs, l’adresse mail de contact est non-professionnelle.
- L’origine géographique de la revue n’est pas cohérente avec son nom.
- On vous promet des délais de peer-reviewing et/ou de publication extrêmement rapides.
- Cette revue a presque le même nom qu’une autre revue plus ancienne.
- Il est très difficile d’identifier le comité éditorial de la revue.
- Après une petite enquête, vous vous rendez-compte que le comité éditorial est le même pour plusieurs revues.
- Le manque de transparence est patent :
- sur le peer-reviewing ;
- sur les APC.
- Les APC sont dérisoires.
- La revue se prétend open access… mais demande des frais d’accès ou pratique un embargo sur la diffusion de ses contenus.
- Le site de la revue est truffé de fautes d’orthographe ou de grammaire.
- La revue donne un facteur d’impact ou un h-index faux.
- La revue n’a pas de politique de rétractation.
Ce qui doit rassurer
- La revue est référencée dans le DOAJ et/ou le QOAM.
- La revue est membre de l’Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) et/ou du COPE (cf. supra).
- La revue suit explicitement les ICMJE (cf. supra).
D’autres outils de défense : les bases et listes noires
La liste de Beall

Devant l’inflation des revues prédatrices et les problèmes des chercheurs pris au piège, des parades se sont progressivement mises en place.
L’une des premières parades fut sans doute la liste de Beall. Jeffrey Beall, bibliothécaire de l’Université du Colorado, l’a mise en place à partir de 2008 et la tenait à jour sur son blog Scholarly Open Access. Sa liste pointait les revues qui ne faisaient pas de peer-reviewing, faisant du critère pécuniaire le seul critère d’acceptation.
Son travail extrêmement utile, d’une notoriété croissante chez les chercheurs comme chez les bibliothécaires à leur service, connut un brusque coup d’arrêt à la fin des années 2010 : certains éditeurs de revues sur la « liste de Beall » ont en effet menacé le bibliothécaire américain de procès en diffamation, et ont porté plainte auprès de l’Université du Colorado. Beall, objet de pressions et de menaces (y compris de sanctions de son université), se voit donc contraint de supprimer sa liste début 2017.
Depuis, la liste (qui n’est plus alimentée), a été archivée et publiée dans son état de fin 2016 de manière anonyme.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Après la liste de Beall
D’autres ont repris le flambeau de Jeffrey Beall dans la chasse aux revues prédatrice et aux officines qui les éditent :
- Compass to publish, porté par l’Université de Liège.
- Le projet Stop Predatory Journals.
- Le projet Think. Check. Submit.
Conclusion : dans le doute…
L’équipe du Service de Soutien à la Recherche du SCD () se tient à votre écoute et à votre disposition pour vous fournir un éclairage circonstancié sur le caractère prédateur ou non de la revue à laquelle vous voulez soumettre une publication. N’hésitez pas à la solliciter.
