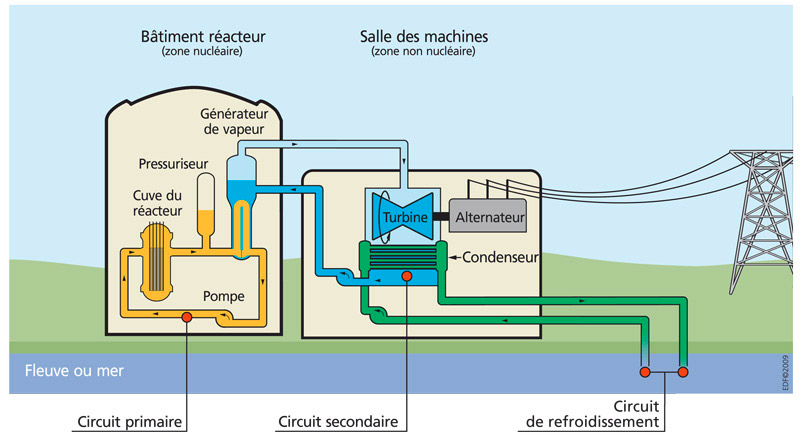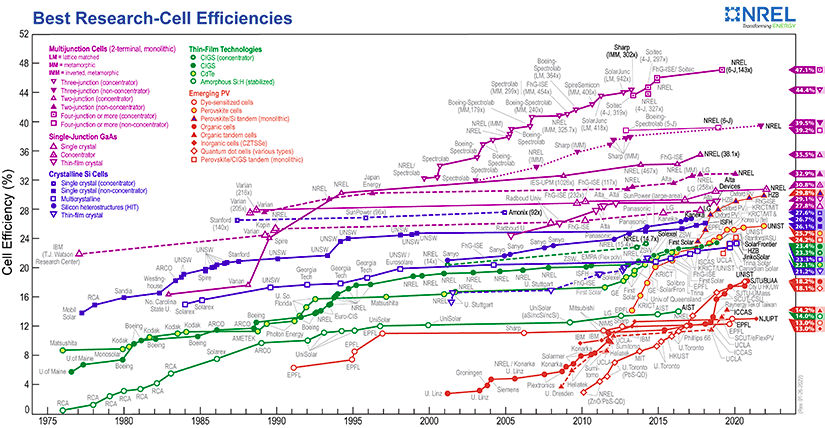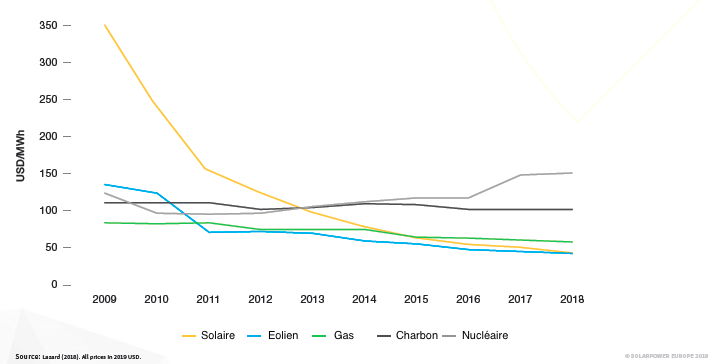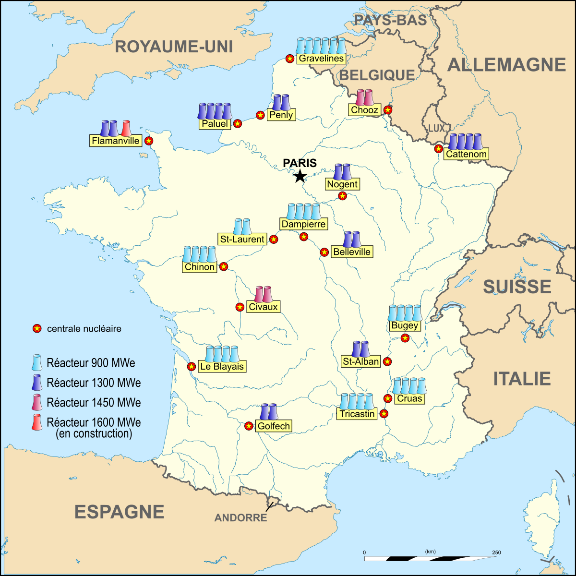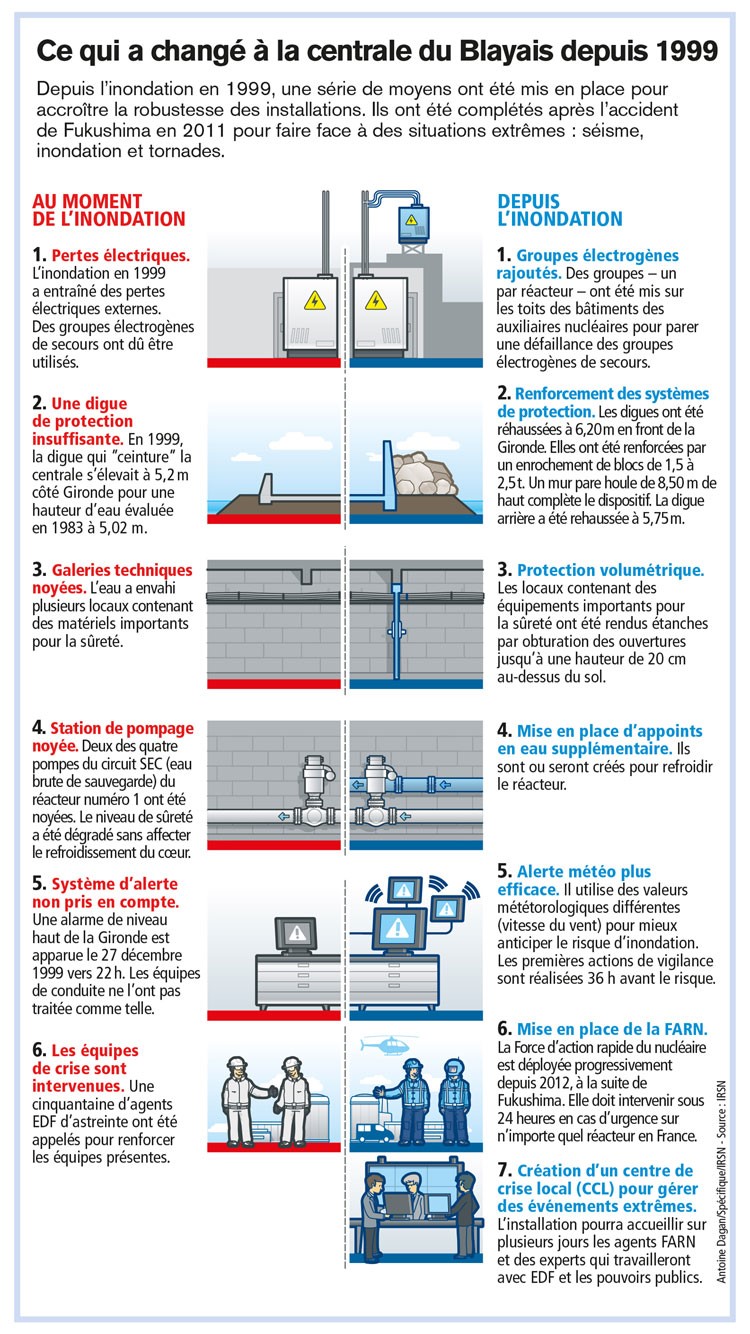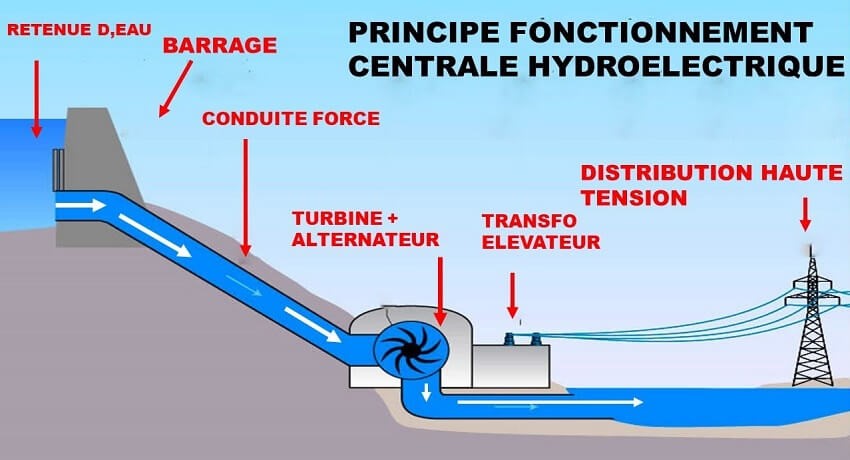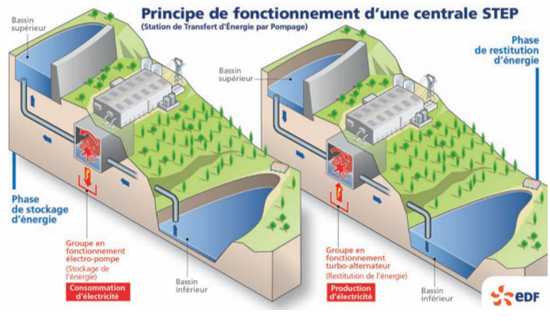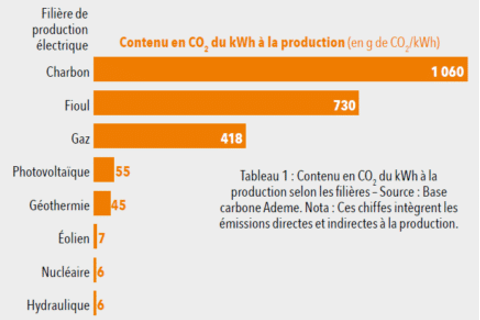Environnement
Vous trouverez ici la viédo de la soirée ainsi que les réponses et bibliographies associées à la première session de questions du premier semestre 2022
Micro-trottoir
Soirée
Vous pouvez retrouver ces vidéos en versions sous-titrées via les liens suivants : – Vidéo micro trottoir avec sous titres – Vidéo soirée avec sous titres
Anthropocène ou thanatocène ?
L’importance de l’activité humaine en tant que facteur de transformation profonde de l’environnement naturel semble aujourd’hui évidente. Notre civilisation a acquis le pouvoir d’altérer les systèmes terrestres (la lithosphère, l’atmosphère, l’hydrosphère, la biosphère), et ses traces resteront à jamais dans le registre géologique. Nous vivons dans l’Anthropocène, c’est-à-dire, l’époque de l’homme (anthropos veut dire « être humain » en grec).
L’Anthropocène ? Késako ?
Lorsqu’on parle de l’Anthropocène, on entend les bouleversements de nature géologique qui se produisent actuellement sur notre planète et qui ont été provoqués par l’Homme. En effet, l’Homme, par ses activités, a impacté les trajectoires des systèmes terrestres, dont les effets sont visibles à l’échelle mondiale, même dans des systèmes apparemment stables.
Les conséquences de ces impacts sont multiples et spectaculaires. La modification de vitesses d’érosion et des processus de sédimentation, la fonte de glaciers, le dégel du pergélisol, le dérèglement des grands cycles des éléments chimiques (ex. azote, phosphore, carbone, métaux) et de l’eau, le changement climatique, l’acidification des océans, l’augmentation du niveau des mers, l’expansion des zones à oxygène minimum dans les océans, la perte de biodiversité, l’introduction de nouvelles substances chimiques et matériaux dans le milieu naturel sont quelques-uns des exemples qui illustrent les changements dramatiques que l’humanité a apportés aux systèmes terrestres.
L’Anthropocène n’est pas une crise qui, par définition, a une durée courte. L’humanité a altéré la dynamique du système Terre à l’échelle du temps géologique, c’est-à-dire, que les conséquences de ces changements s’étendront sur des dizaines, voire des centaines de milliers d’années.
L’Anthropocène désigne donc l’empreinte « environnementale » de la civilisation moderne au sens large et fait référence à notre relation dominante avec le milieu naturel. L’humanité dans son développement est devenue une véritable force géologique et sa puissance a surpassé les grandes forces de la nature. Depuis environ 1950, l’Anthropocène est rentré dans la « grande accélération » avec l’altération du système terrestre et un développement ainsi qu’un bouleversement socio-économique exponentiel.
Quand a commencé l’Anthropocène ?
L’Anthropocène est né après une époque de stabilité climatique (Holocène) qui a duré 11 650 ans (hormis les petites périodes glaciaires) et au cours de laquelle l’agriculture, des villes et des civilisations ont émergées. L’Anthropocène n’est pas encore défini comme unité stratigraphique par la Commission Internationale de la Stratigraphie (CIS) sur l’échelle du temps en géologie. Pour que la CIS puisse déclarer l’Anthropocène comme une nouvelle unité de temps, le « signal géologique » de l’Anthropocène conservé dans les roches doit être significativement important, clair et distinctif. Sur l’échelle du temps en géologie, l’Anthropocène est envisagé au niveau d’une « série » ou d’une « époque » (les séries sont les sous-divisions des époques). Si l’Anthropocène était défini comme une « série », il s’agirait d’une série de l’Holocène (époque du Quaternaire).
Dans le cas contraire, l’Holocène prendrait fin. Le début de l’Anthropocène serait probablement situé au milieu du XXe siècle. À ce moment-là on observe une coïncidence de l’ensemble des signaux géologiques conservés dans des roches et résultant de la « grande accélération » de l’industrialisation, de la croissance démographique et de la mondialisation. Le point de repère du début de l’Anthropocène pourrait être la présence de radionucléides artificiels (éléments issus des essais de bombes thermonucléaires du début des années 1950) car leur signal dans les roches est fort, synchrone et répandu à l’échelle planétaire.
À qui devons-nous le terme « Anthropocène » ?
Le terme « Anthropocène » a été proposé en 2000 par Paul Crutzen, chimiste et lauréat du prix Nobel, et le biologiste, Eugene Stoermer. Mais ce concept a des racines beaucoup plus profondes ; pendant longtemps, il a été traité comme un terme descriptif, soulignant le rôle de l’Homme dans la modification de l’environnement naturel, mais sans importance significative pour la science elle-même, en particulier la géologie. Paul Crutzen a donc décidé d’utiliser toute son autorité de nobélisé pour populariser l’Anthropocène, mais aussi lui donner un véritable statut scientifique. Ce fut un succès, car l’Anthropocène n’est plus uniquement discuté par les scientifiques et les vulgarisateurs scientifiques, mais est devenu un sujet de la culture contemporaine, de la pop culture ou du débat philosophique et politique.
Thanatocène ? Késako ?
Le terme « Thanatocène » (Thanatos – Dieu de la mort selon la mythologie grecque) a été proposé en 2013, par Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques et de l’environnement, pour attirer l’attention sur les origines de basculements environnementaux mondiaux.
Le concept de Thanatocène, fait référence au développement de techniques et technologies de plus en plus puissantes et énergivores, y compris militaires, et à leur rôle (volontaire ou collatéral) dans la destruction massive d’écosystèmes. Selon ce concept, l’entrée dans l’Anthropocène est due aux « guerres militaro-industrielles » plutôt qu’à l’humanité dans son ensemble. Ce terme a été proposé pour pallier les limites de la définition de l’Anthropocène et pour marquer que les principaux marqueurs de l’Anthropocène sont plutôt liés aux rapports de forces et aux projections de la domination mondiale.
Nous sommes aux portes d’un changement d’époque, quel que soit le nom qui lui sera donné : Anthropocène, Thanatocène, ou encore Capitalocène (qui met en avant le rôle du capitalisme dans les bouleversements environnementaux). En tout cas, tous ces concepts font référence à des altérations anthropiques du système Terre, avec ou sans indication du « coupable » de ce qu’on vit actuellement.
En géologie, la transition vers une nouvelle époque révèle un changement général à l’échelle planétaire de nature biologique ou géologique. Dans le contexte actuel, l’idée qu’il est encore possible de vivre et de se développer selon le modèle basé sur la maximisation de la production et de la consommation n’a aucun fondement réel. Nous ne pouvons pas vivre dans une nouvelle époque dans laquelle nous traitons l’environnement naturel comme une ressource externe et illimitée. Dans un avenir proche, il est donc nécessaire de changer non seulement le modèle de développement actuel, mais aussi le modèle civilisationnel, ce qui implique un changement radical des modes de vie.
Articles scientifiques
Ruddiman, William. “The Anthropocene”. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 2013, vol. 41, p. 45-68.
DOI : https://doi.org/10.1146/annurev-earth-050212-123944
Steffen Will et al. “The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration”. The Anthropocene Review, 2015, vol. 2, p. 81-98. DOI : https://doi.org/10.1177/2053019614564785
Steffen Will et al. “The Anthropocene: conceptual and historical perspectives”. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2011, vol. 369, p. 842-867. DOI: https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0327
Zalasiewicz Jan et al. “The Anthropocene: a new epoch of geological time?” Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2011, vol. 369, p. 835-841. DOI : https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0339
Ouvrages scientifiques
Debret Maxime. Caractérisation de la variabilité climatique Holocène à partir de séries continentales, marines et glaciaires [Thèse de doctorat]. 2008. Université Joseph Fournier, Grenoble 1. Disponible sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00535769/document
Fressoz Jean-Baptiste et Bonneuil Christophe. L’Événement Anthropocène : La terre, l’histoire et nous. Paris : Éditions du Seuil, collection “Anthropocène”, 2016, 320 pages.
Rapports de GIEC. Disponible sur: https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
Grand public
Fressoz Jean-Baptiste. « L’anthropocène : une révolution géologique d’origine humaine » (Conférence). 2019. Université de Strasbourg. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=pKOpZq4kkko
Marin Cécile. « La “grande accélération” du système terrestre ». Le Monde diplomatique. 2015.
Disponible sur : https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/acceleration-terrestre
Malgorzata Grybos
Enseignante-chercheuse à l’Université de Limoges dans le domaine de géosciences. Elle mène ses recherches au laboratoire E2Lim. Géologue de formation spécialisée en biogéochimie, elle s’intéresse aux processus à l’interface (minéraux /eau /bactéries /matière organique) dans le milieu naturel (sols, sédiments).
Quels sont les rôles de l’agriculture et de l’élevage intensifs dans le changement climatique ?
Quelques définitions (bibliographie 1 et 2)
Agriculture et élevage intensifs font référence à des systèmes visant à obtenir une quantité importante de produits par surface au sol. Pour atteindre un rendement de culture élevé ou pour assurer le bon fonctionnement d’un élevage à forte densité, une solution communément utilisée est d’avoir recours à des intrants nombreux et en quantité importante.
Les intrants sont les différents produits apportés aux cultures ou aux animaux qui ne proviennent pas de l’exploitation agricole et tous les autres produits nécessaires à la marche d’une exploitation agricole : engrais, pesticides, semences et plants, aliments achetés, antibiotiques, hormones de croissance, mais aussi matériel agricole, honoraires du vétérinaire…
Le changement climatique est un processus naturel au cours duquel la température, les précipitations et le vent varient dans le temps. Cependant, la Terre vit actuellement un changement climatique particulier : non seulement ce changement est provoqué par l’activité humaine, mais aussi sa rapidité est sans précédent. Le changement climatique actuel est dû à une accumulation anormalement élevée des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère.
Les GES sont essentiels à la vie sur Terre puisqu’ils constituent une enveloppe qui empêche une partie de l’énergie solaire d’être renvoyée vers l’espace. Sans eux, la température à la surface de la Terre serait de l’ordre de -20°C. En s’accumulant, les GES « emprisonnent » la chaleur solaire ce qui entraîne l’augmentation de la température à la surface de la Terre.
Entre 1800 et maintenant, la température a globalement augmenté de 1,1°C ; à ce rythme, si l’Homme ne réduit pas les émissions de GES, la température pourrait augmenter de 4,4 °C d’ici à 2100 ce qui ne ferait qu’accroitre les conséquences pour la planète.
Un degré supplémentaire a pour conséquences directes :
– l’augmentation de la fréquence des épisodes de canicules et des incendies, l’accroissement de la sécheresse dans certaines zones,
– la proportion accrue des fortes précipitations et des cyclones tropicaux,
– la réduction de la banquise et du pergélisol de l’Arctique et l’augmentation du niveau des océans.
L’augmentation des GES dans l’atmosphère conduit aussi à l’acidification des océans. Les écosystèmes sont perturbés et l’ensemble des êtres vivants terrestres et marins est impacté : micro-organismes, végétaux, animaux et hommes. Les chaînes alimentaires sont altérées et la production agricole, comme l’accès à l’eau douce, diminue. Le changement climatique est une des menaces pour la biodiversité. Certains animaux, comme des insectes vecteurs de maladies végétales, animales et humaines, prolifèrent et migrent vers des latitudes et altitudes jusque-là épargnées comme c’est le cas pour le moustique vecteur du paludisme ou la chenille processionnaire du pin.
Certaines populations appelées « migrants climatiques » doivent quitter leur habitat dégradé par des catastrophes naturelles et les conditions climatiques. Outre l’aggravation de la sous-nutrition de certaines populations et le développement de pathologies infectieuses, le changement climatique a un impact sur la santé via le stress hyperthermique lié aux épisodes caniculaires qui fragilise les personnes vulnérables et via le stress psychologique qui fait suite aux catastrophes naturelles. À noter aussi que les pays en voie de développement sont les plus vulnérables face à cette crise climatique qui augmente le risque de conflits et constitue une menace sans précédent pour les moyens de subsistance, la santé et la sécurité en particulier des femmes et des filles.
Rôle de l’agriculture et élevage intensifs dans le changement climatique (bibliographie 3)
Les cultures et l’élevage, qu’ils soient intensifs ou non intensifs, jouent un rôle dans le changement climatique. En effet, culture et élevage produisent les trois GES majeurs : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). CH4 et N2O ont un pouvoir sur le réchauffement qui est supérieur à celui du CO2 ce qui est pris en compte dans les estimations des émissions des GES, exprimées en tonnes équivalent CO2.
Les GES produits par l’agriculture et l’élevage proviennent en grande partie de la fermentation (transformation de la matière par des micro-organismes) dans le tube digestif lors de la digestion ou dans les déjections animales qui sont stockées. Les animaux qui contribuent le plus à la production de GES par fermentation sont les ruminants avec, au premier rang, les bovins. Dans une moindre mesure, certaines pratiques de culture (inondation des rizicultures, sols compactés) conduisent à de la fermentation génératrice de GES.
La modification de l’usage des terres, surtout par la déforestation, l’assèchement de tourbières ou encore les brûlis, libère des GES naturellement stockés dans ces milieux et contribue pour une grande part à leur accumulation dans l’atmosphère. L’apport de fertilisants azotés comme les engrais synthétiques et la combustion de molécules carbonées (charbon, fioul, gaz…) pour le fonctionnement des installations agricoles sont aussi des sources de GES, mineures en comparaison de la fermentation et de la modification d’usage des terres. Dans sa globalité, l’utilisation des terres par l’homme (agriculture, sylviculture et élevage) serait responsable de près d’un quart des émissions de GES à l’échelle mondiale et d’un cinquième en France.
L’agriculture et l’élevage intensifs augmentent les émissions de GES notamment par une utilisation plus importante d’intrants : mécanisation des exploitations agricoles, apport d’engrais synthétiques… De plus, l’intensification des méthodes de culture et d’élevage aggrave les conséquences du changement climatique sur la biodiversité, sur l’accès à l’eau potable et sur la santé. Concernant ce dernier point, une densité animale élevée est propice au développement d’épizooties (épidémie chez les animaux) et de zoonoses (transmission d’agents infectieux de l’animal à l’homme). Pour les éviter, les éleveurs des exploitations intensives privilégient l’utilisation d’antibiotiques ce qui favorise le développement de l’antibiorésistance qui est un problème majeur de santé publique.
Dans les années à venir, un des grands enjeux de l’agriculture et de l’élevage au niveau mondial est de réussir à s’adapter pour continuer à fournir l’alimentation nécessaire à une population en croissance tout en limitant l’accumulation de GES dans l’atmosphère par la réduction de leur émission, par l’augmentation de leur stockage par le sol et par la biomasse et par leur valorisation (ex. méthanisation).
1) Pour la définition d’agriculture et d’élevage intensifs
« Différents modèles d’élevage ». Ressources sur l’élevage pour l’enseignement. 2020. Disponible sur : https://www.ressources-elevage.fr/copie-de-chap-113-productions-de-pr
2) Pour la définition et les conséquences du changement climatique
Site des Nations Unies (UN) : https://www.un.org/fr/climatechange/science/key-findings et https://www.un.org/fr/chronicle/article/les-effets-du-rechauffement-climatique-sur-la-sante-les-pays-en-developpement-sont-les-plus
Site du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de la Transition énergétique : https://www.ecologie.gouv.fr/impacts-du-rechauffement-climatique-sur-biodiversite
Site de comité d’experts français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) : https://uicn.fr/biodiversite-et-changement-climatique/
Site de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) : https://www.inserm.fr/magazine/sciencesante-n28/ (changement climatique et santé)
Grail Françoise (propos recueillis par Martine Valo). « L’océan absorbe 30 % des émissions de CO2 dues aux activités humaines ». Le Monde. 2015. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/climat/article/2015/06/08/l-ocean-absorbe-30-des-emissions-de-co2-dues-aux-activites-humaines_4649587_1652612.html
3) Pour mieux comprendre l’impact de l’agriculture et de l’élevage sur le changement climatique
Lire les rapports et articles rédigés par :
Les experts et scientifiques de l’Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) :
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb4477en/
https://www.fao.org/3/i6340e/i6340e.pdf
Le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt :
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/154000160.pdf (GES dérivés de l’agriculture et l’élevage dans le monde)
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/cep_analyse82_antibioresistances_en_elevage.pdf (élevage intensif et antibiorésistance)
L’Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) :
https://www.inrae.fr/actualites/quelle-contribution-lagriculture-francaise-reduction-emissions-gaz-effet-serre
https://www.inrae.fr/actualites/roles-impacts-services-issus-elevages-europeens
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/cahier-special-accaf-pour-la-science-l-adaptation-au-changement-climatique-fr.pdf
https://www6.angers-nantes.inrae.fr/bioepar/Actualites/elevage-intensif-et-zoonoses (agriculture et élevage intensifs, épizooties et zoonose)
Le CNRS : https://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.php?pid=decouv_chapC_p3_d1&zoom_id=zoom_d1_1
Anne Druilhe
Chercheuse de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), spécialisée en physiopathologie animale, discipline qui s’attache à décrypter les mécanismes conduisant d’un état sain à un état malade.
Quel autre choix que l’élevage intensif ?
Définition de l’élevage intensif (bibliographie 1 et 2).
L’élevage est une activité de soin, d’entretien et de production d’animaux pour le bénéfice de l’homme : pour son alimentation, pour ses vêtements et accessoires, pour l’ameublement, pour ses loisirs, pour l’aider dans son quotidien (ex. animaux de somme, chiens d’attelage, chiens guides d’aveugles…).
Les élevages sont définis comme « intensifs » ou « industriels » par opposition à des élevages « extensifs » ou « traditionnels ». Les qualificatifs « intensifs » et « extensifs » font référence uniquement à la densité animale, c’est-à-dire, au nombre d’animaux par unité de surface. Aucun autre paramètre n’est pris en compte dans ces qualificatifs. Ainsi, un élevage « intensif » n’est pas synonyme d’animaux enfermés. Le meilleur exemple est le système d’élevage intensif pratiqué en Amérique du Nord appelé feedlot qui est un parc d’engraissement en plein air.
La valeur limite est de deux Unité Gros Bétail appelée aussi Unité Gros Bovin (UGB) par hectare (ha) de surface agricole utilisée (SAU). Pour rappel, un hectare correspond à 10 000 m2 soit l’équivalent d’une surface carrée de 100 m de côté. Un élevage où il y a plus de 2 UGB/ha est intensif. Il est extensif s’il y a moins de 2 UGB/ha. L’unité UGB tient compte des besoins énergétiques des animaux de rente : une vache laitière représente 1 UGB alors qu’une brebis en vaut 0,15 et une poule pondeuse 0,014. Ainsi, en fonction de la catégorie d’animaux, 1 UGB correspond à un ou à plusieurs animaux.
Les choix autres que l’élevage intensif (bibliographie 3 à 7).
L’élevage intensif s’est développé à partir de la moitié du XXe siècle pour répondre à une augmentation de la population mondiale et à l’augmentation corollaire de la consommation alimentaire. Depuis quelques années, l’élevage intensif est remis en question pour une raison majeure de respect du bien-être animal.
Via la fourniture de viande, poisson, œuf et lait, l’élevage apporte de nombreux nutriments, principalement des protéines qui contiennent des acides aminés essentiels. Sur les vingt-deux éléments de base des protéines, neuf sont dits essentiels car le corps humain n’est pas capable de les produire ou les produit en quantité insuffisante pour ses besoins. Ces neuf acides aminés doivent donc être apportés par l’alimentation. Les protéines d’origine animale sont facilement et rapidement assimilables en comparaison des protéines apportés par d’autres aliments. Viande, poisson, œuf et lait apportent aussi des acides gras essentiels de type oméga 3 et des micronutriments (fer, calcium, zinc, sélénium) et des vitamines (A, B3, B6, B12, et D). Parmi les aliments, seuls les produits issus des animaux sont une source de vitamine B12. À noter que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un apport de protéines de l’ordre de 60 g par jour et par personne dont la moitié issue d’animaux et la moitié de végétaux.
Remplacer l’élevage intensif nécessite de disposer d’aliments :
– qui apportent des protéines sources des neuf acides aminés essentiels, des acides gras oméga 3 et des micronutriments (fer, calcium, zinc, sélénium) et des vitamines A, B3, B6, B12 et D),
– et en quantité suffisante pour nourrir la population mondiale.
Disposer d’aliments protéinés sans passer par de l’élevage intensif peut se faire via deux modalités. Une de ces modalités est la production de produits dérivés d’animaux par élevage extensif d’animaux de rente, par fabrication de viande in vitro et par élevage d’insectes. L’élevage extensif peut répondre ou non au cahier des charges des labels qui imposent des modalités d’élevage, y compris l’espace minimal dont l’animal doit disposer. Les seuls labels pour des produits alimentaires qui prennent en compte la densité animale sont le Label rouge (label français) et l’Agriculture biologique (label européen). Ainsi, l’élevage extensif peut se pratiquer selon les modalités du Label rouge, de l’Agriculture Biologique ou selon des modalités autres dites traditionnelles ou conventionnelles.
La production de viande in vitro consiste à faire proliférer des cellules animales dites « souches » dans une boîte de culture. Les cellules souches sont prélevées sur un animal puis sont cultivées à 37 °C en présence d’un milieu nutritif qui permet leur multiplication et leur maturation et différenciation en cellules musculaires. Le développement de la production de viande in vitro et de l’élevage d’insectes est conditionné par la mise au point de méthodes de production à bas coût financier et énergétique, par la vérification de l’innocuité de ces produits (ex. non allergène), et aussi par une modification des habitudes alimentaires.
L’autre modalité est la production de produits non dérivés d’animaux par culture de végétaux ou de micro-organismes comestibles riches en protéines, tels que les plantes légumineuses (ex. soja, haricot) ou les microalgues spiruline.
À noter que les viandes dites végétales appelées aussi « succédané de viande », « substitut de viande » ou « viande d’imitation » sont en fait des produits transformés à partir de végétaux à forte teneur en protéines. La transformation consiste en l’ajout d’additifs alimentaires pour obtenir une qualité texturale, gustative voire odorante, et esthétique proche de la viande.
La population mondiale est actuellement de plus de 7,5 milliards d’individus et pourrait augmenter jusqu’à 11 milliards en 2100. Actuellement 11 % de la population mondiale souffre de sous-nutrition ; la sous-nutrition touche les pays asiatiques hors Chine et une grande partie du continent Africain, zones dans lesquelles la plus forte augmentation de population est attendue à l’avenir. Au contraire, dans une grande partie de l’Amérique, en Europe et en Australie, la population a une alimentation plus abondante et plus riche en protéines animales que nécessaire.
Compte tenu de l’évolution probable à la hausse de la population mondiale et de la nécessité de rééquilibrer les régimes alimentaires, les scientifiques prédisent une augmentation de la demande en produits dérivés des animaux. Des modélisations montrent que l’élevage peut couvrir ces besoins accrus si :
– les surfaces de pâturage sont légèrement augmentées au détriment de la forêt (et non pas au détriment des terres arables nécessaires pour les cultures),
– les comportements évoluent en particulier dans les pays développés avec moins de perte et de gaspillage alimentaires et une alimentation moins riche en produits dérivés d’animaux,
– les échanges commerciaux s’intensifient et les modèles d’élevage évoluent (plus de bien-être animal et moins d’impact sur les changements climatiques) pour équilibrer les pays déficitaires.
Depuis plusieurs années, une réflexion est menée par les scientifiques de l’Institut National de la Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) pour accompagner le changement dans l’élevage.
1) Pour avoir des informations synthétiques sur l’élevage en général, voir le site du Groupement d’Intérêt Scientifique « Elevages Demain » : https://www.ressources-elevage.fr/
2) Pour mieux comprendre le calcul de l’Unité Gros Bétail, lire l’article de chercheurs de l’INRAE : Benoit Marc et Veysset Patrick. « Calcul des Unités Gros Bétails : proposition d’une méthode basée sur les besoins énergétiques pour affiner l’étude des systèmes d’élevage ». INRAE Productions Animales, 2021, vol. 34, no. 2, p. 139-160. DOI : https://doi.org/10.20870/productions-animales.2021.34.2.4855
3) Pour une infographie sur l’apport des produits animaux dans l’alimentation, consulter : Gavalda Véronica et Mollier Pascale. « [Infographie] Qu’apportent les produits animaux ? ». INRAE. 2019. https://www.inrae.fr/actualites/infographie-quapportent-produits-animaux
4) Pour tout savoir sur les alternatives à l’élevage (viande en culture, insectes, protéines végétales, micro-algues), lire ou écouter les experts de l’INRAE, du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) ou universitaires :
Mollier Pascale. « La viande in vitro, une voie exploratoire controversée ». INRAE. 2021. https://www.inrae.fr/actualites/viande-vitro-voie-exploratoire-controversee
Baker Nicolas. « Insectes comestibles : une industrie à inventer ». CNRS images. 2015. 6 min. https://images.cnrs.fr/video/4470
De Parscau Pierre. « Microalgues, le futur or vert ? ». CNRS images. 2015. 6 min 15. https://images.cnrs.fr/video/4678 (microalgues)
Pollet Romain. « “Retour sur…” : Souffrance animale, pollution, santé, la “viande artificielle” est-elle la solution ? » [podcast]. The Conversation. 2021. 18 min. https://theconversation.com/retour-sur-souffrance-animale-pollution-sante-la-viande-artificielle-est-elle-la-solution-163662
Tremblin Gérard et Veidl Brigitte. « La spiruline sera-t-elle l’aliment miracle du XXIe siècle ? ». The Conversation. 2017. https://theconversation.com/la-spiruline-sera-t-elle-laliment-miracle-du-xxi-siecle-80639
Wiart Lucie et Özçaglar-Toulouse Nil. « Comment la viande s’est végétalisée ». The Conversation. 2021. https://theconversation.com/comment-la-viande-sest-vegetalisee-162070
5) Pour tout savoir sur le cahier des charges français, européen permettant l’obtention de labels, voir le site internet de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (autrefois Institut National des Appellations d’Origine) : https://www.inao.gouv.fr/Les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-SIQO
6) Pour avoir une synthèse sur les prédictions d’évolution démographique mondiale : https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/population-mondiale-jusquou-va-grimper-population-mondiale-39860/
7) Pour mieux comprendre les enjeux à venir pour les productions de produits protéinés, voir :
« Quels sont les bénéfices et les limites d’une diminution de la consommation de viande ? ». INRAE. 2019. https://www.inrae.fr/actualites/quels-sont-benefices-limites-dune-diminution-consommation-viande
Manck Emmanuelle. « [Infographie] Pertes et gaspillages alimentaires : de quoi parle-t-on ? ». INRAE. 2019. https://www.inrae.fr/actualites/infographie-pertes-gaspillages-alimentaires
« Prospectives scientifiques interdisciplinaires : éclairer l’ambition ». INRAE. https://www.inrae.fr/nous-connaitre/prospectives-scientifiques-interdisciplinaires-eclairer-lambition
Anne Druilhe
Chercheuse de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), spécialisée en physiopathologie animale, discipline qui s’attache à décrypter les mécanismes conduisant d’un état sain à un état malade.
Assistons-nous à une 6e crise biologique ?
Une « crise biologique » est une période au cours de laquelle, à l’échelle planétaire, de nombreuses espèces animales et/ou végétales disparaissent simultanément. Les crises biologiques sont classées comme majeures, intermédiaires et mineures par rapport au taux et à l’ampleur des disparitions. Le taux d’extension correspond au nombre de disparitions divisé par le temps au cours duquel les extinctions se sont produites. L’ampleur de disparition est le pourcentage d’espèces qui se sont éteintes. On parle d’extinction de masse (crise biologique majeure), au sens paléontologique, lorsque le taux de disparition des espèces est supérieur à 75 % dans un intervalle du temps inférieur à 2 Ma.
La vie sur Terre existe depuis 3,7-3,8 Ga (Giga années = milliard d’années). Elle est apparue relativement tôt après la formation de notre planète (4,56 Ga). Pendant longtemps (environ 1,7 Ga), la vie sur Terre était primitive, unicellulaire, puis elle s’est diversifiée et complexifiée au fil du temps. On estime que sur 4 milliards d’espèces qui ont évolué sur la Terre au cours de 3.5 Ga, environ 99 % se sont éteintes. Cela montre à quel point l’extinction est répandue dans l’évolution du vivant. Depuis l’explosion cambrienne (+/- 570 Ma : million d’années), qui est considérée comme le « Big Bang » de l’évolution de la vie, la Terre a enregistré cinq extinctions massives et une trentaine de crises intermédiaires et mineures.
Toutes ces extinctions ont été causées par des modifications soudaines dans la dynamique des systèmes terrestres et de ses équilibres. Ces changements ont été provoqués par des phénomènes d’origine extraterrestre (ex. collision de la Terre avec un objet extraterrestre) ou terrestre (ex. activité tectonique). Le changement climatique (réchauffement ou glaciation), les transgression/régression répétées, le volcanisme de grande ampleur, les variations de la salinité des mers et des océans, les perturbations des courants océaniques (les anoxies, l’eutrophication, etc.) sont quelques-uns des exemples qui illustrent les changements dramatiques, mais naturels aux systèmes terrestres.
On distingue 5 extinctions majeures :
– la crise de l’Ordovicien (- 435 Ma),
– la crise du Dévonien (- 355 Ma),
– la crise du Permien (- 250 Ma) : crise la plus dévastatrice avec un taux de disparition > 90 %,
– la crise du Trias (- 200 Ma),
– la crise du Crétacé (- 65,5 Ma).
Nous vivons actuellement une importante crise de la biodiversité. De nombreuses populations animales et végétales sont en déclin. Selon les scientifiques le taux d’extinction actuel est entre 100 et 1000 fois supérieur au taux naturel moyen constaté dans l’histoire de l’évolution ; et ce rythme ne cesse d’augmenter. L’extinction moderne des espèces est dramatique et grave mais, en termes paléontologiques, elle ne constitue pas à l’heure actuelle une extinction de masse comparable aux grandes crises biologiques du passé. Or, au rythme actuel de destruction, il ne faudra pas plus de quelques siècles pour que ¾ des espèces disparaissent, entraînant une crise biologique majeure. La crise de la biodiversité actuelle est inédite par ses causes. Pour la première fois elle est entièrement causée par l’action d’une espèce (nous), et non par des catastrophes naturelles ou des phénomènes géologiques.
Les causes de la crise de la biodiversité actuelle sont diverses et variées : destruction et fragmentation des habitats directs (déforestation, urbanisation,) et indirectes (pollution, agriculture intensive, exploitation de ressources…), changement climatique, élimination par la chasse/pêche, introduction d’espèces non-indigènes (délibérée ou accidentelle), etc.
Malgré l’existence de grandes extinctions de masse dans le passé, la dynamique de l’évolution a toujours permis de les compenser. Les grandes crises biologiques ont été suivies d’une modification de l’état de la biosphère et d’une biodiversification. Cependant, le rétablissement de la biodiversité ne se fait pas à une échelle de temps historique. L’évolution de nouvelles espèces prend généralement au moins des centaines de milliers d’années, et le rétablissement après des épisodes d’extinction massive se fait sur des échelles de temps géologiques englobant des millions d’années.
Nous sommes, en tant qu’espèce, également les victimes potentielles de cette crise. Si les espèces vivantes ont changé après chaque crise majeure, il n’y a aucune garantie que l’espèce humaine puisse survivre. « La santé des écosystèmes dont nous dépendons, ainsi que toutes les autres espèces, se dégrade plus vite que jamais. Nous sommes en train d’éroder les fondements mêmes de nos économies, nos moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et la qualité de vie dans le monde entier » a déclaré Rober Watson, le président de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques).
Sur l’ensemble de la planète, l’homme a significativement modifié 75 % des milieux naturels terrestres et plus de 65 % des océans, détruit 85 % des zones humides en l’an 2000 et continue de les détruire à un rythme trois fois supérieur à celui de la déforestation. 33 % de la superficie des terres et 75 % de la consommation d’eau douce sont actuellement destinées à l’agriculture ou à l’élevage pour répondre à la demande croissante de nourriture. Les terres arables ont perdu 23 % de leur capacité de production à cause de leur surexploitation. Les sols sont de plus en plus dégradés et nécessitent l’ajout d’engrais pour parvenir à leurs fertilités. La pollution par les plastiques a été multipliée par dix depuis 1980. Des tonnes de métaux lourds, de produits chimiques toxiques et autres déchets issus des sites industriels sont déversés chaque année dans l’environnement.
Les zones urbaines ont plus que doublé depuis 1992. En 2015, 33 % des stocks de poissons marins ont été exploités à des niveaux non durables, les « zones mortes » dans les océans s’élargissent, etc. La nature décline tandis que nous prospérons. Pourtant, l’environnement n’est pas seulement une ressource passive dans laquelle nous puisons les matières dont nous avons besoin. Par exemple, 75 % des cultures dépendent de la pollinisation par les insectes et autres pollinisateurs naturels, dont les populations diminuent. Tout cela se produit à un moment où les gens sont déjà conscients des conséquences de modification de systèmes terrestres et mènent même officiellement la lutte contre la crise écologique et le réchauffement climatique.
Selon la liste rouge mondiale de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), qui constitue l’inventaire mondial de l’état de conservation global des espèces végétales et animales, plus de 40.084 (sur les 142.577 espèces étudiées au niveau mondial) sont classées menacées d’extinction au niveau mondial ce qui représente un peu plus d’1/3 des espèces évaluées. Parmi ces espèces, 41 % des amphibiens, 13 % des oiseaux, 26 % des mammifères, 37 % des requins et raies, 33 % des coraux constructeurs de récifs et 34 % des conifères, sont considérées comme menacées. Dans cet état des lieux, 1889 espèces menacées au niveau mondial sont présentes sur le territoire français (en métropole et en outre-mer). Cependant les chiffres documentés l’UICN ne fournissent certainement pas des estimations réelles du risque d’extinction des espèces. Ils sont largement sous-estimés du fait de la complexité à estimer le nombre d’espèces déjà perdues sur la Terre car il n’existe aucune méthode pour connaitre le nombre d’espèces éteintes avant d’avoir été formellement décrites.
Articles scientifiques
Bambach, R.ichard. “Phanerozoic biodiversity mass extinctions”. Annual Review of Earth and Planetary Science, 2006, vol. 34, p.127-155. DOI : https://doi.org/10.1146/annurev.earth.33.092203.122654
Barnosky, Anthony et al. “Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived?” Nature, 2011, vol. 471, p.51-57.
DOI : https://doi.org/10.1038/nature09678
Bond, David & Grasby Stephen. “On the causes of mass extinctions”. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2017, vol. 478, p.3-29.
DOI : https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.11.005
Cameron Thomas. et al. “Extinction risk from climate change”. Nature, 2004, vol. 427, p.145-148. DOI : https://doi.org/10.1038/nature02121
Cowie Robert et al. “The Sixth Mass Extinction: fact, fiction or speculation?” Biological Reviews, 2022, vol. 97, p.640-663. DOI : https://doi.org/10.1111/brv.12816
Plotnick, Roy et al. “The fossil record of the sixth extinction”. Ecology Letters, 2016, vol. 19, p.546-553. DOI : https://doi.org/10.1111/ele.12589
Ripple, William. et al. & 15,364 scientist signatories from 184 countries. “World scientists’ warning to humanity: a second notice”. BioScience. 2017, vol. 67, p.1026-1028. DOI : https://doi.org/10.1093/biosci/bix125
Tilman David et al. “Habitat destruction and the extinction debt”. Nature. 1994, vol. 371, p.65-66. DOI : https://doi.org/10.1038/371065a0
Van Klink Roel. et al. “Meta-analysis reveals declines in terrestrial but increases in freshwater insect abundances”. Science, 2020, vol. 368, p.417-420. DOI: 10.1126/science.aax9931
Wake David & Vredenburg Vance. “Are we in the midst of the sixth mass extinction? A view from the world of amphibians”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2008, vol. 105. p. 11466-11473. DOI : https://doi.org/10.1073/pnas.0801921105
Worm Boris et al. “Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services”. Science, 2006, vol. 314, no. 5800, p. 787-790. DOI : 10.1126/science.1132294.
Ouvrages scientifiques
Devictor Vincent. Nature en crise. Édition Seuil, collection “Anthropocène”, 2015, 356 pages.
Kolbert Elizabeth. The Sixth Extinction: an Unnatural History. New York: Henry Holt and Company, 2014, 336 pages.
Leakey Richard, Lewin Roger. La sixième extinction. Édition Flammarion, collection “Champs Sciences”, 1995, 352 pages.
Malgorzata Grybos
Enseignante-chercheuse à l’Université de Limoges dans le domaine de géosciences. Elle mène ses recherches au laboratoire E2Lim. Géologue de formation spécialisée en biogéochimie, elle s’intéresse aux processus à l’interface (minéraux /eau /bactéries /matière organique) dans le milieu naturel (sols, sédiments).
Est-il encore possible de maîtriser le changement climatique ?
On parle de changement climatique depuis plus de 30 ans avec une première réflexion sur l’évolution du climat impulsée par le Groupe d’experts Intergouvernementaux (GIEC) en 1988. Durant ces années, l’ampleur et l’impact du phénomène se sont précisés, mais également amplifiés et les actions de correction ou d’adaptation à la transition restent très limitées. Le changement climatique est-il hors de contrôle ?
L’augmentation de la température depuis l’ère préindustrielle (1850) est de 1.1 °C et avec un dépassement du seuil de 1.5 °C autour de 2040 d’après le GIEC [1]. Ensuite le GIEC propose différents scénarios [5] selon le forçage radiatif[1] (bilan sur la puissance radiative dans le système Terre) qui dans le dernier rapport de 2021 a été associé à la notion de « parcours socio-économique partagés ». Pour apprécier ces scénarii, on peut utiliser la notion de neutralité carbone soit une émission de carbone qui s’équilibre avec son absorption par des puits de carbone (océans, humus des sols, la flore). Pour atteindre la neutralité carbone il faut passer d’une émission globale de 38 Gt par an à environ 10 Gt correspondant aux principaux puits naturels [2].
Le scénario le plus favorable (SSP1), qui considère de fortes coopérations internationales, des services respectueux de l’environnement, une réduction drastique de la consommation des ressources et de l’énergie, impliquerait une diminution constante de la température (retour à la normale) à partir de l’engagement de l’action avec comme objectif une neutralité carbone en 2050. Un Français émet une empreinte carbone de 10.4 T Eq.CO2 par an : la neutralité carbone demanderait de descendre à 1.8 T Eq.CO2, soit de diviser par six notre empreinte ! Dans le monde les domaines à plus forte émissions sont la production d’électricité (centrale à combustibles carbonés), les transports puis l’industrie et la construction. En France le premier, et de très loin, est le transport (41 %) [3].
L’accord de Paris a été signé en 2015 par 193 parties dont les pays les plus gros émetteurs (Chine 29,7 %, Inde 7.2 %, États-Unis 2.9 % – UE 8.1 %).
La neutralité carbone en 2050 est l’ambition de l’Union Européenne [4] avec comme premier objectif la réduction de 55 % des GES en 2030 [4]. Cependant le rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) sur la période 2015-2018 montre que les objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet serre de quelque 150 États pour 2030 n’entraînent aucun changement de la trajectoire de température : + 2,7 °C d’ici la fin du siècle… [5] Il met également en avant que les « initiatives de coopérations internationales » sont toutes retombées après la COP 21.
Après un échec de la COP 25, la COP26 [6] à Glasgow du 31 octobre au 13 novembre 2021, était la conférence la plus lourde d’enjeux depuis l’adoption de l’Accord de Paris de décembre 2015. Après l’impact faible de la COP24 à Katowice et de la COP25 à Madrid, la COP26 à Glasgow a permis de trouver un consensus sur plusieurs points indispensables à l’application effective de l’accord.
Le rapport du Sénat de décembre 2021 rappelle que les négociations climatiques ont certes permis un léger relèvement de l’ambition climatique (- 0,3 °C) qui placerait au mieux la planète sur une trajectoire d’augmentation des températures de 2,3 °C, loin de la cible de 1,5 °C. Le rapport relève également des progrès insuffisants en matière de finance climatique en direction des pays en développement qui devrait être un volet majeur de la COP 27. Sans réponse rapide de la communauté internationale à ces problématiques, la crise de confiance entre pays développés et pays en développement pourrait s’ancrer plus encore et paralyser durablement la négociation climatique. La commission appelle donc la France et l’Union européenne à avancer sur ce volet dans la perspective de la COP27 en Égypte en novembre 2022.
Si on résume : en 2018, la trajectoire du changement climatique était toujours sur le scénario SSP2 4.5 avec une hausse de la température de 2.7 °C en 2100. Dans ce scénario la neutralité carbone n’est pas atteinte dans le siècle… On peut donc espérer un scénario moins dramatique. Mais une hausse de la température de 2 °C aura des conséquences difficiles à anticiper au-delà même des conséquences directes (augmentation du niveau des mers, événements climatiques extrêmes, sécheresse, canicule, perte de biodiversité) avec des déplacements de populations et des conflits autour de la ressource en eau.
En cas de rivalités régionales (SSP3), c’est-à-dire, « les pays sont guidés par les préoccupations en matière de sécurité et de compétitivité », les émissions de CO2 augmentent linéairement et 4 °C sont en ligne de mire pour la fin du siècle…
[1] Perturbation du système climatique par des facteurs externes.Disponible sur : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2021-0 [4] « Qu’est-ce que la neutralité carbone et comment l’atteindre d’ici 2050 ? ». Parlement Européen. 2023.
Disponible sur : https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20190926STO62270/qu-est-ce-que-la-neutralite-carbone-et-comment-l-atteindre-d-ici-2050 [5] “Emissions Gap Report 2018”. United Nations Environment Programme. 2018. Disponible sur :https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26895/EGR2018_FullReport_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y [6] « Bilan des négociations climatiques de Glasgow (COP26) ». Sénat. 2021.
Disponible sur : http://www.senat.fr/notice-rapport/2021/r21-279-notice.html
Michel Baudu
Professeur de l’Université de Limoges, Enseignant Chercheur dans le laboratoire Eau et Environnement (E2Lim – UR 24133) et responsable au cours des années passées de formations et de projets de recherche sur la gestion et le traitement des eaux.
Comment fonctionne la communication entre les arbres ?
La communication entre les arbres, et plus généralement entre les plantes, utilise des vecteurs biochimiques comme des molécules volatiles (Composés organiques volatiles [COV]), mais également des vecteurs biotiques au travers des réseaux fongiques mycéliens. Cette communication peut résulter d’un simple monologue entre les arbres et/ou entre les arbres et les micro-organismes présents dans l’environnement, ou d’un dialogue chimique entre des partenaires dont la symbiose est l’un des révélateurs phénotypiques marquants.
La communication, outil d’information et d’adaptation
Depuis toujours, les organismes vivants, hominidés compris, émettent des molécules organiques volatiles (COV) dans leur environnement dont les fonctions sont soit attractives soit répulsives (Holopainen and Blande, 2013). Les COV sont soit des terpénoïdes, soit des produits issus de l’activité de la lipoxygénase mieux connue sous le nom de Green Leaf Volatiles (GLV) (Maffei, 2010 ; Holopainen, 2011), soit des composés aromatiques volatils tels que le salicylate de méthyle (Maffei, 2010), soit des hormones végétales comme l’éthylène. Tous ces composés, à l’exception de l’éthylène, sont issus du métabolisme spécialisé des plantes et constituent pour les végétaux, dont les arbres, une batterie de molécules leur permettant de s’adapter dans l’espace et le temps à leur environnement.
Lorsque les feuilles d’acacia (Acacia nigrescens ou Acacia caffra) sont broutées par des herbivores, les arbres synthétisent de l’éthylène qui induit la biosynthèse de tannins rendant les protéines des arbres indigestes. Un mécanisme de résistance systémique acquise se propage ensuite via les cellules du phloème induisant une biosynthèse généralisée de tannins dans l’ensemble du houppier, avant de s’étendre aux arbres voisins. La baisse drastique de l’appétence des feuilles pour les herbivores entraîne le déplacement des troupeaux vers d’autres bosquets d’arbre permettant de maintenir un équilibre dynamique délicat entre les populations d’herbivores et d’arbres (Hoven, 1984).
Le pin maritime, et plus spécifiquement la pinosylvine produite par cette essence, peut avoir des effets sur les populations animales dont l’homme. On parle alors de phytoncide.
Le dialogue chimique, pour aller plus loin
La mycorhize, du grec « myco », champignon et « rhiza », racine, définit la relation symbiotique qui existe entre les racines des arbres et certains champignons (Frank, 1879). Cette relation, dont les origines remontent à la conquête du milieu terrestre par les plantes au Dévonien[1], permet de mettre en relation un champignon parfaitement adapté au milieu édaphique, c’est-à-dire à la nature du sol, et les racines d’une plante. Tous les arbres sont mycorhizés et principalement par des champignons ectomycorhiziens.
Plus qu’une aide à la nutrition de l’arbre, le réseau mycélien, en prospectant le sol, va établir des relations trophiques et de défense avec plusieurs arbres d’une même forêt et mettre en place un réseau souterrain de communication entre les arbres (Simard et al., 1997). Les molécules libérées par les racines (ou exsudats racinaires) dans la rhizosphère peuvent comprendre des flavonoïdes, des terpènes et des hormones comme les strigolactones (Hirsch et al., 2003). Les exsudats racinaires déclenchent la synthèse de métabolites fongiques tels que les stérols, les auxines, les cytokinines, les gibbérellines (GA), l’acide abscissique et l’éthylène.
Ces composés dérivés des racines et des champignons jouent un rôle important principalement dans la phase pré-symbiotique modifiant le tropisme des hyphes pour les racines, facilitant l’attachement et l’invasion des tissus hôtes par les hyphes, induisant des modifications morphologiques et physiologiques des racines et du mycélium ainsi que dans le maintien de la mycorhize.
Une fois la mycorhization mise en place, les arbres se préviennent mutuellement. Le sapin de Douglas et le bouleau vivent par exemple en symbiose. Lorsque ce dernier est dépourvu de feuilles, en automne et en hiver, le carbone et l’azote lui sont apportés par le Douglas, tandis que le procédé s’inverse lorsque le bouleau a grandi et se trouve pourvu d’un feuillage abondant, à la belle saison.
[1] Période géologique qui s’étend de -416 millions d’années à -359 millions d’années.Holopainen Jarmo & Blande James. “Where do herbivore-induced plant volatiles go?”. Front Plant Sci, 2013, vol. 4, no 185. DOI : https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00185
Van Hoven, Wouter. “Trees’ secret warning system against browsers”. Custos., 1984, vol. 13, p. 11‐16.
Maffei Massimo. “Sites of synthesis, biochemistry and functional role of plant volatiles”. South African Journal of Botany, 2010, vol. 76, p. 612-631. Doi: 10.1016/j.sajb.2010.03.003
Holopainen Jarmo & Gershenzon, Jonathan. “Multiple stress factors and the emission of plant VOCs”. Trends Plant Sci, 2010, vol. 1, p. 176-184. DOI : https://doi.org/10.1016/j.tplants.2010.01.006
Hirsch Ann et al. “Molecular signals and receptors: Controlling rhizosphere interactions between plants and other organisms”. Ecology, 2003, vol. 84. p. 858-868.
DOI : https://doi.org/10.1890/0012-9658(2003)084[0858:MSARCR]2.0.CO;2
Frank AB (1879) “Ueber den Parasiten in den Wurzelanschwellungen der Papilionaceen”. Bot Ztg 37. p. 377-388.
Guy Costa
Maitre de conférences à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges au département sciences du vivant.
Les conséquences humaines liées au changement climatique : qu’en est-il des migrations climatiques ?
Depuis la création de la Terre, différentes périodes se sont succédées. Il y a 100 millions d’années, des dinosaures vivaient sous un climat tropical tandis qu’il y a près de 15 000 ans, ce même paysage était couvert de glace. Le changement climatique relève ainsi d’un phénomène naturel et cyclique
Le changement climatique que nous connaissons aujourd’hui se caractérise à la fois par sa rapidité et sa brutalité. Depuis la fin du XIXe siècle, la température moyenne à la surface de la Terre augmente, l’activité humaine et ses conséquences contribuent à ce réchauffement global.
Les espèces, animales et végétales, n’ont pas le temps de s’adapter à des changements aussi rapides, c’est pour cette raison qu’elles sont menacées comme l’être humain.
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ces changements climatiques peuvent entraîner des dommages importants :
– élévation du niveau des mers et des océans,
– accentuation et augmentation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, tempêtes, etc.),
– déstabilisation de l’équilibre écosystémique de la faune et de la flore ; réduction de la biodiversité,
– menace sur le cycle de l’eau et les ressources d’eau douce,
– baisse de production dans le monde agricole,
– désertification et perte de terres émergées,
– prolifération et extension des maladies tropicales (paludisme, etc.) et infectieuses (salmonellose, choléra, etc.).
Cette situation présente de nombreux risques pour les êtres humains comme pour toutes les autres formes de vie :
· Malnutrition et sous-alimentation
· Explosion de la pauvreté
· Mortalité et morbidité liés aux événements extrêmes
· Recrudescence des maladies : augmentation de la mortalité et de la morbidité liées aux maladies infectieuses (transmissions par vecteurs et infections d’origine alimentaire et hydrique)
· Des iles et des pays engloutis (ex : Les habitants de l’atoll de Bikini, dans le Pacifique, ont ainsi réclamé l’asile climatique aux USA.
Migrations climatiques.
Le changement climatique aura certainement des conséquences en termes de migrations et de mobilité humaine. Mais les déterminants de ces migrations sont multiples et interdépendants, aussi le changement climatique sera vécu de manière différente selon les régions, pays et catégories sociales concernées, car la vulnérabilité à l’égard de l’environnement dépend également de facteurs socio-économiques, politiques et géographiques spécifiques à chaque société.
Les questions politiques pourraient être :
ð Protection des migrants climatiques et responsabilités des États : Vers l’établissements de nouvelles normes, conventions internationales, Traités ?
ð Est-il permis, d’un point de vue éthique, de s’opposer à des migrations climatiques ?
Les peuples ont toujours migré, poussés par des raisons économiques, sociales ou politiques. Le changement climatique vient aujourd’hui s’ajouter aux facteurs de migration : un nombre grandissant d’individus quittent des territoires exposés aux dérèglements climatiques pour fuir temporairement ou définitivement leurs lieux de vie et s’installer ailleurs dans leur pays ou dans d’autres.
Depuis 1990, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) alerte sur le fait que l’impact le plus marqué de l’évolution du climat pourrait être ressenti au niveau des migrations humaines correspondant au déplacement de millions de personnes devant faire face à un bouleversement de leur environnement et de leurs conditions de vie (érosion des côtes, montée des eaux, inondations, sécheresse, …). De nombreuses institutions ont tenté de quantifier les flux de ces futurs réfugiés climatiques. Dans un rapport de 2008, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) projetait qu’ils seraient 200 millions d’ici à 2050. Dans son rapport le plus récent (2021), la Banque mondiale prédit pour sa part qu’environ 216 millions de personnes seront contraintes de migrer d’ici à 2050 à l’intérieur de certains pays en développement. Ce phénomène touchera plus durement les plus démunis qui sont les plus exposés aux risques climatiques, et par conséquent les plus vulnérables, et qui seront les premiers à être contraints de migrer.
À la différence des réfugiés politiques couverts par les conventions de Genève et sous protectorat du Haut-Commissariat aux réfugiés, le statut des migrants climatiques ne fait l’objet d’aucune définition juridique, d’aucune convention internationale qui permettrait de leur assurer un statut protecteur. Il n’existe pas non plus d’organisme international spécifique chargé de surveiller la protection de leurs droits. Des chercheurs juristes de l’Université de Limoges ont ainsi été parmi les premiers à proposer un projet de convention internationale destiné à pallier ce vide juridique pour que les droits les plus fondamentaux de ces déplacés environnementaux soient garantis. Il relève de la responsabilité de tous les États, individuellement et collectivement, de prévenir et de gérer humanitairement ces situations.
Piguet Étienne, Pécoud Antoine, et De Guchteneire Paul. « Changements climatiques et migrations : quels risques, quelles politiques ? ». L’Information géographique, 2011, vol. 75, no. 4, p. 86-109.
Sites sur le changement climatique :
Actu Environnement : actu-environnement.com
My climate : https://www.myclimate.org
Séverine Nadaud
Enseignante-chercheuse membre de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ UR 14476). Juriste spécialisée en matière de protection des droits de l’Homme face aux nouveaux enjeux climatiques et énergétiques. Responsable du Master2 Droit international et comparé de l’environnement et du DU de droit animalier.
Maryse Fiorenza-Gasq
Le Dr Maryse Fiorenza-Gasq est gynécologue-obstétricienne à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant au CHU de Limoges. Elle exerce les fonctions de Directrice de l’Espace de Réflexion Éthique de Nouvelle Aquitaine (ERENA) et de Directrice de l’ERENA du site de Limoges. Elle est aussi Coordinatrice de la Conférence Nationale des Espaces de Réflexion Éthique Régionaux (CNERER)
Qu’est-ce qu’il va en être de nos sociétés à l’avenir ?
Rapports du GIEC, COP 26, programmes électoraux, les différents scénarii de l’avenir de notre société, certains plus pessimistes que d’autres, deviennent de plus en plus accessibles et médiatisés pour alerter sur l’urgence d’une mobilisation mondiale.
Ces scénarii prédisent différents changements sur l’ensemble des sphères de notre environnement, mais s’accordent tous sur certains faits : ce que nous avons connu va changer, nous allons devoir nous adapter aux changements climatiques et nous devons continuer à lutter contre le réchauffement climatique pour espérer un scénario vivable pour tous.
Selon les auteurs de ces rapports, le succès de l’adaptation et de la lutte repose sur des changements de comportements à l’échelle collective et gouvernementale, mais aussi à l’échelle individuelle. Connaitre les facteurs qui nous freinent et nous découragent est un bon moyen de réduire l’espace entre notre motivation individuelle actuelle et celle que nous devons atteindre pour initier ces changements.
En psychologie sociale et cognitive, l’on a pu identifier certains de ces facteurs dont il faut prendre conscience car ils freinent nos actions :
1/ La dissonance cognitive
La dissonance cognitive souligne le fait que nous n’agissons pas toujours sur la base de nos convictions, mais que nous avons plutôt tendance à ajuster celles-ci a posteriori en fonction de nos actions.
La théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 2009) explique en effet que lorsque deux de nos cognitions (ex pensées, croyances, comportements) ont une relation de dissonance (c’est-à-dire vont à l’encontre l’une de l’autre), on ressent un inconfort psychologique que l’on tente de réduire par différents moyens en privilégiant ceux nécessitant le moins d’effort.
Les réducteurs de cet inconfort peuvent être un changement d’attitude (ex. adopter un moyen de transport plus propre), un changement d’environnement (ex. choisir de vivre dans une grande ville où l’on ne peut pas acquérir de véhicules « propres ») ou l’ajout d’une nouvelle cognition (ex. lire plus de critiques sur les transports « propres » et ne plus lire d’information sur le danger climatique des véhicules polluants). Depuis, d’autres moyens de réduction de l’inconfort ont été mis en évidence comme la trivialisation (i.e. diminuer l’importance des éléments impliqués) (Simon, Greenberg, & Brehm, 1995) ou encore le déni de responsabilité (c’est-à-dire se désengager de son propre comportement et devenir ainsi inconscient de la dissonance engagée par ce comportement) (Gosling, Denizeau, & Oberlé, 2006).
2/ Le sentiment d’efficacité personnel et collectif
Le sentiment d’efficacité personnel et collectif (Bandura, 2003) est l’idée que l’Homme évite, à moins qu’il n’y soit contraint par l’extérieur, les transactions avec les aspects de son environnement qui dépassent selon lui ses capacités d’adaptation. Aussi, de la même manière qu’un individu a besoin du sentiment d’auto-efficacité pour agir, les groupes et les personnes œuvrant ensemble ont besoin d’une efficacité collective perçue pour agir.
3/ Le désengagement moral
Le désengagement moral (Bandura, 2011) est le fait qu’il y ait différents mécanismes psychosociaux par lesquels les personnes peuvent se désengager de l’individu moral qu’elles sont, de ses auto-sanctions et auto-censures afin de pouvoir agir, dans certains versants de leur vie, de manière nuisible tout en agissant le reste du temps de façon proche de la morale. Parmi ces mécanismes il existe notamment ; les justifications morales, sociales ou économiques (c’est-à-dire minimiser les impacts négatifs pour se persuader que son action est socialement ou moralement bonne), les comparaisons avantageuses (c’est-à-dire comparer avec des actions plus nuisibles encore), le langage euphémistique (c’est-à-dire adoucir pour rendre acceptable), le déplacement ou la diffusion de responsabilité qui représente le fait que les personnes se comporteront d’une manière qu’ils répudient en temps normal si une autorité légitime accepte la responsabilité des effets de leurs activités préjudiciables.
En comprenant ces mécanismes, souvent inconscients, nous ciblons l’augmentation de notre motivation à agir vers l’adaptation et la lutte face aux changements climatiques.
Bandura Albert. Auto-efficacité : Le sentiment d’efficacité personnelle (Trad. Lecomte, J.). Paris : De Boeck, 2003, 888 pages.
Bandura Albert. “Moral disengagement”. The Encyclopedia of Peace Psychology, 2011.
DOI : https://doi.org/10.1002/9780470672532.wbepp165
Festinger Leon. A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press, 1957, 291 pages.
Gosling Patrick et al. “Denial of responsibility: a new mode of dissonance reduction”. Journal of personality and social psychology. 2006, vol. 90, no. 5, p. 722-733. DOI : https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.722
Martinie Marie-Amélie & Larigauderie Pascale « Coût cognitif et voies de réduction de la dissonance cognitive ». Revue internationale de psychologie sociale. 2007, vol. 20. p. 5-30. Disponible sur : https://www.cairn.info/revue–2007-4-page-5.htm
Heald Seth. “Climate Silence, Moral Disengagement, and Self-Efficacy: How Albert Bandura’s Theories Inform Our Climate-Change Predicament”. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. 2017, vol. 59, no. 6, p. 4-15. DOI : https://doi.org/10.1080/00139157.2017.1374792
Simon Linda et al. “Trivialization: the forgotten mode of dissonance reduction”. Journal of Personality and Social Psychology, 1995, vol. 68, no. 2. p. 247-260. DOI : https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.2.247
Voyer Vallérie. Procrastiner au péril de l’humanité : une perspective psychologique au problème du changement climatique [Mémoire]. 2015, Université de Montréal. Disponible sur : http://hdl.handle.net/1866/14012
Zhor Raimi
Exerce en tant que Neuropsychologue à l’établissement de réadaptation professionnelle EPNAK Limoges. Doctorante en 2ème année de Psychopathologie Cognitive au laboratoire C2S de l’Université de Reims.
On voit de plus en plus de maltraitance animale partagée sur les réseaux sociaux, nos lois sont-elles si laxistes ?
Depuis quelques années, on assiste en effet à une multiplication des contenus illicites partagés sur internet et les réseaux sociaux, phénomène lié aux difficultés à contrôler et à modérer de tels espaces. La diffusion par ce biais d’images de violences perpétrées contre des animaux n’échappe malheureusement pas à ce constat.
Notre droit est pourtant loin d’être laxiste. Notre code pénal réprime sévèrement de nombreux comportements conduisant à faire souffrir sans nécessité des animaux. Ainsi, les mauvais traitements, les sévices graves ou actes de cruauté, les atteintes sexuelles ou les atteintes volontaires à la vie de l’animal en dehors de toute activité légale sont des délits passibles de peines d’emprisonnement (allant de 1 à 3 ans) et d’amende (entre 7 500 euros et 30 000 euros max.).
Ces peines peuvent même être augmentées en cas de circonstances aggravantes, par exemple, si un acte de cruauté conduit à la mort de l’animal, la peine passe à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende. Les atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité de l’animal ou encore le défaut de soins à l’égard de l’animal sont pour leur part sanctionnés au titre des contraventions par des peines d’amende.
Il est à noter que pour le cas d’un contenu partagé, par exemple, sur les réseaux sociaux, il est aussi prévu que le simple fait d’enregistrer volontairement par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit des images de tels traitements infligés à un animal constitue un acte de complicité. Enfin, le fait de diffuser sur internet de telles images est passible d’une peine de 2 ans de prison et de 30 000 euros d’amende.
Si le dispositif légal est donc plutôt dissuasif, les difficultés tiennent plus à l’identification des auteurs de telles infractions pénales et à leur poursuite devant un juge. Face à un contenu illicite partagé sur les réseaux sociaux mettant en scène la maltraitance animale, il convient de faire un signalement auprès de la police ou à la gendarmerie, notamment via la plateforme Pharos. Outre cette démarche, il est également possible de s’adresser à des associations de protection animale, qui peuvent saisir le Procureur de la République et se constituer partie civile le cas échéant (article 2-13 du code de procédure pénale).
Ainsi, par exemple, à la suite d’une vidéo filmée avec un téléphone portable et postée en ligne sur Facebook montrant un jeune homme de 24 ans jetant violemment un chaton de 5 mois contre un mur puis dans des buissons, c’est grâce à la mobilisation des internautes que la gendarmerie a pu procéder à l’identification et à l’arrestation de l’auteur des faits qui a été jugé en comparution immédiate et a écopé d’une peine d’un an de prison ferme.
Textes applicables
Marguénaud Jean-Pierre, Leroy Jacques, Boisseau-Sowinski Lucille, Boyer-Capelle Caroline, Chevalier Émilie, Nadaud Séverine (co-auteurs). Code de l’animal. Paris : LexisNexis, 2018, 1058 pages. (Les codes bleus)
Garric Audrey. « Le premier code juridique de l’animal voit le jour en France ». Le Monde, 2018.
Disponible sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/21/le-premier-code-juridique-de-l-animal-voit-le-jour-en-france_5274284_3244.html
Lecoq Gauthier. « La protection pénale des animaux ». Village de la justice, février 2022. Disponible sur : https://www.village-justice.com/articles/protection-penale-des-animaux,39915.html
Comment signaler une maltraitance animale et quelles sont les sanctions ?
« Comment signaler une maltraitance animale et quelles sont les sanctions ? ». Octobre 2023. Service Public.
Disponible sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31859
« La cruauté animale a-t-elle sa place sur les réseaux sociaux ? ». Octobre 2014. 30 Millions d’amis.
Disponible sur : https://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/8009-la-cruaute-animale-a-t-elle-sa-place-sur-les-reseaux-sociaux/
Neumann Jean-Marc (propos recueillis par Audrey Garric). « Chaton torturé : “Une condamnation exemplaire” ». Le Monde. 2014.
Disponible sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2014/02/03/chaton-torture-une-condamnation-exemplaire_4359214_3244.html
Plateforme ministérielle Pharos pour signaler un contenu illicite de l’Internet : https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/
Severine Nadaud
Enseignante-chercheuse membre de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ UR 14476). Juriste spécialisée en matière de protection des droits de l’Homme face aux nouveaux enjeux climatiques et énergétiques. Responsable du Master 2 Droit international et comparé de l’environnement et du DU de droit animalier.
Qu’apporte la loi du 30 novembre 2021 aux animaux ?
La loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, aussi appelée loi Dombreval, constitue une réponse aux attentes sociétales fortes en faveur de l’amélioration de la condition animale. Elle a d’ailleurs été adoptée par 332 voix pour, 1 contre et 10 abstentions.
Cette loi s’inscrit en effet dans un mouvement législatif plus large qui tend à reconnaitre et mieux prendre en compte la sensibilité des animaux. De la Loi Grammont de 1850 jusqu’à l’importante réforme de notre Code civil en 2015, le statut juridique des animaux a beaucoup évolué. Ils ne relèvent plus de la catégorie des biens meubles et sont considérés non plus comme des choses, mais comme des êtres vivants dotés de sensibilité, protégés à ce titre par des textes spécifiques.
La loi du 30 novembre 2021, qui fait partie des textes protecteurs spécifiques, comprend 3 volets distincts.
(1) Ce texte comporte tout d’abord de nombreuses dispositions visant à prévenir et lutter contre l’abandon des animaux de compagnie en faisant prendre conscience aux propriétaires ou futurs propriétaires que les animaux de compagnie sont des êtres vivants ayant des besoins spécifiques, et qu’ainsi des responsabilités particulières leur incombent. La loi prévoit pour ne citer que quelques exemples l’interdiction de la vente de chiens et de chats en animalerie, l’encadrement très strict des offres de cession d’animaux de compagnie via un site internet, l’exigence d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce à laquelle l’animal de compagnie appartient, la sensibilisation des scolaires, etc.
(2) La loi Dombreval comprend également un volet très important sur la lutte contre la maltraitance animale, puisqu’elle amplifie significativement la protection pénale des animaux en durcissant les peines prévues par le code pénal pour certains comportements, notamment tels en cas de sévices graves, d’actes de cruauté ou d’abandon envers un animal domestique, apprivoisé ou en captivité (désormais punis de 3 ans de prison et 75 000 euros d’amende). De même, le fait de donner volontairement la mort à un tel animal, qui était jusque-là une simple contravention, devient désormais un délit (puni de 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende). On peut aussi noter que sont également créées par ce texte de nouvelles infractions destinées à réprimer les actes de zoophilie et la zoopornographie.
(3) Ce texte permet enfin de consacrer des avancées en faveur de la protection des animaux sauvages captifs en interdisant à échéance plus ou moins longue les delphinariums et les établissements de spectacles de cétacés, l’élevage des visons et autres espèces d’animaux non-domestiques élevées pour leur fourrure, l’utilisation d’animaux sauvages dans les cirques itinérants, mais aussi en définissant et en encadrant les refuges et les sanctuaires pour animaux sauvages captifs.
LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes (JORF n°0279 du 1 décembre 2021, Texte n° 1) Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2021/11/30/2021-1539/jo/texte
Romeiro Dias Laëtitia. Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale déposée le 14 décembre 2020. Disponible sur : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/maltraitance_animale
Voir aussi
« Une proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale définitivement adoptée par le Parlement ». Le Monde. Novembre 2021.
Disponible sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/18/le-parlement-adopte-definitivement-la-proposition-de-loi-contre-la-maltraitance-animale_6102557_3244.html
« Loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes » Disponible sur : https://www.vie-publique.fr/loi/278249-loi-2021-lutte-contre-la-maltraitance-animale
Travaux universitaires en droit animalier
Marguénaud Jean-Pierre, Leroy Jacques, Boisseau-Sowinski Lucille, Boyer-Capelle Caroline, Chevalier Émilie, Nadaud Séverine (co-auteurs). Code de l’animal. Paris : LexisNexis, 2018, 1058 p. (Les codes bleus) ISBN : 978-2-7110-2653-1
Garric Audrey. « Le premier code juridique de l’animal voit le jour en France ». Le Monde, 2018.
Disponible sur : https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/21/le-premier-code-juridique-de-l-animal-voit-le-jour-en-france_5274284_3244.html
Burgat Florence, Leroy Jacques, Marguénaud Jean-Pierre. Le droit animalier. Presses Universitaires de France, 2016, 262 pages.
Marguénaud Jean-Pierre. L’animal en droit privé. PULIM, 1992, 577 pages.
Boisseau-Sowinski Lucille. La désappropriation de l’animal. PULIM, 2013, 416 pages.
Documentaire
Bensadoun Sophie, « Vivant et sensible, l’animal aux yeux de la loi », 52 minutes, 2021 (diffusé sur France 3 Nouvelle-Aquitaine le 11 mai 2022).
Résumé : « Le statut juridique de l’animal est flou : il n’est plus considéré comme un bien depuis 2015, mais comme un « être vivant doué de sensibilité », ce qui donne lieu à de multiples interprétations et entrave sa défense et sa protection. Précurseur en France, l’Université de Limoges a créé un diplôme universitaire sur le droit animalier. L’occasion de s’interroger sur la condition animale par ce prisme, en suivant certains des participants pendant leur cursus et lors de l’exercice de leur métier ».
Severine Nadaud
Enseignante-chercheure membre de l’Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques (OMIJ UR 14476) Juriste spécialisée en matière de protection des droits de l’Homme face aux nouveaux enjeux climatiques et énergétiques Responsable du Master2 Droit international et comparé de l’environnement et du DU de droit animalier
Comment lutter contre les pollutions multiples (industrie, etc.) affectant le monde entier dont les océans ?
En tant qu’individu, vous pouvez rechercher des groupes et des associations que vous pouvez joindre et soutenir qui luttent pour protéger les océans contre les polluants et autres menaces. Par exemple, Greenpeace est l’un de ces groupes.
Nous pouvons tous changer nos habitudes et réduire notre consommation de produits qui contribuent à la pollution qui finit par avoir un effet sur l’océan. Par exemple, nous pouvons faire du vélo ou prendre un train au lieu de conduire une voiture à essence ou diesel pour aider à réduire les émissions de dioxyde de carbone, qui ont pour effet de rendre les océans plus acides.
Nous pouvons tous faire nos recherches pour décider quel parti politique favorise les priorités environnementales et voter pour ce parti.
Jamie Linton
Enseignant-chercheur à l’Université de Limoges depuis 2013. Politologue et géographe de formation, son principal domaine de recherche porte sur les relations entre l’homme et l’eau.
Risques de sécheresse : quelles conséquences sur l’agriculture ?
La sécheresse a un impact direct sur l’agriculture car elle rend moins d’eau disponible pour la production agricole. Les conséquences varieront d’un endroit à l’autre selon les circonstances :
Dans les endroits où les pratiques agricoles ont évolué pour s’adapter aux sécheresses et aux conditions arides, l’impact sera moindre. Pour cela, les agriculteurs cultivent des cultures moins gourmandes en eau comme le sorgho, le soja, la carotte, le panais, les betteraves ou encore l’oignon.
Cependant, dans les endroits où l’agriculture est particulièrement vulnérable au manque d’eau, les impacts seront plus graves. Par exemple, les agriculteurs qui pratiquent l’irrigation intensive, la culture de graines gourmandes en eau ou l’élevage industriel seront fortement impactés. Dans le contexte du changement climatique, cela pourrait avoir comme effet d’encourager l’adoption de pratiques et techniques agricoles moins gourmandes en eau et plus durables.
À titre d’exemple de projet de recherche lié à cette question, nous étudions actuellement l’histoire de l’élevage ovin en région Nouvelle-Aquitaine pour tenter de comprendre comment la sélection de différentes races et les pratiques traditionnelles ont pu impacter les ressources en eau de différentes manières :
– PastEauRal. Geolab. 2021. Disponible sur : https://geolab.uca.fr/geolab/actualites/pasteaural#/admin
– « Programme Pasteaural : deux journées en Haute-Vienne pour “avoir un autre regard sur l’eau” ». Le Populaire du Centre. 2022. Disponible sur : https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/programme-pasteaural-deux-journees-en-haute-vienne-pour-avoir-un-autre-regard-sur-leau_14101000/
Le modèle industriel moderne de l’agriculture est basé sur la présomption que la technologie et l’ingénierie peuvent toujours augmenter l’approvisionnement en eau. La sécheresse nous enseigne qu’il faut adopter des modèles plus attentifs à la réduction de la demande.
Jamie Linton
Enseignant-chercheur à l’Université de Limoges depuis 2013. Politologue et géographe de formation, son principal domaine de recherche porte sur les relations entre l’homme et l’eau.
Que faire des eaux usées ?
Les eaux usées renferment différents constituants qui peuvent être valorisés. Il y a quatre voies de valorisation envisageables :
1/ L’eau
On parle de plus en plus de la réutilisation des eaux usées. Elles contiennent de l’eau et leur retour dans le cycle de l’eau constitue déjà une voie de valorisation. Un projet de ce type existe déjà et s’appelle « Jourdain ». Il renvoie à la pièce du Bourgeois Gentilhomme. En rejetant les eaux usées dans le milieu naturel, nous faisons de la réutilisation des eaux usées depuis toujours comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir depuis toujours ! Ces eaux usées rejoignent les eaux de surface ou les eaux souterraines et contribuent ainsi au cycle de l’eau.
2/ Énergie
Les eaux usées renferment des matières organiques, à base de carbone organique. Ce carbone peut être utilisé pour produire de l’énergie, si les matières ou effluents collectés sont assez concentrés. On peut produire du méthane à partir de leur décomposition, leur minéralisation dans un milieu sans oxygène (on parle de méthanisation ou de digestion anaérobie).
Les boues produites à partir du traitement des eaux usées peuvent être méthanisées. Ces boues, si elles sont concentrées suffisamment, en atteignant des teneurs en eau assez faibles (siccité supérieure à 25%), peuvent servir de combustibles pour des unités de valorisation énergétique de déchets (on ne parle plus d’incinérateur). Les boues d’épuration peuvent rentrer dans la composition de ce qui est appelé des combustibles solides de récupération.
Via des échangeurs, il est possible de valoriser la chaleur des eaux usées, qui ont une température comprise en 15 °C et 25 °C.
La force motrice de l’eau est parfois utilisée au niveau de chutes d’eau présentes dans les filières de traitement des eaux usées.
3/ Amendement des sols
Les matières organiques contenues dans les boues d’épuration, mélangées avec d’autres supports carbonés (déchets verts, etc.) peuvent être utilisées pour faire du compost. Le compost est précieux pour améliorer la qualité des sols permettant ainsi d’augmenter leur capacité à stocker l’eau et les minéraux nécessaires à la croissance des plantes.
4/ Fertilisants
Les eaux usées, en particulier les urines, sont riches en azote C’est un élément majeur pour la croissance des végétaux. De même, le phosphore est présent en quantité assez importante dans les urines et les matières fécales. C’est un nutriment encore plus précieux que l’azote car il s’agit d’une ressource considérée comme en voie d’épuisement. Ces deux éléments, combinés avec du magnésium, peuvent permettre de produire de la struvite. La struvite est un minerai qui a des caractéristiques similaires à celles d’engrais commerciaux.
Pottier Catherine. « “Jourdain” : un projet pilote en Europe, pour transformer les eaux usées en eau potable » [podcast]. Franceinfo. 21 mai 2022. 3 min. Disponible sur : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/au-fil-de-l-eau/jourdain-un-projet-pilote-en-europe-pour-transformer-les-eaux-usees-en-eau-potable_5122858.html
« Vendée Eau, avec le concours de Veolia, prépare l’avenir à travers son programme Jourdain, première expérience en France et en Europe de traitement des eaux usées pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable sur le territoire vendéen ». Veolia. 2021. Disponible sur : https://www.veolia.com/fr/nos-medias/actualites/vendee-eau-concours-veolia-prepare-lavenir-travers-son-programme-jourdain
Eme Claire, Boutin Catherine. Composition des eaux usées domestiques par source d’émission à l’échelle de l’habitation : Étude bibliographique [Rapport de recherche]. IRSTEA. Décembre 2015, 90 pages. Disponible sur : https://hal.inrae.fr/hal-02605815/document
Davoisine Nathalie. « Les boues d’épuration : comment les traiter pour mieux les réduire ou les valoriser ? ». Le Centre d’information sur l’eau. Disponible sur : https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/ressource-en-eau-eau-potable-eaux-usees/boues-epuration-reduire-valoriser/
Martin Tristan. Valorisation des urines humaines comme source d’azote pour les plantes : une expérimentation en serre. Rapport de Master 2 Systèmes Aquatiques et Gestion de l’Eau. Institut National de la Recherche Agronomique & École Nationale des Ponts et Chaussées. 2017. Disponible sur : https://www.leesu.fr/ocapi/wp-content/uploads/2018/06/Martin_2017_Stage_Urine_Engrais_INRA.pdf
« Recycler le phosphore des eaux usées en engrais valorisable : Phosphogreen ». Suez. Disponible sur : https://www.suezwaterhandbook.fr/technologies-degremont-R/traitement-des-boues/valorisation/recycler-le-phosphore-des-eaux-usees-en-engrais-valorisable-Phosphogreen
Véronique Deluchat
Enseignante-Chercheuse à l’université de Limoges. Enseigne le traitement des eaux usées et des boues. Ses travaux de recherche concernent actuellement la mobilité du phosphore dans l’environnement, dans le contexte du traitement des eaux usées, mais aussi au sein des retenues, en relation avec les problématiques d’eutrophisation.
Changement des systèmes d’assainissement ?
Les systèmes d’assainissement ont changé au cours du temps en fonction des problématiques considérées dans les eaux usées, ce qui a évolué au cours du temps [1, 2].
1/ Problèmes sanitaires liés aux maladies hydriques (choléra, typhoïde…) : La solution à cette problématique a été d’éviter le contact des personnes avec les germes infectieux présents dans les eaux usées. Les Hommes collectaient les eaux usées et les évacuaient via des canalisations (égouts) à l’aval des villes, comme dès l’Antiquité avec les Cloaca Maxima. De nombreuses villes ont continué ainsi jusqu’à la fin du XXe siècle, et en particulier en bord de mer, où ils évacuaient les eaux via un émissaire de quelques kilomètres en mer.
2/ Problème d’impact sur les milieux naturels : Les stations de traitement des eaux usées (STEU) permettent de retenir et d’éliminer les matières responsables de la dégradation de la qualité des eaux des milieux naturels : appauvrissement du milieu en oxygène (pollution carbonée), envasement (pollution particulaire), effet de toxicité immédiate (matières inhibitrices, avec polluants métalliques ou certains polluants organiques) et baisse de la biodiversité.
Pour éviter ces problèmes, les premières STEU ont été mises en service à partir du milieu du XXe siècle en France avec le traitement des pollutions carbonées et particulaires dans des systèmes d’assainissement collectif et non collectif (création d’une STEU par boues activées en forte charge, avec une décantation primaire à la fin des années 1960 à Limoges).
Les matières inhibitrices sont produites par les activités industrielles et ces pollutions ont été écartées à la source, avec la mise en place de stations de traitement d’eaux sur les sites industriels.
3/ Problème d’eutrophisation [3] : Apparu dans les années 80, avec le développement massif de macrophytes ou d’espèces phytoplanctoniques (bloom algaux, efflorescences à cyanobactéries), l’eutrophisation est causée par l’enrichissement des milieux en azote et en phosphore. Ainsi, la majorité des STEU ont été réhabilitées à partir des années 90. Les filières de traitement ont été révisées afin de permettre le traitement des pollutions azotée et phosphorée. La STEU de Limoges a été réhabilitée à la fin des années 90 (procédé boues activées avec zones anaérobie, anoxie et aérobie ; fonctionnement en aération prolongée, augmentation du volume des bassins d’aération ; abandon des décanteurs primaires).
4/ Problème des pollutions chroniques : Élimination de substances ayant des effets à long terme (métaux, pesticides, perturbateurs endocriniens…).
Pour éliminer ces polluants responsables de phénomènes de toxicité directe et indirecte, de nouvelles étapes de traitement pourraient être ajoutées dans certaines STEU, avec l’utilisation de procédés jusqu’ici réservés à la potabilisation des eaux, tels que l’adsorption sur charbon actif, l’oxydation avancée (ozonation, seule ou couplée avec du peroxyde d’hydrogène…), cependant cela n’est pas encore mis en place car coûteux !
Ces traitements sont installés dans les STEU de certains pays (ex. Suisse). En France, une phase de surveillance de la présence de ces polluants à l’entrée et à l’aval des STEU est en cours pour faire un état des lieux. Il sera préférentiellement recherché d’éliminer ces polluants à la source.
5/ Empreinte carbone du traitement des eaux usées : Les systèmes d’assainissement actuels sont très énergivores, il est envisagé de trouver des solutions permettant de limiter la consommation énergétique des dispositifs de traitement, de considérer l’empreinte carbone des matériels, matériaux et réactifs utilisés…
Quels sont les changements de vision ?
Depuis une quinzaine d’années, il y a un changement de paradigme, au lieu de voir les constituants des eaux usées comme des nuisances, leurs avantages et leurs atouts sont aujourd’hui pris en compte (½ verre vide ; ½ verre plein).
La pollution carbonée est responsable de l’appauvrissement des milieux aquatiques en oxygène dissous, mais elle peut aussi être une source d’énergie. Cela amène à réviser les filières de traitement en favorisant la décantation primaire qui permet de récupérer des boues ayant un pouvoir méthanogène élevé et d’éliminer une partie de la pollution carbonée par décantation avec une dépense énergétique limitée.
La méthanisation des boues des stations d’épuration permet de produire du biogaz riche en méthane, qui constitue une source d’énergie renouvelable. La STEU de Limoges est ainsi en cours de réhabilitation avec une révision de la filière de traitement (installations de décanteurs primaires et limitation du volume des bassin d’aération) pour réduire la consommation énergétique et produire du biogaz, dont le méthane après purification, qui sera injecté dans le réseau de gaz de ville.
Les graisses étaient traitées par voie aérobie, avec une consommation d’oxygène et une dépense d’énergie importante. Aujourd’hui le traitement des graisses est davantage envisagé par voie anaérobie (digesteur anaérobie), avec une récupération d’énergie via la production de biogaz ou pour la production de biocarburant [4].
L’azote et le phosphore présents dans les eaux usées sont responsables de l’eutrophisation, mais aussi ce sont aussi des fertilisants précieux pour l’agriculture, qui pourraient être collectés via la production de struvite [5]
Véronique Deluchat
Enseignante-Chercheuse à l’université de Limoges. Enseigne le traitement des eaux usées et des boues. Ses travaux de recherche concernent actuellement la mobilité du phosphore dans l’environnement, dans le contexte du traitement des eaux usées, mais aussi au sein des retenues, en relation avec les problématiques d’eutrophisation.
Eaux cachées : rappel de systèmes anciens ?
Nous pouvons apprendre beaucoup de la manière dont les Hommes ont utilisé et géré l’eau dans le passé.
En général, l’obtention et le transport de l’eau étaient plus onéreux qu’aujourd’hui. Nos technologies modernes, nos pratiques d’ingénierie et surtout notre utilisation moderne de l’énergie, rendent l’eau et les services d’eau plus facilement accessibles pour nous qu’ils ne l’étaient pour nos ancêtres. Tout cela pour dire que l’eau était généralement plus rare et précieuse dans le passé qu’elle ne l’est aujourd’hui. Et par conséquent, l’eau était généralement utilisée avec plus de prudence et moins de gaspillage. C’est quelque chose que nous pouvons apprendre aujourd’hui. Par exemple, les différentes qualités des eaux de différents endroits ont été notées et les gens ont prêté attention à ces différences.
Les anciens aqueducs de l’époque gallo-romaine maintenaient souvent les eaux des sources distinctes dans des conduits séparés. Ainsi, par exemple, l’eau propre à la consommation n’était pas gaspillée pour des usages nécessitant moins d’eau pure, comme dans de nombreux usages industriels. L’étude de l’utilisation de l’eau et des systèmes d’eau du passé montre comment nos ancêtres étaient généralement beaucoup plus attentifs à la présence d’eau dans leur environnement immédiat que nous ne le sommes aujourd’hui.
Aujourd’hui, la plupart d’entre nous ne savent même pas d’où vient notre eau potable. Une telle ignorance était impossible dans le passé, où les liens des peuples avec l’eau et les technologies de l’eau étaient plus directs et plus évidents. Évidemment, l’ignorance de nos ancêtres sur des choses telles que la transmission bactérienne des maladies et les impacts écologiques de la pollution de l’eau signifie qu’il y a de nombreux aspects de la gestion ancienne de l’eau que nous ne souhaiterions pas adopter.
Néanmoins, le haut niveau d’appréciation et de respect pour l’eau qui prévalait dans le passé, comme en témoignent les systèmes d’eau historiques, est quelque chose que nous ferions bien de restaurer aujourd’hui.
Pour quelques idées à ce sujet, nous pourrions nous référer à un projet de recherche que nous avons organisé : https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/programme-pasteaural-deux-journees-en-haute-vienne-pour-avoir-un-autre-regard-sur-leau_14101000/
Jamie Linton
Enseignant-chercheur à l’Université de Limoges depuis 2013. Politologue et géographe de formation, son principal domaine de recherche porte sur les relations entre l’homme et l’eau.
Est-ce que les bactéries préhistoriques enfermées dans les glaces qui fondent pourraient faire un 2e ou 3e covid ?
Les virus et bactéries sont présents sur Terre depuis son origine il y a environ 3,5 milliards d’années. Ils y ont évolué, se sont adaptés et ont été confrontés aux grands cycles climatiques de notre planète. C’est ainsi que des micro-organismes se sont retrouvés emprisonnés et confinés dans la glace pendant des milliers d’années.
La fonte actuelle du permafrost (pergélisol en français) est une conséquence du réchauffement climatique et soulève aujourd’hui des questions sanitaires concernant la libération potentielle de micro-organismes « oubliés » (vulgarisés sous le terme de « zombie virus »). Le pergélisol est issu d’un phénomène géologique naturel et désigne la partie d’un cryosol gelée en permanence (au moins pendant 2 ans) et imperméable.
La fonte accélérée de ces sols gelés met au jour des restes humains, d’animaux ou de végétaux contenant potentiellement des virus ou des bactéries encore vivants.
Dans le cas des virus, le risque paraît très limité. Si la décongélation lente et superficielle du pergélisol relargue d’anciens virus, ils seront rapidement détruits sous l’action stérilisante des UV et de l’O2. Ces virus seront donc très rapidement inactivés s’ils ne rencontrent pas leur hôte.
En revanche, concernant les bactéries, le risque peut-être plus élevé, et en particulier, pour les bactéries capables de sporuler. La sporulation est une forme de résistance que possèdent certaines bactéries et qui leur permet de survivre et de résister à des conditions particulièrement hostiles pendant très longtemps. Lorsque les conditions environnementales redeviennent favorables, elles sont alors capables de se multiplier à nouveau. L’exemple de la persistance de spores de la bactérie Bacillus anthracis dans les couches superficielles de pergélisol est un cas assez documenté. La résurgence de cette bactérie responsable de la maladie du « charbon » serait à l’origine d’épidémies de troupeaux de rennes en Sibérie.
Pour terminer ma réponse sur un aspect plus positif, il n’est pas dit que les micro-organismes présents dans la glace soient nécessairement nuisibles. Il est peut-être possible de trouver des espèces ayant des propriétés utiles, par exemple dans le domaine médical (indications sur les mécanismes de résistance aux antibiotique) et biotechnologique (propriétés enzymatiques actives à basse température).
Claverie Jean-Michel et Abergel Chantal. « Risques sanitaires liés au réchauffement de l’Arctique : fantasmes et réalités ». A3 Magazine : Rayonnement du CNRS, 2021, n°77, p 32-37. Disponible sur : https://www.igs.cnrs-mrs.fr/wp-content/uploads/2023/03/ArcticRisque2021.pdf
Gilichinsky David et al. “Long-term preservation of microbial ecosystems in permafrost”. Advances in space research, 1992, vol. 12, p. 255-263.
Audrey Prorot
Enseignante-chercheuse à l’ENSCIL-ENSCI. Laboratoire E2Lim (UR 24133).
Isabelle Bourven
Enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges au département chimie. Licence professionnelle Traitement des Eaux.
Comment peut-on manquer d’eau sachant qu’il y a un cycle ?
• Réponse de Jamie Linton
L’une des leçons les plus importantes que nous apprenons de la science est qu’il peut y avoir (et il y a souvent) plus d’une réponse à une même question. Souvent, la réponse dépend des méthodes particulières que l’on utilise pour interpréter la question, pour définir les phénomènes pertinents et pour examiner le problème en question. Il est donc tout à fait normal que cette question suscite des réponses différentes.
De ma perspective, la réponse à la question « Comment peut-on manquer d’eau sachant qu’il y a un cycle ? » dépend de « l’on » qui le pose. En d’autres termes, le manque d’eau est un problème subjectif et relatif. Vivant seul dans un appartement en ville, mes besoins en eau pourraient se limiter aux 20 ou 30 litres par jour que j’utilise pour le ménage, la cuisine et le bain. Cependant, mon ami, qui est agriculteur au sud de Limoges, a des besoins en eau très différents des miens. Les changements dans le régime saisonnier des précipitations qui constituent une crise hydrique pour mon ami pourraient ne pas être une menace du tout pour moi. De même, une société qui a besoin d’énormes quantités d’eau pour faire tourner son économie sera confrontée au problème de manquer d’eau plus tôt et différemment d’une société qui a besoin et utilise moins d’eau. Aujourd’hui, nous avons construit une société et une économie qui dépendent énormément d’énormes quantités d’eau. Le cycle hydrologique continuera de fonctionner tant que le soleil continuera de l’alimenter, et l’eau continuera de couler. Mais tout changement dans le flux – comme ceux associés au réchauffement climatique – aura un effet négatif sur nous en raison de notre dépendance. Notre habitude d’utiliser de grandes quantités d’eau fait que nous avons peu de résilience face à ces changements.
Une autre façon de répondre à cette question est de dire que nous avons construit nos économies, nos infrastructures et nos sociétés sur la présomption d’un cycle de l’eau stable et immuable. Cela signifie que tout changement – même minime – de choses comme les précipitations, le débit ou les taux d’évaporation nous causera des problèmes. La gravité de ces problèmes dépendra de la résilience de nos économies, de nos infrastructures et de nos sociétés face aux changements. C’est pourquoi on entend de plus en plus les planificatrices/eurs et les gestionnaires parler de la nécessité de développer une plus grande résilience.
• Réponse de Michel Baudu
De quoi parle t-on ? D’une manière générale les usages humains demande une eau douce. Les eaux douces sont peu nombreuses sur la planète : 2.8 % des eaux, soit 35 millions de milliards de m3 ! Toute cette eau douce est-elle disponible : pas vraiment la plus grande part est sous forme de glace au pôle (2.15%) et il reste donc facilement mobilisable les eaux de surface (0.019%) et dans une moindre mesure les eaux souterraines (0.63%). L’eau atmosphérique est en équilibre avec l’eau liquide en surface et représente très peu d’eau : 0.001%. C’est donc une toute petite partie de l’eau rentre dans un cycle par évaporation des eaux de surface (les eaux souterraines ne rentrent pas dans ce cycle) et un retour par condensation (les pluies). Une partie de l’eau de pluie est captée par les plantes, une autre alimente les nappes souterraines et une autre s’accumule ou ruissèle vers les océans. On considère que les précipitations annuelles sont de 113 000 km3 avec une évaporation de 73 000 km3. Donc 40 000 km3 pourrait être disponible (2).
Mais si l’eau s’inscrit dans un cycle et si la quantité totale n’a pas changée depuis trois milliards d’années, on peut considérer que si rien ne change et que sa disponibilité est la même…. Et pourtant on manque d’eau sur notre planète et apparemment de plus en plus, et donc plus précisément d’eau douce mobilisable. Donc c’est que quelques choses à changer : deux choses ont changées.
Les besoins en eau augmentent. La consommation totale en eau sur la planète est de 4 milliards de m3 par an soit 127 m3 par seconde (doublée en 40 années). La consommation moyenne en est de 137 litres par habitant et par jour (eau directe + eau virtuelle*) (UNICEF) pour une répartition suivante : 70% pour l’irrigation – agriculture, 22% sont utilisés pour les activités industrielles, 8% sont utilisés pour un usage domestique. Cette consommation représente donc 10% (4/40) mais sur les 40 000 km3 on considère que seulement 35% peuvent être stocké.
Cette consommation a doublé entre 1960 et 2000, alors que la croissance de la population mondiale diminue depuis 1970 mais reste aux environs de 1% annuellement soit 80 millions d’individus en plus par an. L’essentiel de l’eau mobilisée pour la production alimentaire est apporté par la pluie mais reste rependant 25% apportée par irrigation soit 900 km3 pour un prélèvement réel de 2 500 km3 (sur 7 millions de Km3 disponible = 0.035%). L’irrigation augmente et selon les continent celle-ci pourra représenter en 2040 jusqu’à 45% de l’eau disponible (renouvelable) et entre 1900 et 2010 le prélèvement a été multiplié par 8 (3)!!!
Entre 1996 et 2005, 9 087 milliards de mètres cubes d’eau ont été consommés chaque année à travers la planète. L’agriculture prélève 69% de l’eau douce de la planète (4) notamment du fait de l’irrigation intensive des céréales telles que le maïs, le blé ou le riz (27 % de l’utilisation d’eau douce), ainsi que de la production de viande (22 %) et de produits laitiers (7 %).
Le réchauffement climatique dû à la pollution atmosphérique d’origine humaine est estimé aujourd’hui à 0,5°C. Il devrait atteindre probablement 2 degrés Celsius à l’horizon 2100. Or, la montée des températures, directement liée à la production de gaz à effet de serre (dont la vapeur d’eau), accélère le cycle hydraulique, en augmentant les niveaux de précipitations et d’évaporation. Cela se traduit par la fonte des glaciers et la montée du niveau des océans. Certains scientifiques vont même jusqu’à prédire une montée des eaux de 2 mètres dans 100 ans, ce qui signifie la disparition de terres agricoles. Ainsi, le réchauffement climatique contribue à multiplier les évènements climatiques extrêmes, tels que : des inondations, des sécheresses plus longues et plus intenses ou des périodes de canicules également plus longues et plus fréquentes…Tous ces phénomènes liés au dérèglement climatique concourent à rendre l’accès à l’eau plus difficile et à une dégradation de sa qualité (eaux saumâtres, eutrophisation, concentration des contaminants).
Bien que les ressources en eau devraient être suffisantes à horizon 2030 pour satisfaire les besoins domestiques à travers le monde, le problème tient aussi dans leur répartition entre notamment les pays pauvres et les pays riches (5). Ainsi l’eau s’est peu à peu transformée en « or bleu » et devient un véritable enjeu géopolitique pour les pays dont l’accès est rendu difficile (6).
Si on résume : la disponibilité mondiale en eau a été divisée par 3 entre 1950 et 2000 avec une forte augmentation des usages une hétérogénéité planétaire et des effets saisonniers de plus en plus marqués.
* quantité d’eau utilisée pour fabriquer un bien de consommation. Environ un cinquième de l’eau consommée dans le monde est ainsi de l’eau virtuelle, échangée entre les pays sous forme de produits agricoles ou industriels
James Linton
Enseignant-chercheur à l’Université de Limoges depuis 2013. Politologue et géographe de formation, son principal domaine de recherche porte sur les relations entre l’Homme et l’eau.
Michel Baudu
Professeur de l’Université de Limoges. Enseignant chercheur dans le laboratoire Eau et Environnement (E2Lim – UR 24133). Responsable au cours des années passées de formations et de projets de recherche sur la gestion et le traitement des eaux.
On parle d’une nouvelle limite atteinte celle de l’eau verte, de quoi s’agit-il ?
Les limites planétaires ont été définies comme les paramètres de l’écosystème de la Terre à préserver pour que l’humanité puisse continuer à vivre dans des conditions normales. En 2022, la limite de l’eau verte a été dépassée.
L’eau verte, contrairement à l’eau bleue (eau de lac, rivière, cours d’eau, nappes phréatiques…), est issue des précipitations ou de l’humidité des sols qui est absorbée par les végétaux et les micro-organismes présents dans la terre comme le mycélium des champignons.
Pour les plantes, l’eau est absorbée dans la solution du sol par les racines et elle remonte vers les parties aériennes où une grande partie est libérée dans l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau (évapo-transpiration). Les mycorhizes qui sont des champignons symbiotiques associés aux racines de beaucoup de plantes peuvent contribuer à l’absorption de l’eau au niveau du sol et facilitent le transfert vers les racines.
Ainsi, une grande partie de l’eau absorbée par les plantes ne fait que transiter dans la plante : on considère généralement qu’environ 90 à 95 % de l’eau absorbée par une plante est rejetée dans l’atmosphère. Si on considère un arbre, les volumes peuvent être très importants (ex. 200 litres/jour pour une journée ensoleillée).
Ainsi, la présence de la végétation impacte le cycle de l’eau et accroit fortement le transfert vers l’atmosphère de l’eau.
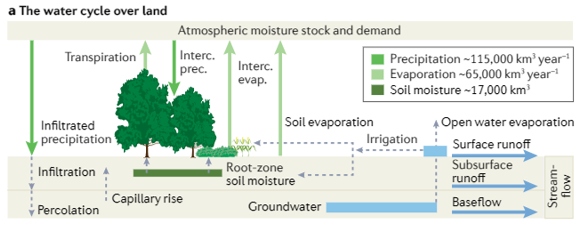
Par ailleurs, la présence des racines qui se développent profondément dans le sol et en modifient sa structure (apport d’humus…) contribue à limiter le ruissellement de surface et la lixiviation. Un exemple marquant est celui de la déforestation en Amazonie : les coupes rases provoquent un accroissement du ruissellement de surface et un moindre retour de l’eau vers l’atmosphère ce qui impacte le climat. De plus, le système racinaire des plantes est aussi un support pour beaucoup de micro-organismes du sol, la destruction de la végétation peut donc aussi affecter grandement l’équilibre de la microflore du sol.
Ainsi, l’Homme, de par ses activités notamment en termes d’exploitation forestière sans volonté de régénérer ces forêts, risque donc de modifier le cycle de l’eau et de réduire les ressources en eau bleue de bonne qualité. Des rivières et fleuves peuvent se trouver chargés en particules de sol que les eaux de surface auront lessivées. De ce fait, l’eau verte, c’est-à-dire l’eau transitant dans les plantes est donc un élément important du cycle de l’eau. Les activités anthropiques (déforestation, agriculture intensive, artificialisation des sols…) peuvent donc avoir un impact fort sur le cycle de l’eau et contribuer à modifier le climat ainsi que les disponibilités des ressources en eau bleue. Des chercheurs ont donc récemment émis l’idée de prendre en compte cette donnée – l’eau verte – et de l’évaluer afin de déterminer la limite à ne pas dépasser pour permettre de préserver les équilibres naturels et restreindre le changement climatique.
Des limites avaient déjà été franchies précédemment : le changement climatique, l’intégrité de la biosphère, les cycles biogéochimiques, le changement du système terrestre et, en janvier 2022, la pollution chimique.
Depuis le 26 avril 2022, une étude de chercheurs internationaux dirigée par le Stockholm Resilience Centre, publiée dans la revue américaine Nature, explique qu’une sixième limite planétaire vient tout juste d’être franchie : celle concernant le cycle de l’eau verte. Seules trois n’ont pas encore été franchies…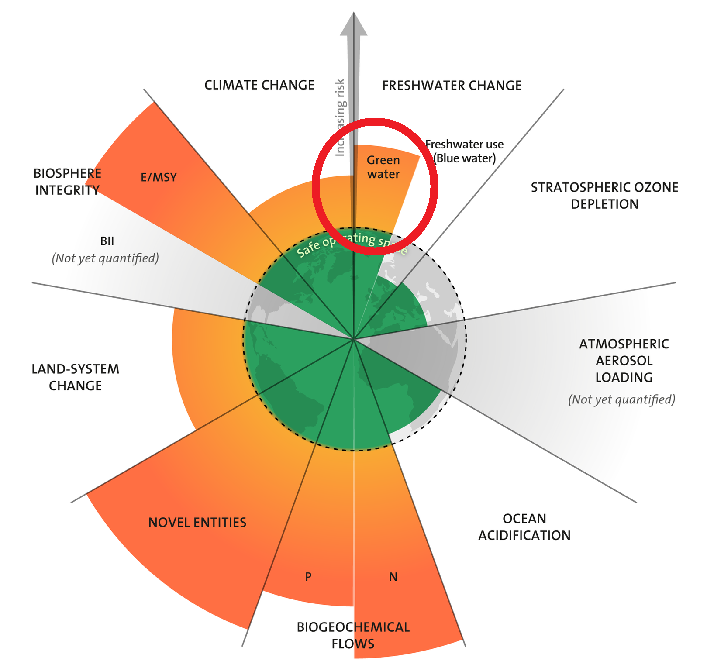
Wang-Erlandsson Lan et al. “A planetary boundary for green water”. Nature Reviews Earth & Environment. 2022, vol. 3, p. 380–392. Disponible sur : https://rdcu.be/cL78K
Céline Girard
Enseignante-chercheuse au laboratoire E2Lim (UR24133) et à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges.
On entend parler de micro-organismes toxiques dans l’eau, qu’est-ce que c’est ?
L’eau est un potentiel vecteur de pathologie parfois mortelle. Les agents immédiats responsables sont d’abord les micro-organismes hydriques. Or même de nos jours, malgré l’optimisation des traitements de l’eau pour la rendre potable, l’accès à une eau de consommation non dangereuse selon le paramètre microbiologique est un luxe dont seuls les pays industrialisés bénéficient pleinement.
Les agents responsables de pathologie hydrique sont du moins complexe au plus complexe les virus, les bactéries et les protozoaires. La plupart de ces micro-organismes sont responsables de gastroentérites plus ou moins sévères, c’est le cas du Rotavirus, des bactéries Salmonelles et Escherichia coli par exemple.
Certains micro-organismes provoquent des maladies spécifiques : des virus sont responsables de la polyomyélite ou d’hépatite A, le Choléra d’origine bactérienne touche 3 millions de personnes et tue encore plus de 90 000 personnes par an dans le monde.
Certains micro-organismes présentent des formes de résistance, c’est le cas des bactéries sporulantes telles que le Clostridium difficile ou les protozoaires Giardia, Cryptosorium et l’amibe Entamoeba. Il faut souligner que la pathogénicité est liée, pour les cas mentionnés, à la présence du micro-organisme dans l’eau.
Il existe aussi des micro-organismes toxiques, c’est-à-dire qu’ils émettent une substance appelée toxine qui, même en absence du micro-organisme, est responsable de pathologie. C’est le cas des cyanobactéries qui peuvent se développer très rapidement sur les plans d’eau pour former un tapis vert appelé efflorescence ou bloom.
Les cyanotoxines sont libérées dans l’eau à la mort des cyanobactéries et sont capables de provoquer la mort de poissons, d’oiseaux et d’animaux domestiques ou sauvages. En cas d’exposition chez l’Homme, les cyanotoxines, qui peuvent avoir des structures variées, provoquent différentes pathologies : des cas de gastro-entérites, d’affections hépatiques, de troubles rénaux et une augmentation de l’incidence de cancers colorectaux et hépatiques lors d’une exposition par l’eau de boisson, des cas d’éruption cutanée, d’allergies, de nausées, de vomissements, de diarrhées, de douleurs musculaires, de maux de tête, de pneumonie et de conjonctivites lors d’une exposition à l’occasion de baignades ou d’activités nautiques. Le développement des cyanobactéries est provoqué par une augmentation de la température et la présence de phosphate dans les plans d’eau.
Face à ces risques sanitaires, des outils sont mis en place pour « traquer » les micro-organismes pathogènes sur les plans d’eau récréatifs ou en sortie d’usine de traitement de l’eau potable. Ainsi les biologistes dénombrent deux bactéries appelées « traceurs de contaminations fécales » : Escherichia coli et l’Entérocoque dont la présence est corrélée à l’existence de micro-organismes pathogènes. De nouveaux outils vont être mis en place face à l’effet non optimum de la javel sur les formes résistantes de certains micro-organismes.
Ministère de l’industrie et de la recherche. Éléments de microbiologie des eaux. Rapport du Bureau de recherches géologiques et minières, Juin 1983. Disponible sur : http://infoterre.brgm.fr/rapports/83-SGN-386-EAU.pdf
« Analyses microbiologiques ». Suez.
Disponible sur : https://www.suezwaterhandbook.fr/eau-et-generalites/analyses-et-traitabilite-des-eaux/les-analyses/analyses-microbiologiques
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Évaluation des risques liés aux cyanobactéries et leurs toxines dans les eaux douces. Rapport d’expertise collective, 2020.
Disponible sur : https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2016SA0165Ra.pdf
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER). « Les microalgues toxiques, quels risques pour les humains ? ».
Disponible sur : https://www.ifremer.fr/fr/qualite-sanitaire/les-microalgues-toxiques-quels-risques-pour-les-humains
Audrey Prorot
Enseignante-chercheuse à l’ENSCIL-ENSCI. Laboratoire E2Lim (UR 24133).
Isabelle Bourven
Enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges au département chimie. Licence professionnelle Traitement des Eaux.
Thibaut Le Guet
Maître de Conférences à l’Université de Limoges. Ces travaux au sein du laboratoire E2Lim portent sur la qualité des eaux et le devenir des contaminants organiques dans les écosystèmes aquatiques. Également titulaire d’un master en Chimie et Microbiologie de l’eau, il intervient notamment dans des formations spécialisées (licence pro et master) en lien avec le traitement des eaux.
Est-il vrai que l’on trouve des traces d’antibiotiques dans l’eau ?
La France est le premier pays Européen et le deuxième pays au monde à consommer le plus de produits pharmaceutiques pour la santé humaine [1]. Elle est également le deuxième marché mondial en ce qui concerne la santé animale. En 2019, environ 422 tonnes d’antibiotiques vétérinaires ont été vendus en France (Anses-ANMV, 2020). La région Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole en France et en Europe. Les élevages d’animaux se concentrent sur le territoire du Limousin et concernent 63 % de l’agriculture (Chambre de l’Agriculture, 2015). Parmi ces exploitations animales, 26 % concernent les élevages d’ovins, 21 % de bovins et 12 % d’équins (Agreste, 2022). Les conséquences de l’utilisation en excès de ces médicaments sont aujourd’hui démontrées. Des problèmes d’antibiorésistance et de rémanence des molécules dans l’environnement sont observés ; notamment parce que la grande majorité des médicaments injectés sont rejetés de façon quasiment intacte dans les déjections animales avec des taux d’excrétion compris entre 40 et 90 % [1] [2] [3]. Des résidus pharmaceutiques vétérinaires sont ainsi retrouvés dans les écosystèmes terrestres et aquatiques par différentes voies de contamination. Les apports peuvent être diffus en prairie par lixiviation ou lessivage des fèces et des urines [3] [4] ou suite à l’épandage de fumier [5] [6]. En box, les apports peuvent s’accumuler dans les litières et se concentrer dans les eaux de lavage des stalles. Ces dernières sont souvent directement rejetées dans l’environnement, sans traitement et sont donc une source de transport des résidus pharmaceutiques vétérinaires solubilisés.
Pour limiter la quantité de médicaments utilisés, une nouvelle réglementation de l’Anses-ANMV datant du 28/01/2022 a été mise en place à l’Echelle Européenne afin d’établir une data-base regroupant les chiffres d’utilisation et les effets indésirables des médicaments vétérinaires dans les différents pays de l’Europe ; l’objectif étant de s’engager dans une utilisation plus raisonnée de ces produits pharmaceutiques.
Les produits pharmaceutiques peuvent être classés en différentes familles. Les trois principales familles comprennent les antibiotiques, les anti-inflammatoires et les antiparasitaires. Les antimycosiques, antifongiques, analgésiques, anesthésiants, diurétiques ou hormones restent également des familles de médicaments largement administrées. La famille des antiparasitaires est la plus vendue avec 33% du marché pharmaceutique vétérinaire suivie par les antibiotiques avec 10%. Les vaccins ne sont pas considérés comme des médicaments puisqu’ils ne contiennent pas de substances actives, cependant ils arrivent en deuxième position des ventes avec 23 % des parts (IPAC, 2022).
Selon l’OMS (2014), 50% des antibiotiques produits mondialement sont destinés aux animaux, un chiffre pouvant atteindre jusqu’à 80% aux Etats-Unis ou au Canada. En France, l’Anses-ANMV enregistre depuis 1999 les volumes des médicaments contenant des antibiotiques. Pour l’année 2019, 422 tonnes d’antibiotiques ont été vendus. La part de la filière porcine et bovine représente respectivement 33% et 28% des parts vendues soit 140,6 et 117,4 tonnes de médicaments pour l’année 2019.
Cette limitation dans l’utilisation des médicaments est principalement due à la découverte des résistances bactériennes aux antibiotiques et à la mise en place de plans d’action. En 2012, le premier plan Ecoantibio est proposé avec pour objectif initial de réduire de 25% l’utilisation de ces médicaments. A la fin de ces cinq années, une baisse d’exposition des animaux aux antibiotiques de 37% et une diminution jusqu’à 81% de l’utilisation de certaines familles d’antibiotiques critiques comme les Fluoroquinolones sont observées. Un second plan Ecoantibio de 2017 à 2022 a été donc suivi afin de consolider cet usage plus raisonné des médicaments et le volume total de vente d’antibiotiques a diminué de 1 015 tonnes en 2010 à 416 tonnes en 2020 (Anses, 2020).
En 2008, l’AFSSA a dressé une liste des molécules prioritaires à rechercher dans les eaux selon différents critères : quantité consommée, solubilité, activité, famille de médicament. Ces paramètres permettent de définir la criticité de chaque médicament selon sa dégradation ou sa rémanence dans les systèmes aquatiques.
Les milieux aqueux peuvent être contaminés, en fonction des conditions météorologiques par lessivage ou lixiviation des sols contaminés ou directement par recueil des eaux de lavages des box. Ces dernières ne sont pas traitées comme les eaux usées à usage humain mais souvent simplement rejetées dans les cours d’eaux.
La diffusion des résidus pharmaceutiques du sol vers le compartiment aqueux dépend des paramètres physico-chimiques des molécules. Les médicaments ayant une forte sorption avec le sol resteront adsorbés sur la matière organique du sol, ils seront transportés uniquement s’il y a mobilisation de cette matière organique mais ne se solubiliseront pas dans la solution du sol et dans l’eau. Les molécules ayant une faible sorption seront susceptibles de se disperser par lessivage. Une fois les eaux de surface contaminées, le devenir des résidus pharmaceutiques vétérinaires dépend encore des conditions physico-chimiques de chaque molécule.
Les substances pharmaceutiques peu solubles auront tendance à s’adsorber aux matières en suspension, sédimenter et s’accumuler dans les sédiments avec peu ou pas de retour vers la colonne d’eau. Ce sont alors les organismes benthiques qui seront exposés à un risque de toxicité. D’autres molécules, une fois dans la colonne d’eau, auront tendance à s’accumuler dans les biofilms plutôt que dans les sédiments pouvant ainsi induire une toxicité aux phytoplanctons.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.206. [2] Kümmerer Klaus. « Antibiotics in the aquatic environment – A review – Part I ». Chemosphere, 2009, vol. 75, no 4, p. 417‑434.DOI: 10.1016/j.chemosphere.2008.11.086. [3]. Charuaud Lise et al. « Veterinary pharmaceutical residues in water resources and tap water in an intensive husbandry area in France ». Science of the Total Environment, 2019, vol. 664, p. 605‑615.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.303 [4] Charuaud Lise et al. « Veterinary pharmaceutical residues from natural water to tap water: Sales, occurrence and fate ». Journal of Hazardous Materials, 2019, vol. 361, p. 169‑186.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.08.075 [5] Wohde Manuel et al., « Analysis and dissipation of the antiparasitic agent ivermectin in cattle dung under different field conditions: Dissipation of ivermectin in cattle dung and soil ». Environmental Toxicology Chemistry, 2016, vol. 35, no. 8, p. 1924‑1933. DOI: https://doi.org/10.1002/etc.3462 [6] Sands Bryony et Noll Madeleine. « Toxicity of ivermectin residues in aged farmyard manure to terrestrial and freshwater invertebrates ». Insect Conservation and Diversity, 2022, vol. 15, no 1, p. 9‑18. DOI : https://doi.org/10.1111/icad.12526
Geneviève Feuillade
Professeure à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges en Génie de l’Eau & Environnement, Geneviève Feuillade développe une recherche sur le comportement de polluants et de molécules organiques dans l’environnement. Elle a encadré à ce jour 18 doctorats et a publié plus de 60 articles dans des journaux internationaux.
Il y a-t-il du COVID 19 dans l’eau du robinet ou est-ce une légende urbaine ?
À l’origine de cette rumeur, certainement le fait que l’on ait trouvé des traces de génome de SARS-CoV-2 dans les eaux non potables de la ville de Paris qui proviennent notamment du Canal de l’Ourcq en 2020.
Non, il n’y a pas de SARS-CoV-2 dans l’eau du robinet.
En France, l’eau du robinet est de l’eau potabilisée[1] soumise à une surveillance normée et à des traitements de désinfection spécifique.
Les virus qu’on recherche dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, à l’origine des EDCH, sont principalement des virus entériques qu’on va retrouver dans les systèmes gastro-intestinaux et donc dans les effluents de stations d’épuration via les matières fécales. Ces virus entériques, non enveloppés, sont relativement résistants et ont donc été choisis comme indicateur de contamination. Le SARS-CoV-2 est un virus enveloppé, plus fragile, de type respiratoire, et plus sensible aux systèmes de traitements. Il est maintenant démontré que la capacité de réplication du virus est nulle à très limitée dans les selles et que la transmission fécale-orale est hautement improbable [2] ; de même pour sa présence viable dans les eaux à potabiliser et à fortiori dans les eaux potables ayant été soumises à des traitements de désinfection.
On retrouve cependant des traces de génome viral dans les fèces [3] : environ 47 % des personnes ayant eu le Covid ont du génome viral dans les selles et 18 %, auraient des symptômes gastro-intestinaux.
Mais attention, il s’agit de traces de génome et pas de virus viable : aucune étude au monde n’a trouvé de virus SARS-CoV-2 viables dans les selles.
Ainsi, de nombreuses études ont développé des méthodes d’épidémiologie sanitaire pour suivre la présence de traces de virus dans les eaux usées et avoir ainsi un indicateur de contamination urbaine et d’amplitude de la pandémie sur le territoire. En France, c’est le réseau Obépine qui a fédéré les différentes actions et diffusé les résultats. [4]
Oui, la présence du SARS-CoV-2 dans l’eau du robinet est une légende urbaine
Une légende urbaine est un récit anxiogène au contenu surprenant se transmettant de proche en proche, souvent par des moyens informels et qui actuellement bénéficient des apports des réseaux sociaux. Cela peut être totalement faux, avec des sous-jacents peu avouables, comme la rumeur d’Orléans (décrite par Edgar Morin [1]), fondée sur des théories complotistes, des fake-news, des hoax, ou reposant sur d’anciens mythes.
Donc la réponse à la question est oui : la présence du Covid dans l’eau du robinet est une légende urbaine, ne s’appuyant pas sur des données scientifiques, étant angoissante et étant diffusée principalement au travers de médias et de réseaux sociaux.
Pour conclure, les virus de type SARS-CoV n’ont aucune raison de survivre dans les eaux à potabiliser. Ce type de virus, est fragile, à une très faible probabilité de se retrouver dans les eaux où sa survie est plus qu’aléatoire, et ne résistera pas aux différents traitements poussés dans les usines de traitement et de potabilisation. Il n’y a donc pas de virus SARS-CoV-2 viable détecté dans les eaux potables en France.
[1] Eau destinée à la consommation humaine (EDCH)Christophe Dagot
Professeur à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges en Génie de l’Eau & Environnement de l’Université de Limoges. Chargé de mission DD&RS (Développement durable et responsabilité sociétale). Chercheur dans l’UMR Inserm 1092 sur la contribution de l’environnement à la dissémination des bactéries résistantes aux antibiotiques. Participe à la surveillance du SARS CoV2 dans les eaux usées.
Risques de sécheresse : Quelles conséquences sur les énergies ?
La première source d’énergie électrique à être impactée par la sécheresse est l’hydroélectricité (des fleuves et des rivières). En effet, l’hydroélectricité fonctionne par la force motrice de l’eau qui va dépendre du débit et de la hauteur. La sécheresse va jouer sur ces deux facteurs. Les centrales nucléaires et thermiques nécessitent un système de refroidissement utilisant l’eau de fleuves, de rivières ou de mers.
Le refroidissement d’une centrale est produit par un apport continu d’eau froide pour liquéfier la vapeur d’eau issue de la turbine et lui permettre de produire sans arrêt de l’électricité.
Deux systèmes pour refroidir les réacteurs nucléaires existent :
– Circuit ouvert (26 réacteurs dont 12 sur fleuves) [5] : ils ont besoin d’un volume d’eau important, 100 à 150 L/MWh, mais relâchent la quasi-totalité des volumes utilisés dans les fleuves ou océans, et seulement 0,3 L/MWh est évaporé ;
– Circuit fermé (30 réacteurs) [5] : ils disposent d’une tour aéroréfrigérante qui permet de disperser la chaleur produite dans l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau. Ils utilisent 6 à 8 L/MWh, et 2,4 à 3,2 L/MWh s’évaporent.
Deux facteurs liés à la sécheresse peuvent engendrer des diminutions ou carrément l’arrêt de réacteurs nucléaires :
– Le débit des cours d’eau ne permettant pas d’avoir un volume assez important pour alimenter le système de refroidissement,
– L’échauffement des cours d’eau qui est réglementé afin de ne pas impacter la biodiversité marine. Par exemple, la centrale du Blayais situé sur la Gironde doit respecter à la sortie des réacteurs une température du fleuve de 30 °C en hiver (avant le 15 mai) et de 36,5 °C en été.
Finalement, une sécheresse peut avoir un impact sur trois grandes sources de production d’énergie électrique française : le nucléaire avec 67 % en 2020, l’hydraulique avec 13 % en 2020 et les centrales thermiques avec 7 % en 2020 [1].
L’énergie représente 22 % de la consommation annuelle globale de l’eau en surface (dont 94 % dus aux nucléaires), derrière la consommation d’eau domestique (24 %) et l’irrigation (48 %).
Par exemple, le 6 juin 2022, alors que la canicule était annoncée, mais pas encore présente, des réacteurs nucléaires en bord de Rhône (Saint-Alban) ont réduit leurs activités dues à une diminution des débits des fleuves et à une température du cours d’eau trop élevé [2]. Un peu plus tôt dans l’année, le 10 mai, ce sont les réacteurs du Blayais qui ont eu la même contrainte. En 2011, année de sécheresse, 44 réacteurs (sur 56) étaient à l’arrêt ou ont subi une diminution de puissance.
Néanmoins, les années de sécheresse ne correspondent pas à une diminution de la production hydraulique ou nucléaire (données de RTE [3]). En effet, la production durant les dernières années de sécheresses (2011, 2018, 2019) est équivalente aux autres années. Ceci s’explique par une compensation au niveau national (les sécheresses ne se produisent pas partout au même moment), mais également grâce aux retenues hydrauliques qui compensent le débit des fleuves et rivières lors des sécheresses. Ainsi, pour le moment il n’y a pas d’impact visible sur la production.
Les conséquences dans le futur sont difficilement prévisibles. En effet, le ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie prévoit 10 à 50 % de baisse du débit des cours d’eau à l’horizon 2050 [4]. Dans ces conditions, les conséquences sont indéterminées.
Illustration 1: Principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire sans aéroréfrigérant (Circuit Ouvert)[5]
Illustration 2: Principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire avec aéroréfrigérant (Circuit Fermé)[5]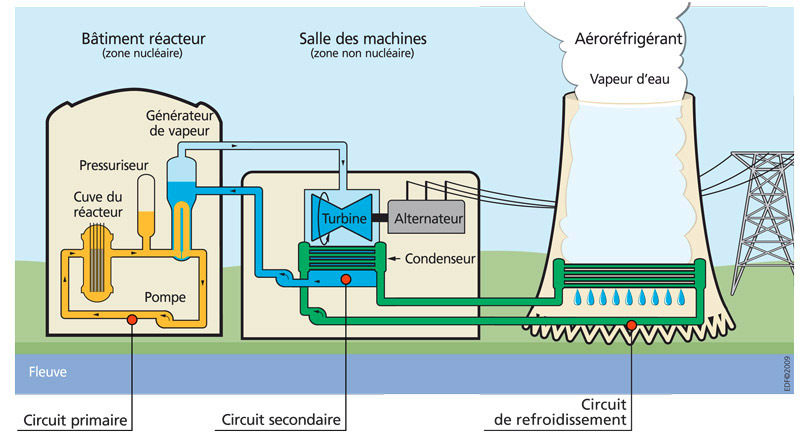
Disponible sur : https://assets.rte-france.com/prod/public/2021-03/Bilan%20electrique%202020_0.pdf [2] « Sécheresse : EDF baisse la puissance d’un réacteur nucléaire, à cause du faible débit du Rhône ». Franceinfo. 2022.
Disponible sur : https://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/secheresse-edf-baisse-la-puissance-d-un-reacteur-nucleaire-a-cause-du-faible-debit-du-rhone_5181973.html [3] Réseau de transport d’électricité (RTE). La production d’électricité par filière. Disponible sur : https://www.rte-france.com/eco2mix/la-production-delectricite-par-filiere [4] Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. Explore 2070 : Eau et changement climatique. Synthèse du projet Explore 2070 : Hydrologie de surface. 2015.
Disponible sur : https://www.gesteau.fr/sites/default/files/explore2070-hydrologie-surface.pdf [5] Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. « Fonctionnement d’un réacteur nucléaire », 2017.
Disponible sur : https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-centrales-nucleaires/reacteurs-nucleaires-France/Pages/1-reacteurs-nucleaires-France-Fonctionnement.aspx#.YrW9SXjP1uQ
Quentin Lagarde
Diplômé d’un master Science de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat en 2019 Ingénieur de recherche au laboratoire Xlim Travaille sur des projets énergétiques, notamment sur les réseaux énergétiques intelligents ou encore l’amélioration des durées de vie des batteries.
L’éolien : efficacité ? coût ? dangers éventuels ? recyclage ? origine des matériaux ?
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable inépuisable et surtout très peu polluante. Les éoliennes permettent de réduire l’utilisation des énergies fossiles et de favoriser le développement durable.
Efficacité écologique : l’ADEME a quantifié l’énergie pour fabriquer, installer, démanteler une éolienne. Elle est compensée au bout d’un an de production. ceci veut dire que sur environ 25 ans de production le « rendement écologique » sera de 24/25 soit de 96%.
Coût : L’éolien est à peu près 2 fois moins cher que le nucléaire (~60 c€ du kWh).
Dangers éventuels : chutes de glaces à basse températures, quelques problèmes de pales qui tombent (cela reste exceptionnel mais c’est arrivé) généralement liée à des tempêtes, quelques animaux qui heurtent les pales (oiseaux morts au pied des éoliennes).
Les symptômes sur les personnes (manque de sommeil, anxiété, dépression et augmentation de la pression artérielle), il est difficile de donner une réponse claire quant à la cause de ces symptômes. Selon les experts de l’industrie, le niveau de bruit émis par les éoliennes est largement conforme aux normes et ne peut avoir aucun effet négatif sur la santé (aucun risque réel pour la santé n’a encore été prouvé).
Recyclage : Un parc éolien est beaucoup plus facile à installer et à désinstaller qu’une centrale hydroélectrique, ou une centrale à flamme (charbon, gaz) ou une centrale nucléaire.
Origine des matériaux :
mâts : béton ou acier
nacelle : acier
pales : composites (léger, résistant à la fatigue et à la corrosion)
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Éolien en mer. Avril 2024.
Disponible sur : https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-en-mer-0
Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Éolien terrestre. Mars 2024.
Disponible sur : https://www.ecologie.gouv.fr/eolien-terrestre
Hélène Ageorges
Responsable de la licence professionnelle Métiers des énergies renouvelables orientée sur la production d’énergie électrique via le photovoltaïque, l’éolien, l’hydroélectricité, et les biogaz (méthanisation et pyrolyse) avec combustion dans un moteur thermique (de type Diesel). Co-Responsable du DU-Master Efficacité Energétique et Développement Durable Université des Mascareignes – Université de Limoges Recherche : compétences dans les domaines des matériaux pour l’énergie, matériaux résstants à haute température (pour les turbines et turbo-réacteurs), photo-catalyse, piles à combustible, bio-matériaux pour des applications orthopédiques, projection thermique, projection plasma
L’hydroélectricité : efficacité ? coût ? dangers éventuels ? recyclage ? origine des matériaux ?
On différencie l’énergie hydraulique qui est la production sur les cours d’eau (fleuves, rivières) et les énergies marines qui sont des énergies produites via les océans ou mers.
L’hydroélectricité est la deuxième source de production d’énergie en France (en moyenne représente entre 10 et 14% de la production électrique française) [1]. Elle fonctionne par la force motrice de l’eau qui fait tourner une turbine.
Les 4 types de centrales hydrauliques |
|
| Les centrales « de lac » ou « de haute chute » | Ce sont des barrages s’opposant à l’écoulement naturel de l’eau pour former un lac de retenue. Elles sont caractérisées par un débit très faible et une chute d’eau importante (> 300m). |
| Les centrales « d’éclusées » ou « de moyenne chute » | Elles sont caractérisées par un débit moyen et un dénivelé assez fort (>30 m et <300 m). |
| Les centrales « au fil de l’eau » ou de « basse chute » | Elles sont implantées sur des grands fleuves ou rivières et sont caractérisées par des forts débits et un faible dénivelé (<30m). |
| Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) utilisée pour le stockage de l’énergie électrique | Ces installations permettent de pomper pendant les périodes de moindre consommation d’électricité vers un réservoir haut des volumes d’eau pour les turbiner pendant les pics de consommation. |
Chaque type de centrales a des efficacités, des coûts et des dangers différents. En effet, l’efficacité va notamment dépendre de la hauteur de chute, des débits et des pertes associés.
Quant aux coûts de production réels, des informations sont difficiles à obtenir, d’une part parce qu’elles relèvent du secret commercial, d’autre part parce qu’elles reposent systématiquement sur des hypothèses difficiles à vérifier (durée d’amortissement, évolution du coût des combustibles fossiles, évaluation des coûts de démantèlement, prise en compte ou non de la fiscalité, etc.).
Concernant les dangers, on peut penser immédiatement à la rupture d’un barrage. En France une telle catastrophe s’est produite une fois, le 2 décembre 1959 près de Fréjus, avec le barrage de Malpasset qui a cédé. C’est 50 millions de m3 d’eau déversés pour une vague initiale de 40 à 50 mètres de hauteur. Au total, cet accident a fait 423 victimes.
Également des incidents liés aux lâchés d’eaux des barrages (permettant la production d’électricité) arrivent. Le dernier exemple date du 12 février 2022 à Yaté (Nouvelle-Calédonie) où 3 personnes sont mortes à cause d’une montée des eaux soudaines.
Les barrages peuvent provoquer également des risques indirects notamment avec une augmentation de maladies du à la stagnation de l’eau. Ce risque est d’autant plus important dans les zones tropicales.
Il y a également l’impact socio-économique (déplacement de population, changement d’activité, …) qui est presque impossible à évaluer.
Niveau environnement, les centrales hydrauliques sont un obstacle à la circulation des espèces et des sédiments concentrant les polluants. De plus, les centrales hydrauliques produisent peu de CO2 pendant la majorité de leur utilisation, mais ce n’est pas le cas lors de la construction et de la phase de dégradation des matières organiques immergées qui peut durer une dizaine d’année. Pendant cette période, le bilan de gaz à effet de serre est bien plus important que celui des centrales à gaz. Sur la durée de vie, il n’est pas évident que le bilan soit positif par rapport aux centrales thermiques.
Pour le recyclage, en France il commence à se faire depuis 2020 sur de petites centrales. On n’a pas encore le recul nécessaire. Il n’y aura pas de retour à l’origine mais une adaptation de l’écosystème pas forcément bénéfique pour la biodiversité.
Efficacité ? rendement très élevé jusqu’à 85%
Coût ? Les coûts d’investissement sont très importants et il y a peu de flexibilité dans le programme d’investissement (peu de possibilité de différer une partie des investissements car la majeure partie des travaux est constituée par les ouvrages en rivière et de génie civil qui sont à construire en une seule phase)
La production hydroélectrique ne nécessitent pas de coûts de combustibles et offre des coûts d’exploitations et de maintenance bas ; elle ne souffre pas des effets de l’inflation ni des variations des cours monétaires
Origine des matériaux ?
Barrage en béton
Barrage en remblai ou zoné : peu économe en matériaux mais matériaux à proximité
Disponible sur : https://www.ecologie.gouv.fr/hydroelectricite [3] Chocat Bernard. « Les barrages sont-ils un bien pour l’environnement ? » 2014. Méli Mélo : Démêlons les fils de l’eau. Disponible sur : https://www.graie.org/eaumelimelo/IMG/pdf/barrages_et_continuite_def_cle41d152.pdf [4] « Les coûts cachés des barrages hydroélectriques », Notre planète, 2019.
Disponible sur : https://www.notre-planete.info/actualites/2448-cout-barrage-hydroelectricite
Quentin Lagarde
Diplômé d’un master Science de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat en 2019 Ingénieur de recherche au laboratoire Xlim Travaille sur des projets énergétiques, notamment sur les réseaux énergétiques intelligents ou encore l’amélioration des durées de vie des batteries.
Les énergies solaires : efficacité ? coût ? dangers éventuels ? recyclage ? origine des matériaux ?
| 3 grandes familles de productions solaires | |
| Le photovoltaïque | Produit de l’électricité |
| Le thermique | Produit de la chaleur |
| L’hybride (eau ou air) | Produit par le biais du même panneau de l’électricité et de la chaleur |
L’énergie solaire est l’énergie produite grâce au rayon solaire. Aujourd’hui la majorité des panneaux installés sont des panneaux photovoltaïques.
L’efficacité des cellules photovoltaïques a grandement évolué au cours des années. En laboratoire, les cellules photovoltaïques arrivent à avoir des rendements de 47,1 % [1]. Mais dans la réalité, les rendements des panneaux commercialisés [2][3] sont moindres et en fonction des technologies ont des rendements compris entre 19 % et 23 %. Il y a cinq ans, le rendement était entre 15 et 17 %.
L’efficacité des panneaux va dépendre de la zone géographique. Par exemple, une installation à Toulouse va plus produire qu’à Limoges car elle va recevoir plus d’énergie du soleil (en moyenne 4,1 kWh/m²/jour à Toulouse contre 3,8 kWh/m²/jour à Limoges), malgré le fait que les panneaux vont perdre en rendement lorsque la température est grande.
Actuellement le coût d’un panneau que l’on retrouve dans le commerce [2][3] est compris entre 0,60 et 2,00 €/(Wc/m²), ce qui correspond pour un panneau de 400 Wc et d’une surface de 2m², à un coût de 120 à 400 € le panneau selon la technologie.
Mais attention, dans une installation solaire, il a y également le coût des convertisseurs (passer du courant continu produit par les panneaux solaire à du courant alternatif utilisé par les appareils électroménagers), des câbles, de la pose, des démarches administratives mais aussi des coûts annuels tels que la maintenance ou la TURPE (tarif d’utilisation du réseau public d’électricité).
Le coût d’une installation photovoltaïque a diminué depuis les dernières années. Pour le photovoltaïque au sol, le coût de l’électricité vendue (Dépenses/Énergie produite) était de 213 €/MWh en 2012. Il a chuté à 142 €/MWh en 2013, puis 99 €/MWh en 2015, 63 €/MWh en 2017 et 59 €/MWh mi-2018. Pour le photovoltaïque sur toiture industrielle, le tarif proposé fin 2018 était de 84,65 €/MWh [5], sachant que pour le nucléaire c’est aux alentours de 62 €/MWh.
La rentabilité d’une installation photovoltaïque va dépendre aussi de la typologie d’installation : revente totale (l’énergie produite est totalement revendue au fournisseur) ou autoconsommation (l’énergie produite est directement utilisée). Depuis maintenant quelques années une installation dédiée aux particuliers est plus rentable en autoconsommation. Mais attention, elle est loin des promesses de certains commerciaux qui annoncent de rentabiliser l’installation au bout de 4-5 ans. La rentabilité est plutôt comprise entre 12 et 20 ans selon les conditions (des calculs très précis doivent être réalisés pour déterminer une rentabilité, elle doit être faite au cas par cas).
Une autre vision plus globale consiste à considérer le coût actualisé de l’énergie qui tient compte de l’énergie grise (énergie nécessaire pour réaliser l’infrastructure qui produit l’énergie). On y voit que le PV et l’éolien sont aujourd’hui les deux énergies les plus compétitives !
Pour répondre plus précisément aux questions d’efficacité, de disponibilité et de coût il faut rappeler le principe de l’interaction entre un rayonnement et la matière : Le soleil apporte son énergie sur la terre par rayonnement sous forme d’ondes électromagnétiques. Ces ondes électromagnétiques peuvent être considérées également comme un flux de photons, des particules de masse nulle, mais de vitesse égale à celle de la lumière dans le vide. Ces photons peuvent interagir avec la matière qui va les absorber soit en produisant de la chaleur par agitation (c’est le principe du solaire thermique), soit en produisant des charges électriques lorsque la matière est un semiconducteur (c’est l’effet photovoltaïque).
1°) Efficacité et coût
L’énergie fournie par le soleil en une heure est supérieure à la consommation mondiale annuelle d’énergie. Il s’agit de l’énergie renouvelable par excellence qui devrait durer encore quelques milliards d’années (durée de vie du soleil). Rappelons que les sources d’énergies fossiles ont toutes une disponibilité limitée. Il nous en reste pour 80 ans en moyenne si l’on regarde le pétrole, le gaz, le charbon et le nucléaire au rythme de consommation actuelle.
En termes d’efficacité une centrale photovoltaïque présente un rendement autour de 20 % aujourd’hui avec une durée de vie 25 ans. C’est moins que les centrales thermiques (30 à 40 %), le nucléaire (30 % à 35 % pour EPR[1]), l’hydroélectrique (80 %), l’éolien (20 à 25 %).
Toutefois il vaut mieux, plutôt que de parler d’efficacité qui ne veut pas dire grand-chose, parler de LCOE (Levelized Cost Of Energy en anglais) ou « coût actualisé de l’énergie » qui prend en compte les aspects de durée de vie, de coût de production, et finalement du prix du recyclage en fin de vie. Ici les records sont détenus par le PV et l’éolien avec 1,5 €/MWh à comparer avec les produits dérivés du pétrole 6,6 €/MWh, le nucléaire 7,7 €/MWh et le charbon de 19 à 22 €/MWh. [7]
2°) Recyclage
Les panneaux solaires sont recyclables de 90 à 95 %. Ils sont constitués majoritairement de silicium issu de la silice (le sable) et ne comportent pas de terres rares dans leur composition contrairement à ce qui peut être lu quelquefois (souvent dû à une confusion entre le silicium solaire et l’électronique des systèmes de communication, portables, tablettes, etc.). Il faut noter que le programme PV Cycle (depuis 2014), dont les producteurs européens sont signataires, s’engage à collecter les panneaux usagés pour ce recyclage et y participer financièrement.
3°) Origine des matériaux
S’il y a une crainte au niveau de l’approvisionnement de matériaux, elle viendra notamment de l’argent (nécessaire pour la réalisation des contacts pour le PV silicium) et de quelques matériaux plus rares utilisés dans des technologies à couches minces (Tellurium, Indium, Germanium). Comparativement et en excluant les technologies à couches minces, il y a moins de danger d’avoir une pénurie de métaux que dans l’éolien, l’hydroélectrique, le nucléaire (Ni, Fe, Pb, Al Cu) [8] [1] EPR (Réacteur Pressurisé Européen) : réacteur à eau pressurisée de 1600 MW.
Disponible sur : https://www.nrel.gov/pv/device-performance.html [2] [3] Sites d’entreprises commercialisant des panneaux solaires : https://www.wattuneed.com/fr/ et https://www.oscaro-power.com/ [4] L’évolution des coûts du photovoltaïque. Photovoltaique.info.
Disponible sur : https://www.photovoltaique.info/fr/info-ou-intox/le-marche-du-photovoltaique/levolution-des-couts-du-photovoltaique/ [5] ENCIS Environnement. Analyse économique des projets d’énergies renouvelables : Focus sur l’éolien et le photovoltaïque. 2019. Disponible sur : https://www.encis-environnement.fr/sites/default/files/encis/documents/accordeon/Analyse_Economique_EnR_2019_ENCIS.pdf [6] Ministères en charge de l’écologie. Solaire. 2023.
Disponible sur : https://www.ecologie.gouv.fr/solaire [7] Ram Manish et al. « A comparative analysis of electricity generation costs from renewable, fossil fuel and nuclear sources in G20 countries for the period 2015-2030 ». Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 199, p. 687-704.
DOI : http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.159 [8] Elshkaki Ayman, Graedel T. E. « Dynamic analysis of the global metals flows and stocks in electricity generation technologies ». Journal of Cleaner Production, 2013, vol. 59, p. 260-273. DOI : https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.003
Bernard Ratier
Professeur de physique à l’Université de Limoges Mène des recherches au laboratoire XLIM sur l’électronique imprimée. Son équipe s’est spécialisée dans l’étude des cellules solaires de troisième génération à bas coût et faible empreinte énergétique. Il est animateur de la thématique énergie du labex SigmaLim, spécialisée dans le grappillage d’énergies environnementales et la gestion de l’énergie dans les réseaux de capteurs.
Centrales nucléaires risquant l’inondation en France : Le Blayais ?
Les changements climatiques peuvent engendrer une augmentation du niveau de la mer et des océans, de fortes tempêtes et des inondations (GIEC).
En France, une vingtaine de réacteurs sur cinq sites dont un en Nouvelle-Aquitaine (sur les 18 sites) sont exposés à des risques d’inondations liées à la montée des eaux océaniques et des fortes tempêtes. Les autres sites ne sont pas à l’abri des inondations.
Un scénario envisage la rupture du barrage de Vouglans pouvant impacter les sites de Bugey (70 km), de Saint-Alban, de Cruas-Meysse et de Tricastin. Au total, 14 réacteurs peuvent être concernés [1].
Une inondation de la centrale de Blayais, située au niveau de l’estuaire de la Gironde, a déjà eu lieu lors de la tempête de 1999. Les systèmes de sécurité ont été mis hors service par la tempête. Deux réacteurs ont dû être arrêtés en urgence. À l’époque, il a été décidé de prendre des mesures pour le renforcement de la prévention (en particulier relevé de la hauteur des digues).
Depuis Fukushima [3][4], pour éviter les coupures afin de maintenir un minimum d’électricités permettant le fonctionnement du circuit de refroidissement et évitant la fusion du cœur et l’explosion du réacteur, d’autres mesures ont été prises. Des groupes électrogènes ont été installés dans un bâtiment en hauteur qui ne pourra pas être inondé. Ceci est vrai pour tous les sites en France.
Pour plus d’informations concernant la sûreté nucléaire :
Site de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) : https://www.asn.fr/
Site de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) : https://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx :
Vidéos
[1] Envoyé spécial. (13 septembre 2018). Barrage de Vouglans : le scénario catastrophe. Youtube.13 septembre 2018 (France 2). 24 min 53. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=23KfSrZWsoI [2] France 3 Nouvelle-Aquitaine. Tempête 1999 : la centrale du Blayais est-elle hors de danger en cas d’inondations vingt ans après ? Youtube. 20 décembre 2019. 2 min 43. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=OzV8nMw78gs [3] Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Le déroulement de l’accident de Fukushima Daiichi. Youtube. 2 mars 2012. 11 min 42. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=gF19Ukb4S-I [4] Euronews. Fukushima dix ans après : démanteler la centrale et reprendre une vie normale. Youtube. 9 mars 2021. 12 min 10. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=A7wmjEUXXq0Bruno Beillard
Enseignant dans le département Mesures Physiques de l’IUT du Limousin Responsable du Parcours Mesures et Analyses Environnementales (enjeux environnementaux et énergétiques). Chercheur au laboratoire XLIM – pôle électronique/Antennes et Signaux, CEM et Diffraction
Question du stockage des déchets radioactifs (problème Bessines, entre autres)
Produire de l’électricité à partir de l’uranium demande 2 processus.
Le 1er est l’extraction minière et l’enrichissement.
Pour obtenir un kilo d’uranium enrichi à 90 %, il faut utiliser 212 kg d’uranium naturel, ce qui conduit en fin de processus à la production de 211 kg d’uranium appauvri devant être entreposé et géré. Avant 2001, la question des déchets miniers s’était posée car il y avait des mines en France. Actuellement on ne sait pas vraiment ce que ces déchets sont devenus (pour faire des routes, parking ?).
Le 2d processus est la réaction nucléaire qui va créer des déchets radioactifs [1].
Ces déchets ont des niveaux de radiations et des durées de vie différentes et sont répartis en 5 catégories : déchets de très faible activité, déchets de faible et moyenne activité à vie courte (temps de demi vie < 31 ans), déchets de faible activité à vie longue (temps de demi vie > 31 ans), déchets de moyenne activité à vie longue, déchets de haute activité. En fonction des catégories, ils doivent être gérés en conséquence.
Au total c’est 1 700 000 m3 de quantité de déchets radioactifs (toutes catégories confondues) accumulés en France, soit 453 piscines olympiques. Les déchets les plus dangereux (de moyenne activité à vie longue et déchets de haute activité) représentent 3.1 % du volume total des déchets, mais à eux seuls concentrent 99.8 % de la radioactivité.
Pour les catégories les plus dangereuses, les degrés de radiation sont supérieurs à la réglementation autorisée et restent radioactifs très longtemps. En attendant d’être enfouis à 500 m de profondeur sur le site de Cigéo à Bure, ils doivent être stockés dans des endroits adaptés (piscines). Leurs recyclages, pour les rendre inoffensifs, sont actuellement non maîtrisés.
Pour les déchets les moins radioactifs, une grande partie est stockée dans l’Aube. À Bessines, il est censé n’y avoir que des déchets de type TFA (Très Faible Activité), déchets de faibles activités sous le seuil de la réactivité naturelle.
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. « L’extraction de l’uranium en France : données et chiffres clés ». Février 2017. Disponible sur : https://www.irsn.fr/fr/connaissances/environnement/expertises-locales/sites-miniers-uranium/documents/irsn_mines-uranium_extraction-uranium_2017.pdf
Autorité de Sûreté Nucléaire. Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs 2016-2018. 25 février 2017. Disponible sur : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNGMDR%202016-2018.pdf
Quentin Lagarde
Diplômé d’un master Science de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat en 2019 Ingénieur de recherche au laboratoire Xlim Travaille sur des projets énergétiques, notamment sur les réseaux énergétiques intelligents ou encore l’amélioration des durées de vie des batteries.
Est-ce que le nucléaire est vraiment une énergie non-polluante ?
Le terme « pollution », qui est utilisé à foison aujourd’hui, n’a pas de définition clairement énoncée et peut-être interprété de manière différente selon les individus (il suffit de lire des définitions sur des sites différents pour s’en rendre compte).
D’après le Larousse [1] :
« Dégradation de l’environnement par des substances (naturelles, chimiques ou radioactives), des déchets (ménagers ou industriels) ou des nuisances diverses (sonores, lumineuses, thermiques, biologiques, etc.). » Bien qu’elle puisse avoir une origine entièrement naturelle (éruption volcanique, par exemple), elle est principalement liée aux activités humaines.
D’après actu-environnement [2] :
« Désigne un agent physique, chimique ou biologique qui provoque une gêne ou une nuisance dans le milieu liquide ou gazeux. Au sens large, le terme désigne des agents qui sont à l’origine d’une altération des qualités du milieu, même s’ils y sont présents à des niveaux inférieurs au seuil de nocivité. »
D’après Techno-science [3] :
Les langages scientifiques, législatifs et normatifs ont souvent retenu le mot « contamination ». Le mot « pollution » devenant alors le mot qualifiant une contamination au-delà d’une norme, seuil, loi, ou hypothèse.
En France, on ne devrait donc théoriquement parler de pollution que dans le cas de dépassement des seuils ou normes.
Le nucléaire a plusieurs sources de pollution :
Une pollution due aux déchets radioactifs.
La réaction nucléaire crée des déchets radioactifs. Certains ont des degrés de radiation supérieurs à la réglementation autorisée. Ils doivent être gérés en conséquence et stockés dans des endroits adaptés (piscines, enfouis). Leurs recyclages pour les rendre inoffensifs sont actuellement non maîtrisés.
Quelles que soient les définitions, on ne peut pas considérer que le nucléaire est non-polluant puisque des déchets radioactifs sont présents.
Une pollution chimique.
Elle a lieu lors de l’extraction minière [4] mais également lors de l’enrichissement de l’uranium [5].
Les méthodes employées pour extraire l’uranium sont :
– les mines à ciel ouvert,
– les mines souterraines : le minerai d’uranium est atteint grâce à des galeries, à l’instar des mines de charbon, et est extrait après décapage de la partie de la roche qui le recouvre,
– l’exploitation par lixiviation in situ : un premier forage est réalisé pour permettre d’injecter dans le sol une solution chimique. L’uranium dissous par cette solution est récupéré à la surface grâce à un deuxième forage.
Une autre interprétation de la question est de comparer le nucléaire vis-à-vis des autres sources de productions d’énergie. Dans ce cas, l’émission de GES (Gaz à Effet de Serre) est classiquement utilisée et est quantifiée par grammes de CO2 équivalent par kWh.
L’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) annonce que le bilan carbone d’une centrale nucléaire est de 6 gCO2eq./kWh (moindre que les centrales thermiques 1000 gCO2eq./kWh et que les énergies renouvelables entre 20 et 50 kgCO2eq./kWh). Attention ce chiffre de 6 gCO2eq./kWh n’est pas le même selon le GIEC qui donne 12 gCO2eq./kWh ou de certaines publications scientifiques qui annoncent 66 gCO2eq./kWh [6]. Tout dépend de la méthode employée pour le calcul qui diffère selon les publications.
Quentin Lagarde
Diplômé d’un master Science de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat en 2019 Ingénieur de recherche au laboratoire Xlim Travaille sur des projets énergétiques, notamment sur les réseaux énergétiques intelligents ou encore l’amélioration des durées de vie des batteries.
Comment fonctionne un barrage ?
Définition de barrage
Un barrage est un obstacle artificiel construit en travers d’un cours d’eau pour créer une retenue d’eau. Son but est de réguler le débit et/ou stocker de l’eau, notamment pour le contrôle des crues, de l’irrigation, des besoins de l’industrie, l’hydroélectricité, la pisciculture et la retenue d’eau potable.
Principe de fonctionnement d’un barrage hydroélectrique
L’énergie hydroélectrique permet de produire de l’énergie électrique grâce à la force de l’eau des rivières et des fleuves. L’écoulement de cette dernière permet d’avoir de l’énergie sous forme cinétique, qui peut être naturelle, au fil de l’eau ou artificielle avec des édifices comme des barrages.
Dans un barrage, l’eau est stockée en hauteur par une structure en béton permettant d’avoir une réserve d’énergie potentielle. Cette énergie est libérée, quand nécessaire, en fonction des besoins électriques par l’ouverture de vannes. En fonctionnement, l’eau s’écoule dans une conduite forcée ce qui transforme l’énergie potentielle en énergie cinétique. À la sortie de la conduite, la force de l’eau fait tourner une turbine permettant de convertir l’énergie cinétique en énergie mécanique. Pour les centrales de hautes chutes, les turbines Pelton sont utilisées et pour les centrales de moyennes chutes, ce sont les turbines Francis. L’axe de la turbine entraîne l’alternateur qui génère ainsi une énergie électrique. Enfin, cette énergie sera envoyée sur le réseau RTE après adaptation effectuée par un transformateur (fréquence et niveau).
Les barrages ont des contraintes de régulation du niveau de l’eau, que ce soit pour l’irrigation dans le domaine agricole ou les activités de loisirs. Ils doivent également assurer la continuité de la migration des espaces marines, avec notamment la mise en place de passes à poissons (échelles ou ascenseurs) [A].
En France, il y a 622 barrages. Le plus grand est le barrage de Tignes (volume de la retenue 230 000 milliers de m3, surface de la retenue 274 ha, hauteur 160 m, largeur 295,5 m, épaisseur à la base 44 m, année de mise en service 1952, puissance installée 392 MW (moyenne réacteur nucléaire 900 MW). Données : Comité Français des barrages et réservoirs.
Certains barrages, appartenant à EDF, ne possèdent pas de centrale hydraulique. Ils sont construits en aval d’un autre barrage qui est équipé d’une centrale. Ces premiers barrages servent à moduler le débit des rivières en cas de crue ou de sécheresse et ainsi diminuent la pression exercée sur le barrage producteur.
Les plus grands barrages du monde sont situés en Chine, barrage des Trois Gorges (39,3 milliards de m3), barrage de Jinping I (hauteur 305 m, largeur 568 m). Le plus puissant est au USA barrage de Grand Coulee (6 810 MW).
Un barrage peut également être utilisé dans le cadre d’une Station de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP). Le principe consiste :
– à pomper de l’eau dans un lac (bassin inférieur) pour remplir une retenue située en hauteurs (bassin supérieur). Cette phase consomme de l’énergie. Elle est mise en œuvre lors de surplus de production (ou prix d’achat faible),
– à utiliser la chute pour produire sur demande (prix d’achat élevé) de l’électricité comme pour une centrale hydroélectriques classique.
Un inconvénient majeur est que la phase de pompage consomme plus que la phase de production, il faut donc une gestion adéquate. Néanmoins, elles participent à l’équilibrage entre la production et la consommation. Les STEP permettent ainsi un stockage de l’énergie et une production commandable s’adaptant parfaitement à l’intermittence des énergies solaires et éoliennes.
En France, il en existe six pour une production annuelle moyenne de 6 à 7 TWh. Elles ont été mises en service entre 1970 et 1980. Les STEP sont généralement installées en montagne. Des projets de STEP en bordure du littoral sont en étude, prenant directement la mer comme bassin inférieur. [B][C]
Concernant l’émission de CO2 des barrages
On entend beaucoup dire que l’énergie hydraulique est une énergie verte n’émettant pas ou peu de gaz à effet de serre (GES) [c.f. ADEME]. C’est en partie vrai après un certain nombre d’années au-delà de sa construction mais, dépend du lieu et des dimensions du barrage et surtout de sa profondeur. Elle a, d’une part demandée beaucoup de matériaux, en particulier du béton, et d’autre part, l’inondation des surfaces englouties génère des GES par décomposition des végétaux. Même après ce délai, il ne faut pas oublier la maintenance de la centrale hydroélectrique, en particulier le changement de la turbine, de l’alternateur, des transformateurs qui n’ont pas une durée de vie infinie.
Autre point à ne pas négliger, un barrage est un obstacle à la circulation des sédiments qui vont s’accumuler au fond de la retenue d’eau. Il est donc indispensable de gérer ce problème, soit par curage, dragage voire par démantèlement. Là encore, il y a émission de GES. Pour déterminer l’émission de GES en g de CO2 par KWh, il faut considérer le cycle de vie complet du barrage [2].
Rappelons que la majorité de nos grands barrages ont été construits dans les années 1950 et que le démantèlement, bien qu’inévitable, n’est pas programmé. Néanmoins, les barrages hydrauliques restent toutefois un des moyens de production d’électricité présentant le plus d’avantages tout particulièrement pour son caractère pilotable.
Pour de plus amples informations, consultez le site « Connaissance des énergies » : https://www.connaissancedesenergies.org/
Vidéos
[A] Le Réveilleur. L’hydroélectricité. Youtube. 15 mai 2018. 25 min 47.Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=71EopUDDJ04 [B] EDF. Comment fonctionne une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) Youtube. 24 juillet 2014. 1 min 07. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=cOKSst-un8c [C] Le Réveilleur. Stockage de l’énergie sous forme mécanique : STEP, volant d’inertie et air comprimé. Youtube. 8 janvier 2019. 39 min 02. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=ECXJ5rTNi74
Bruno Beillard
Enseignant dans le département Mesures Physiques de l’IUT du Limousin Responsable du Parcours Mesures et Analyses Environnementales (enjeux environnementaux et énergétiques). Chercheur au laboratoire XLIM – pôle électronique/Antennes et Signaux, CEM et Diffraction
Est-ce que les éoliennes sont une sources d’énergie vraiment renouvelable ?
Une énergie est renouvelable lorsqu’elle provient de sources que la nature renouvelle en permanence à l’échelle humaine, par opposition à une énergie non renouvelable dont le stock s’épuise. On peut catégoriser les énergies renouvelables en 6 catégories – solaire, éolien, marine, hydraulique, géothermie et biomasse [1].
Une éolienne fonctionne par l’action du vent qui permet de faire tourner une turbine.
Le vent est une source est inépuisable. En effet, le vent est formé par un gradient de température engendré par le soleil qui chauffe de façon non homogène notre atmosphère. Finalement tant que le soleil existera et que la terre sera ronde, on aura toujours du vent.
Mais attention à ne pas faire un raccourci en disant qu’une énergie renouvelable est une énergie propre et sans effet sur l’environnement.
La production des éoliennes est intermittente, par contre elle est prévisible à 72h et il y a toujours des éoliennes qui fonctionnent quelque part, comme le réseau électrique est interconnecté, on a de l’électricité en continue. L’énergie éolienne est très performante, de toutes les énergies renouvelables, c’est celle qui génère le plus d’énergie par mètre carré occupé.
Hélène Ageorges
Responsable de la licence professionnelle Métiers des énergies renouvelables orientée sur la production d’énergie électrique via le photovoltaïque, l’éolien, l’hydroélectricité, et les biogaz (méthanisation et pyrolyse) avec combustion dans un moteur thermique (de type Diesel). Co-Responsable du DU-Master Efficacité Energétique et Développement Durable Université des Mascareignes – Université de Limoges Recherche : compétences dans les domaines des matériaux pour l’énergie, matériaux résstants à haute température (pour les turbines et turbo-réacteurs), photo-catalyse, piles à combustible, bio-matériaux pour des applications orthopédiques, projection thermique, projection plasma
Comment sont recyclés les panneaux solaires ?
Les panneaux solaires sont recyclables de 90 à 95 % (le silicium et les métaux à 100 %). Ce sont les matières organiques (joints d’étanchéité notamment) qui ne sont pas recyclés. Les panneaux sont constitués majoritairement de silicium issu de la silice (le sable) et ne comportent pas de terres rares dans leur composition contrairement à ce qui peut être lu quelquefois (souvent dû à une confusion entre le silicium solaire et l’électronique des systèmes de communication, portables, tablettes, etc…). Il faut noter que le programme PV Cycle (depuis 2014), dont les producteurs européens sont signataires, s’engage à collecter les panneaux usagés pour ce recyclage et y participer financièrement.
Plus particulièrement en France, le recyclage est assuré par la société SOREN.
Deux solutions :
– si l’installation est petite (moins de 40 panneaux), c’est au propriétaire de déposer les panneaux aux points de collecte, mais pas forcément car cela peut être pris en charge si on achète une nouvelle installation,
– si l’installation fait plus de 40 panneaux, la collecte est assurée par l’entreprise.
Plusieurs procédés peuvent être utilisés : la délimination (séparation des cellules solaires du verre et des connections) ou le broyage et tri des cellules solaires avec récupération du silicium, des métaux de contacts.
En chiffres on récupère 78 % de verre, 10 % d’aluminium, 7 % de plastiques et 5 % de silicium. On voit que le silicium n’est qu’une faible partie des constituants des panneaux.
Ressources d’information et de sensibilisation sur le recyclage des panneaux solaires : https://www.soren.eco/mediatheque-recyclage-panneaux-solaires-photovoltaiques/
Bernard Ratier
Bernard Ratier est professeur de physique à l’Université de Limoges et mène des recherches au laboratoire XLIM sur l’électronique imprimée. Son équipe s’est spécialisée dans l’étude des cellules solaires de troisième génération à bas coût et faible empreinte énergétique. Il est animateur de la thématique énergie du labex SigmaLim, spécialisée dans le grappillage d’énergies environnementales et la gestion de l’énergie dans les réseaux de capteurs.
Pourquoi l’énergie hydraulique n’est-elle pas plus utilisée ? Serait-elle plus « rentable » que les éoliennes qui dénaturent les paysages ?
L’énergie hydroélectrique permet de produire de l’énergie électrique grâce à la force de l’eau des rivières et des fleuves. L’écoulement de cette dernière permet d’avoir de l’énergie sous forme cinétique, qui peut être naturelle, au fil de l’eau ou artificielle avec des édifices comme des barrages [1].
L’énergie hydroélectrique est la 1re source d’énergie renouvelable. D’autre part, elle n’est pas intermittente, elle est pilotable et stockable.
Aujourd’hui, on recense en France [2] :
– 2 500 centrales hydrauliques réparties sur le territoire.
– 900 barrages dont 230 grands barrages
– 6 STEP
– 267 km de conduites forcées
| Puissance installée | |
| EDF | 20 GW |
| CNR | 3,3 GW |
| SHEM | 0,7 GW |
| Producteurs indépendants | 1 GW |
| Total | 25 GW |
Par comparaison, les 56 réacteurs nucléaires des 18 sites font un total de 65 GW.
L’énergie hydraulique représente 12 % du mix électrique en 2021 soit la deuxième source de production française après le nucléaire (69 %).
Il est toujours possible d’envisager de développer l’énergie hydraulique en construisant des barrages et des STEP. Mais cela demande des investissements importants, une rentabilité lointaine et pas toujours garantie. De plus, de nouvelles constructions auront un impact environnemental très élevé. Il faudra également assurer la sécurité et la sûreté de ces installations demandant un coût de maintenance non négligeable. Les effets du changement climatique (sécheresses, inondations, …) n’encouragent pas le développement de cette énergie.
Pour rappel, nos grands barrages ont été construits dans les années 50 et les STEP dans les années 70 et 80. Le maintien en état de service tout en garantissant la sûreté d’installations très dispersées sur le territoire n’est pas neutre économiquement. Le démantèlement d’un grand barrage semble être très compliqué et son impact écologique non négligeable.
Néanmoins, des projets de mini STEP, de STEP marines [3], de STEP sur des lacs en montagne, situés à des altitudes différentes, semblent très pertinents.
Disponible sur : https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/qu-est-ce-que-l-energie-hydraulique [2] « L’hydroélectricité en France : Chiffres clés ». France Hydro Électricité.
Disponible sur : https://www.france-hydro-electricite.fr/lhydroelectricite-en-france/chiffres-clefs/ [3] « Stockage d’énergie par STEP marine (Station de Transfert d’Énergie par Pompage) ». HydroCoop. 22 décembre 2013. Disponible sur : http://fr.hydrocoop.org/stockage-d-energie-step-marine/
Quentin Lagarde
Diplômé d’un master Science de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat en 2019 Ingénieur de recherche au laboratoire Xlim Travaille sur des projets énergétiques, notamment sur les réseaux énergétiques intelligents ou encore l’amélioration des durées de vie des batteries.
Qu’est-ce que le mix énergétique ?
Définition
Le mix énergétique, ou bouquet énergétique, représente la répartition des différentes sources d’énergies primaires consommées pour répondre aux besoins énergétiques d’une zone géographique.
Il ne faut pas confondre le mix énergétique et mix électrique qui correspond à la répartition des sources d’énergies primaires utilisées dans la production d’électricité. Elle ne prend donc pas en compte, par exemple, les énergies pour les transports ou pour créer de la chaleur.
Fonction de l’espace et du temps
La zone géographique considérée peut aller du monde, aux pays (France), aux régions (Nouvelle-Aquitaine). Ces mix énergétique et électrique peuvent être moyennés sur l’année, mais peuvent également l’être sur des temps plus petits. Sur le site d’ElectricityMap est donné, en temps réel, le mix électrique de nombreux pays. Les sites de RTE « rte-france.com/eco2mix » et de l’opérateur de réseaux d’énergie « agenceore » sont pertinents pour avoir des détails sur l’évolution de la production et de la consommation d’électricité concernant la France, les régions, …
Pour chaque pays, ils dépendent des disponibilités en ressources exploitables (choix politique, contextes géopolitique et économique), des équipements (état en fonctionnement ou en maintenance), des conditions météorologiques et environnementales.
Le mix énergétique mondial :
– Plus de 83 % de la consommation d’énergie primaire utilise des sources fossiles. Le nucléaire ne représente qu’environ 4 %, le reste soit 13 %, des énergies renouvelables (EnR).
– Pour la production d’électricité, les sources fossiles représentent plus de 61 %, le nucléaire 10 % et les EnR 29 %.
Les unités couramment utilisées pour quantifier l’énergie sont le Joule (J), le Kilowattheure (kWh), la Tonne d’équivalent pétrole (Tep). 1 Tep correspond à 11 630 kWh ou 4,187.1010 J, 1 ExaJoule (EJ) = 277,778 TWh. 556,6 EJ est équivalent à 154 611,2 TWh.
Pour comparaison, en 2019 la consommation d’énergie primaire était de 583,9 EJ et la production d’électricité de 27 004,7 TWh. Soit une baisse de la consommation de 8% qui s’explique par les confinements liés à la pandémie covid 19 (effet sur les transports et l’industrie, mais pas sur le résidentiel).
Le mix énergétique en France [1] :
– Plus de 46 % de la consommation d’énergie primaire utilise des sources fossiles. Le nucléaire ne représente qu’environ 40 %, le reste soit 14%, des EnR.
– Par secteur, les transports représentent 30 %, l’industrie 20 %, l’agriculture et la pêche 3 % et le résidentiel et le tertiaire 47 %.
Le mix électrique en France [2] :
– Le nucléaire représente un peu moins de 70 %, les sources fossiles 7 %, le reste les EnR 23 %.
En Allemagne, le mix électrique est :
– 42.6 % par des sources fossiles (Charbon, Gaz, Fioul),
– 11.1 % par le nucléaire (fin 2022 les dernières centrales nucléaires doivent s’arrêter),
– 46,3 % par les EnR (22.5 % par l’éolienne, 9,7 % par le solaire, 9.8 % par la biomasse, 4.3 % par l’hydroélectricité).
Des pays ont un mix électrique 100 % renouvelable comme l’Islande (70 % par de l’hydroélectricité et 30 % par de la géothermie), la Norvège, la Suède, le Monténégro, la Géorgie, le Québec, l’Uruguay.
Évolution
Différents scénarios (du 100 % EnR à 50 % EnR 50 % Nucléaire) de trajectoire du mix énergétique français en 2050 ont été réalisés par RTE [3]. Des interrogations peuvent subsister sur la faisabilité technique, le respect des délais, le coût et l’influence des contextes politiques, économiques et environnementaux (comme la guerre en Ukraine ou les dégâts provoqués par les changements météorologiques et climatiques – sécheresses, inondations, …).
Autres sites
Agence de la transition écologique : www.ademe.fr
Agence internationale de l’énergie : www.iea.org
Centre d’études et de recherches économiques sur l’énergie : www.ceren.fr
Commission de régulation de l’énergie : www.cre.fr
Direction générale de l’énergie et du climat : www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-lenergie-et-du-climat-dgec
Observatoire des énergies renouvelables : www.energies-renouvelables.org/accueil-observ-er.asp
Opérateur de réseaux d’énergie : www.agenceore.fr
Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement : www.rare.fr
Vidéos
Chez Anatole. Énergie : Mix énergétique, le problème en 8 minutes ! Youtube. 3 novembre 2020. 8 min 11. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=MxUjyK7-8ME
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Construire un mix énergétique pour 2050 [Conférence]. Youtube. 13 avril 2022. 2 heures et 4 minutes. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=3Y8gN8M-IJA
Mumons. Quelle croissance pour quel mix énergétique en 2050 par Philippe Charlez [Conférence] Youtube. 8 décembre 2021. 1 heure et 32 minutes. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=NnobDcOBWNc
Élucid. Crise climatique et énergétique : regarder la vérité en face – Jean-Baptiste Fressoz [Interview]. Youtube. 18 juin 2022. 1 heure et 32 minutes. Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=mMQwdUxF_bQ
Bruno Beillard
Enseignant dans le département Mesures Physiques de l’IUT du Limousin Responsable du Parcours Mesures et Analyses Environnementales (enjeux environnementaux et énergétiques). Chercheur au laboratoire XLIM – pôle électronique/Antennes et Signaux, CEM et Diffraction
Panneaux solaires : Tellure de Cadmium par rapport à l’Uranium ?
Un peu de mathématiques : comparons un gramme d’uranium et un gramme de tellurure de cadmium (CdTe) pour produire de l’énergie. Bien entendu le CdTe sert à produire de l’énergie par conversion photovoltaïque alors que l’uranium est le combustible des centrales nucléaires.
Pour faire un panneau solaire d’1 m², il faut 12 g de CdTe. Avec une incidence solaire de 1750 kW/m²/an et un rendement de conversion du panneau solaire de 11 %, on peut produire 154 kWh/an et cela pendant 32 ans, ce qui revient à 2,6 mg/kWh. En comparaison il faudra 26 mg d’uranium pour produire ce même kWh.
Donc si on calcule bien, en termes d’énergie produite, le CdTe est 10 fois plus performant que l’uranium… Notons également que l’empreinte énergétique de cette technologie solaire est l’une des plus faibles, ne nécessitant que des procédés dont la température n’excède pas 250 °C.
Ce calcul a été fait en 1990 par Ken Zweibel, alors qu’il était chercheur au NREL (National Renewable Energy Laboratory, US) et un des pionniers de la filière CdTe (panneaux solaires couche mince). On pourrait reprendre le même calcul avec les technologies solaires de troisième génération, telles que le photovoltaïque organique (PVO), avec des rendements du même ordre de grandeur en panneaux solaires de grande surface et des rendements records à 20 % en cellules et une technologie encore moins énergivore que le CdTe pour sa fabrication et surtout aucun problème d’approvisionnement en matériaux rares.
Bernard Ratier
Bernard Ratier est professeur de physique à l’Université de Limoges et mène des recherches au laboratoire XLIM sur l’électronique imprimée. Son équipe s’est spécialisée dans l’étude des cellules solaires de troisième génération à bas coût et faible empreinte énergétique. Il est animateur de la thématique énergie du labex SigmaLim, spécialisée dans le grappillage d’énergies environnementales et la gestion de l’énergie dans les réseaux de capteurs.