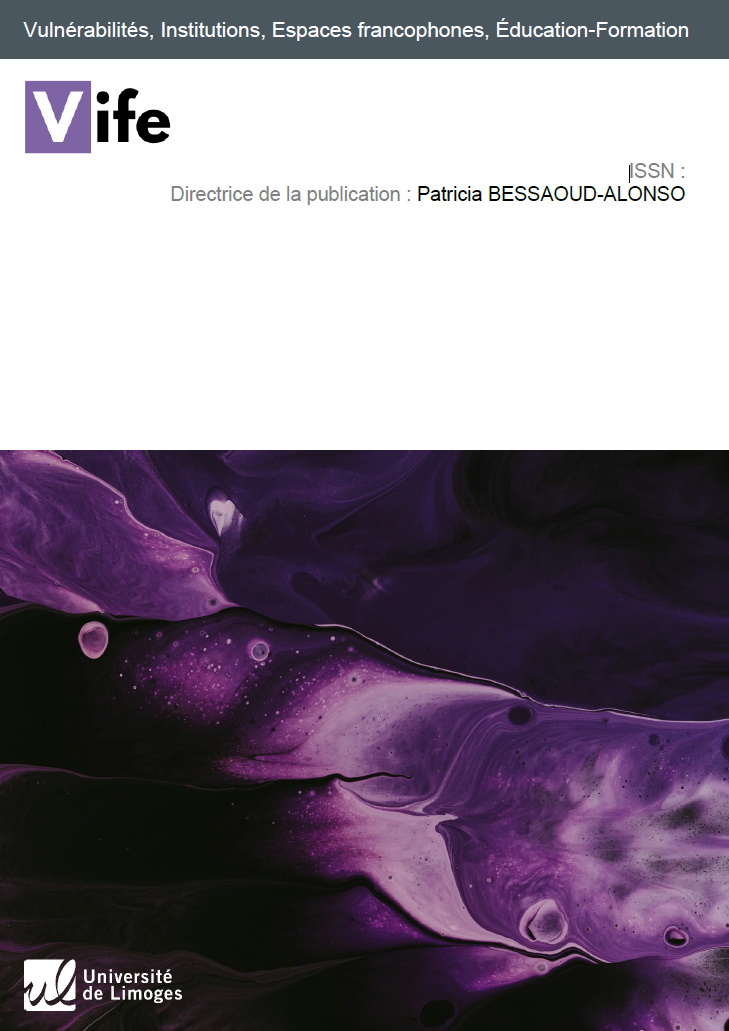Appel à contribution – N° 2
Trouver sa voie : logiques et pratiques d’entrée dans le métier des jeunes professionnels
Parution en septembre 2025
Date limite de proposition des articles : 30 septembre 2024
Les métiers de l’éducation et de la formation forment un spectre large et ne sont pas réduits aux seuls métiers de l’enseignement. La prise en charge éducative et formative des personnes, par des professionnels, s’étend de la naissance à la fin de vie. Une pluralité d'institutions sont parties prenantes dans ce que nous pourrions nommer successivement d’accompagnement, de guidance, d’instruction, de transmission de savoirs, de compétences… Toutes ces notions sont polysémiques et mériteraient d’être interrogées selon les métiers et les missions des professionnels et des formes d’injonction ou d’incitation à la collaboration, à la coopération en fonction des territoires et des institutions.
La question que nous posons concerne l’entrée dans ces métiers qui semble osciller entre imaginaire collectif, utilité sociale, désir, crainte du lendemain.
A-t-on affaire comme le souligne Perisset-Bagnoud (2010) à propos de la professionnalisation des enseignants d’un « entre-deux en jachère » qui pourrait s’entendre et s’étendre à l’ensemble des métiers du champ éducatif ? Les réformes et les gouvernances successives, parfois contradictoires ou peu lisibles, ne participeraient-elles pas d’un sentiment de terre en friche dans l’attente d’un renouveau ? Toutefois des jeunes s’embarquent dans ces métiers. Comment perçoivent-ils le métier d’enseignant de l’école à l’université, d’éducateur, de formateur ? Quelle est la réalité des premiers pas dans le métier ?
Axe 1 « Enjeux éducatifs en espaces francophones »
L’entrée dans le métier ne peut être présentée comme un acte uniforme : elle dépend du territoire considéré, de la connaissance que le jeune professionnel en a, de son vécu, des supports identifiés ou proposés. Ces croisements de paramètres créent des configurations spécifiques : dans quelle mesure celles-ci influencent la négociation ou la manière de vivre l’entrée dans les formations aux métiers du soin et de l’éducation des jeunes ?
Cet axe accueille toute contribution qui ouvrira à des contextes moins connus ou moins travaillés : territoires ultra marins, autres contextes de formation, formations alternatives pour accéder à ces métiers. Les territoires de la république sont variés : Nouméa, Cayenne, Brive, Dunkerque ou le 16e arrondissement de Paris sont autant d’exemples de la diversité des contextes d’exercice des métiers d’éducation et de formation. Les publics qui souhaitent s’engager dans ces métiers, le font-ils au nom d’un territoire en particulier ou au nom d’une mission de service public qui dépasse les enjeux locaux ? Pour évangéliser une « zone de mal-éducation » (Léna, 2018) ou pour rester dans un espace géographique et social connu ?
La notion de territoire porte en creux celle de diversité, au sens de la « part transnationale visible de la communauté nationale » (Lorcerie, 2021, p. 13). Être ou se sentir d’ici ou d’ailleurs, travailler auprès de non-natifs dans des contextes nationaux avec des régimes de tolérance variables (Walzer, 1998).
En quoi la connaissance que les futurs ou néo-professionnels ont d’un territoire au sens de Frémont (2010), qui comprend la connaissance vécue ou littérale, le degré de proximité, les mobilités possibles, les périodes de vie passées ici ou là, construit-elle leur relation à ou leurs représentations de la formation au métier, du public, de la pratique sur le terrain ?
Dans la ligne des travaux sur l’écologie urbaine (Park, Burgess, McKenzie, 1925), il est possible d’analyser les interrelations entre les registres économiques, politiques, sociaux qui construisent le territoire.q
Il importe de considérer l’espace de l’apprentissage : celui-ci peut se décliner de multiples manières. L’espace peut être un lieu physique, de taille réduite, positionné par des coordonnées, nommé (lieu-dit, village, quartier, ville …), il peut se réduire à un bâtiment (l’école, le lycée, le centre de loisirs, la maison des associations, etc.) ou encore à un dispositif dont l’existence spatiale est soumise à la présence temporelle (sas éducatif, accompagnement périscolaire, …).
Les travaux sur la formation à distance montrent la dimension physique, spatiale et temporelle des apprentissages y compris avec les modalités asynchrones et en distances (Romero, 2018).
Au-delà d’une confrontation du connu et de l’inconnu, des problématiques de maintien, de retour ou de découverte d’un territoire, comment penser la formation des professionnels ? Peut-elle se penser de manière horizontale, à la manière de Glissant (1993) ? Le même lieu où se vit l’espace de formation et d’éducation n’est pas nécessairement vécu de la même manière par les professionnels et les publics, et pourtant, à bien des égards, il constitue un lieu partagé. Ces fréquentations diverses constituent l’identité du lieu, participent du développement de ses structures, etc. Comment ce vécu qui peut être tout à la fois commun et différencié participe de l’expérience ou de l’engagement des futurs ou des néo-professionnels ?
Axe 2 « Utilité sociale et engagement »
Le travail occupe aujourd’hui de moins en moins de place dans la vie des salariés et il s'avère être davantage une contrainte (58 %, avec une hausse de 9 points en comparaison à 2006) qu'un moyen de s'épanouir dans la vie (42 %), selon l’étude réalisée par l’IFOP (Institut français d’opinion publique) en février 2023. Les tranches d’âges [18-24] et [25-34] sont particulièrement concernées par ces évolutions du rapport au travail. Pour ces mêmes tranches d’âge, la rémunération et l’ambiance au travail constituent les facteurs les plus essentiels en faveur de l’épanouissement au travail, avant celui de l’intérêt des missions réalisées. De plus, l’étude de la DARES (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) "Quels métiers en 2030 ?", réalisée en mars 2022, pointe notamment le fait que certains métiers connaîtront prochainement une forte croissance, à l'image des métiers du soin et de l'aide aux personnes âgées (p.4 de l’étude). L’ensemble de ces éléments contextuels viennent interroger les formes d’engagement des jeunes vis-à-vis des métiers de l’éducation et de la formation en lien avec le présent appel à contribution.
Dans cette perspective, les travaux de la sociologue Anne Muxel aident à mieux saisir l’évolution de la jeunesse actuelle du point de vue de la question de l’engagement. « L'engagement a changé : il est plus flexible, plus court et à tout moment réversible. Les jeunes générations ne s'engagent plus pour des décennies » (Muxel, 2018, p. 89).
Si les jeunes conservent un goût pour l’engagement associatif, ils sont particulièrement attentifs aux marges de manœuvre et au pouvoir d’agir qui leur sont offerts au sein des associations.
L’étude de Ozouf et Ozouf (1992), à partir des trajectoires biographiques des instituteurs ayant exercé avant la première guerre mondiale, met en lumière leurs motivations professionnelles à cette époque qui se déploient à travers un réel désir d’instruire, d’obtenir une reconnaissance sociale ainsi qu’un véritable sentiment d’appartenance à un collectif. Plus d’un siècle plus tard, dans les métiers de l’enseignement, le nombre de démissions chez les enseignants ne cesse d’augmenter depuis quelques années : en effet, entre 2011 et 2018, ce nombre a triplé, la plus grande part concerne le premier degré et les toutes premières années d’exercice. Il convient d’ajouter que le phénomène reste minoritaire, sur le plan statistique, à l’aune de l’ensemble de la population enseignante (Garcia, 2021). Les conditions de travail des enseignants du premier degré sont à ce point problématiques que ces derniers sont quotidiennement exposés à de nombreux risques psychosociaux. En parallèle, ces contraintes quotidiennes vécues par les professeurs des écoles d’aujourd’hui n’en effacent pas moins la reconnaissance d’un sentiment d’utilité sociale qui reste assez fortement ancré dans la profession (Danner et al, 2020, p. 216).
Depuis des décennies, nous savons que l’engagement professionnel des enseignants, à l’endroit des élèves, produit des effets sur l’amélioration de la qualité relationnelle avec ces derniers et les collègues de travail, ainsi qu’en termes de résultats scolaires (Duchesne, Savoie-Zajc, Saint-Germain, 2005).
Le travail social, quant à lui, est entré depuis ces 20 dernières années dans une logique utilitariste. La mutation qui s’est opérée se traduit par le fait que le travail social doit être avant tout rentable au regard des fonds qui lui sont alloués. « La loi 2002-2 a bouclé le système en inventant l’appareillage des obligations-performance-contractualisation-droits des usagers- qui ont cassé l’imaginaire professionnel. L’intelligence principale dans ces secteurs est déclarée comme venant des usagers, qui sont censés savoir ce qui est bon pour eux » (Chauvière, 2020). Ces nouvelles contraintes fonctionnalistes liées au travail social interrogent le dévouement et les valeurs humanistes à la base de l’exercice du métier d’éducateur. Comme le montrent des travaux récents relevant de contextes issus des centres sociaux (Pesce, Doublet, Guillet, 2021), ces contraintes vont même parfois jusqu’à remettre en question des notions, paraissant louables a priori, comme celle de DPA - développement du pouvoir d’agir - importée du modèle nord-américain, car ces notions mises en œuvre dans des projets d’action sociale relèvent davantage d’injonctions que d’un véritable sens donné à ces projets (ibidem, p. 23-24).
Ainsi, si les « travailleurs sur autrui » (Dubet, 2020), tels que les enseignants, travailleurs sociaux, formateurs, animateurs, etc. se sont développés largement dans les années 1960-1970 en ayant un véritable pouvoir d’agir dans la réalisation des tâches professionnelles (Bidou, 1984), il convient sans doute de reconnaître que la période actuelle réinterroge fortement cet aspect eu égard aux nouvelles formes d’organisation du travail à l’intérieur de ces métiers.
À l’aune de la tension existante entre projet de soi pour soi et projet de soi pour autrui (Kaddouri, 2020), quelle dynamique individuelle et sociale de l’engagement peut se dessiner à travers ces premiers pas ? Et quid de la reconnaissance d’un sentiment d’utilité sociale dans l’exercice des métiers de l’éducation et de la formation face aux mutations constantes subis par ces métiers ?
Bibliographie
Bidou, C. (1984). Les aventuriers du quotidien. PUF.
Boudesseul, G., Caro, P., Grelet, Y., Minassian, L., Monso, O., & Vivent, C. (2016). Atlas des risques sociaux d’échec scolaire. DEPP, MEN.
Chauvière, M. (2020). Travail social : vers une crise des vocations ? Actualités Sociales Hebdomadaires
Dabi, F. et Lasserre, H. (2023). Le rapport au travail des Français. IFOP. https://www.ifop.com/publication/le-rapport-au-travail-des-francais/
Danner, M. Farges, G. Garcia, S. Giret, J-F. (2020). L’exercice du métier des professeurs des écoles au prisme des contextes de travail et des parcours de vie. Éducation & formations. Les enseignants : panorama, carrières et représentations du métier, 101, 215-245. https://hal.science/hal-03097813
Deltand, M. et Kaddouri, M. (2020). Rapport conflictuel entre projet de soi pour soi et projet de soi pour autrui : analyse par les théories de la traduction et de la double transaction. Recherches en éducation, 42.
Dubet, F. (2002). Le déclin de l’institution. Seuil.
Duchesne, C. Savoie-Zajc, L., Saint-Germain, M. (2005). La raison d’être de l’engagement professionnel chez des enseignantes du primaire selon une perspective existentielle. Revue des sciences de l’éducation, vol. 31, n° 3, p. 497-518.
Frémont, A. (2010). État des lieux : À propos de l'espace vécu. Communications, 87, 161-169. https://doi.org/10.3917/commu.087.0161
Garcia, S. (2021). Quand les enseignants claquent la porte. La vie des idées https://laviedesidees.fr/Quand-les-enseignants-claquent-la-porte.html
Glissant, É. (1993). Tout-Monde. Paris.
Léna, V. (2018). Des « cités éducatives » pour arrimer les cités à la République ? Diversité, 191, 77-82.
Lorcerie, F. (2021). Introduction. Dans F. Lorcerie (dir.). Éducation et diversité (11-26). PUR.
Muxel, A. (2018). Politiquement jeune. De l’aube.
Ozouf, J. et Ozouf, M. (1992). La République des instituteurs. Seuil.
Park, R., Burgess, E., McKenzie, R. (1925). The City. University of Chicago Press.
Pesce, S. Doublet, M-H. Guillet, J. (2021). Enjeux et paradoxes de l’empowerment dans le contexte des centres sociaux. Dans Pesce, S., Doublet, M-H, Guillet, J. Vers une pédagogie de l’engagement ? Champ social. 17-31.
Romero, M. (2018). Territoire, apprentissages et cocréation. Diversité, 191, 66-69.
Sciberras, J-C. (dir.). (2022). Les métiers en 2030. Le rapport national. DARES. https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-metiers-en-2030-le-rapport-national
Walzer, M. (1998). Traité sur la tolérance. Gallimard.
Les propositions sont attendues pour le 10 juillet 2024
Un résumé de 1200 à 1400 signes en précisant l’axe dans lequel il s’inscrit.
Un titre, Maximum 5 mots clés, 3 ou 4 Références bibliographiques.
Contact : vife@unilim.fr