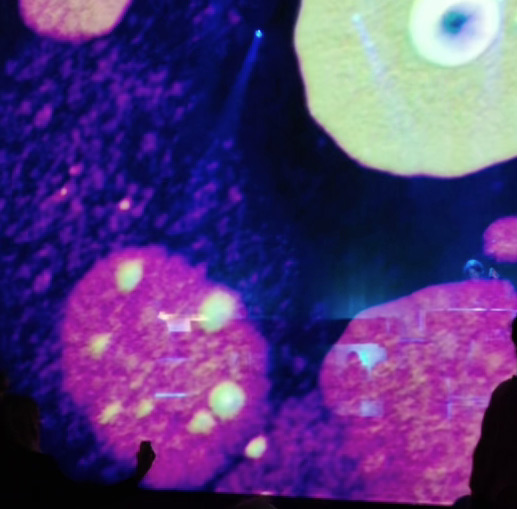La fiction au risque de l’art numérique Fiction at the risk of digital art
Marion Colas-Blaise
Université du Luxembourg
Le Fake Art n’est pas l’Art Fake : l’article vise à montrer que les artefacts numériques natifs sont fictionnels en ce que, ni faux, ni copie ni réplique pures, ils mettent en tension des traits des régimes autographique et allographique. Ensuite, il s’agit de s’interroger sur la dimension « imaginaire » de l’œuvre d’art numérique, à travers la mise en avant des notions de « fiction artistique », de simulation et de simulacre : passer de la fiction artistique à l’œuvre-simulacre et au virtuel, est-ce dépasser les oppositions « vrai vs faux » et « réel vs imaginaire » et mettre l’accent sur la puissance créatrice ? In fine, nous défendons l’idée de la fiction-façonnage, qui attire l’attention sur la fabrication de l’artefact numérique.
Fake Art is not Art Fake: the article aims to show that native digital artefacts are fictional in that, neither false, nor copy nor pure replica, they create tension between features of the autographic and allographic regimes. Secondly, it examines the “imaginary” dimension of digital artworks, by highlighting the notions of “artistic fiction”, of simulation and of simulacra: does moving from artistic fiction to work-as-simulacrum and to the virtual mean going beyond the oppositions of “true vs. false” and “real vs. imaginary”, and emphasizing creative power? In fine, we defend the idea of fiction-making, which draws attention to the production of the digital artifact.
Index
Articles du même auteur parus dans les Actes Sémiotiques
Mots-clés : artefact numérique, authenticité, fiction-façonnage, imaginaire, œuvre-simulacre
Keywords : Authenticity, Digital artifact, Fiction-making, Imaginary, Work-simulacra
Auteurs cités : Bruno BACHIMONT, Jan BAETENS, Jean BAUDRILLARD, Stefania CALIANDRO, Gilles DELEUZE, Nelson GOODMAN, Thierry LENAIN, Lev MANOVICH, Jean-Marie SCHAEFFER
- Note de bas de page 1 :
-
Le projet implique des historiens, des développeurs et un ingénieur de Microsoft, la banque ING, l’université technologique de Delft et deux musées d’art néerlandais, le Mauritshuis et le Rembrandthuis.
- Note de bas de page 2 :
-
Cf. « ART (L’art et son objet) Le faux en art », dans Encyclopaedia Universalis ; https://www.universalis.fr (consulté le 28/05/2024). Nous considérons ici, de manière liminaire, la copie qui est frauduleuse. Notons toutefois que la copie ne l’est pas nécessairement : son but n’est pas, toujours, de tromper, comme nous le verrons mieux infra.
En 2016, un algorithme deep-learning qui a été entraîné à apprendre le style de Rembrandt à travers 346 peintures a produit un portrait selon Rembrandt1. S’agit-il de la version numérisée d’un faux Rembrandt ? La réflexion gagne-t-elle à mobiliser l’opposition « vrai vs faux » et ses implications épistémiques : en particulier ici, faire croire être vrai ce qui ne l’est pas (Bouilloud 2013) ? Est-ce chercher à tromper au même titre que la copie – il s’agirait de la première contrefaçon – du Portrait de Léon X de Raphaël, réalisée au XVIe siècle par Andrea del Sarto, sur ordre du pape Clément VII et à l’intention de Frédéric II de Conzague2 ? Le « Rembrandt » numérique relèverait-il, plutôt, du Fake Art, qui occupe une position intermédiaire entre le contrefait (que nous mettons en relation avec la copie frauduleuse) et le contrefactuel (ce qui n’a pas été réalisé et qui aurait pu l’être [Caliandro 2022]) ?
- Note de bas de page 3 :
-
Cf. l’exposition virtuelle proposée : Urbancoolab https://urbancoolab.com › meet-basquiat (consulté le 28/05/2024).
Ou encore, en quoi « imiter » numériquement un tableau de Jean-Michel Basquiat est-ce verser dans la contrefaçon ? L’urgence est de comprendre et d’évaluer la démarche de la start-up canadienne Urbancoolab, un laboratoire en IA design génératif qui dévoile en 2022 STITCH, le premier robot-concepteur commercial apte à renouveler le style de cet artiste de rue3.
- Note de bas de page 4 :
-
Selon Tony Veale, F. Amílcar Cardoso et Rafael Pérez y Pérez (2019), Computational Creativity constitue une branche émergente des études en Intelligence artificielle. Elle mise sur l’autonomie des ordinateurs considérés comme des créateurs et des co-créateurs.
Autant de questions qui se font pressantes à une époque qui réclame une vigilance accrue face à la prolifération des fake news et aux montages et détournements d’images, où le numérique vient rebattre les cartes, de plus en plus, où la créativité computationnelle (étudiée par la Computational Creativity)4 concurrence celle de l’humain et où les changements affectant notre « régime de croyance esthétique » (Caliandro ibid.) influencent le rapport que nous tissons avec le monde. Nous privilégierons ici les impacts artistiques plutôt qu’éthiques (Leone 2022), en choisissant d’aborder la fiction numérique, c’est-à-dire la génération d’artefacts numériques, plus ou moins inédits, sous l’angle d’une (ré)énonciation machinique fictionnelle.
- Note de bas de page 5 :
-
En réception, le spectateur peut accepter, pragmatiquement, de ne pas adhérer aux représentations sur le mode de la crédulité (croyance référentielle).
- Note de bas de page 6 :
-
Ainsi, en sémiotique, le carré de la véridiction est central, tout comme la notion de vraisemblable : est considérée comme vraisemblable une « représentation plus ou moins conforme à la “réalité socioculturelle” » (Greimas et Courtés 1979 : 423). Plus précisément, il arrive qu’un simulacre soit monté pour « faire paraître vrai » (ibid. : 423). À propos du couple « savoir » et « croire », cf. également Greimas (1983). Enfin, la vraisemblance et le simulacre impliquent des actants (Destinateur manipulateur et judicateur, sujet, anti-sujet, objet…) endossant des rôles différents.
Il s’agira ainsi de mettre les déclinaisons de la notion de fiction à l’épreuve de l’œuvre d’art numérique. Le Gaffiot nous apprend, à l’entrée « fictĭo », que la simulation et la fiction peuvent se redoubler dans la feinte : le faire semblant, pour tromper, est inhérent à la contrefaçon5. Si la définition du dictionnaire sert de tremplin à des analyses sémiotiques, elle révèle ici l’importance de la question de la véridiction, que la sémiotique greimassienne a étudiée de près6. Cependant, dans le cas de l’art numérique – et contrairement aux fake news –, la notion de feintise se révélera finalement peu pertinente et la fiction sera réexaminée sous l’angle de l’authenticité, de l’original/originalité et de la copie selon Nelson Goodman (1990 [1968]). Ce point fera l’objet de la première partie.
Ensuite, la deuxième partie sera consacrée à la notion d’imaginaire, fréquemment associée à celle de fiction. Elle sera approchée à de nouveaux frais à la lumière de la simulation et de la mise en circulation de simulacres. Parlera-t-on d’un hyperréel « sans origine ni réalité », selon Jean Baudrillard (1981). Dans quelle mesure la réflexion gagnera-t-elle à dépasser la notion d’imaginaire au profit de la puissance créatrice du virtuel (Deleuze 1968) ?
Enfin, d’après le Gaffiot, le lexème « fictĭo » signifie aussi « façonnement », « fabrication ».
Dans la troisième partie, la question de la fabrication de l’œuvre d’art numérique sera abordée d’un point de vue plus étroitement sémiotique.
1. L’entre-deux de l’art numérique : une « authenticité paradoxale »
- Note de bas de page 7 :
-
Toute copie n’est pas frauduleuse. Le copieur peut être un faussaire, mais aussi un copiste non plagiaire au sens où peut le laisser entendre l’art antérieur à l’époque moderne, qui est largement collectif (Lenain 2022 ; cf. infra), ou encore un passeur. Les artistes qui, grâce à l’IA générative, font circuler des artefacts numériques dans des réseaux en constituent une variante contemporaine.
Une première conclusion s’impose : le tableau numérique selon Rembrandt n’est pas présenté comme la numérisation d’un vrai Rembrandt, inconnu, que des experts auraient pu déterrer. Il ne s’agit pas de mettre en circulation un faux. Fondamentalement, car du côté des artistes-ingénieurs impliqués dans le processus de sa génération, il n’y a aucune volonté d’induire en erreur : pas de vouloir croire être vrai ce qui ne l’est pas en jouant frauduleusement sur une présomption de « vérité » originelle qui, souvent, est synonyme de l’attribution d’une valeur (également marchande). Si, en production, la fictionnalité de l’œuvre d’art numérique n’est pas de l’ordre de la feintise, le doute peut persister en réception : faut-il croire qu’il s’agit de la numérisation d’un « vrai » Rembrandt ? Néanmoins, grâce aussi à la contextualisation, il y a fort à parier que ce « Rembrandt » n’est pas pris pour un « vrai » Rembrandt. Il n’est pas non plus une copie à l’identique – qui serait numérisée –, d’un Rembrandt existant7.
- Note de bas de page 8 :
-
Pour une discussion, cf. infra et Baetens (1988). On pourra aussi se reporter à Genette (1994).
Déplaçons l’accent : nécessité est de distinguer la version numérisée d’une peinture (fausse ou non, copiée ou non) et l’œuvre d’art numérique native. Dissocié de la feintise, l’art numérique natif ne serait-il donc pas fictionnel ? Ou le serait-il d’une autre manière ? Poursuivons en nous tournant vers Langages de l’art de Goodman (1990 [1968)]). Si l’œuvre autographique s’expose à être copiée et à être évaluée selon les critères du vrai et du faux, l’œuvre allographique autorise des répliques. Prenons le cas de l’œuvre littéraire (régime allographique ; ibid. : 148) : elle est reproductible sans que la taille des caractères, la police, la couleur de l’impression… soient jugées pertinentes. Il faut que l’« identité orthographique » soit garantie. Le texte doit respecter la correction orthographique8. Or, toujours en ce qui concerne le régime allographique, on peut reprocher à Goodman « la méconnaissance du caractère non aléatoire de la matérialité scripturaire du signe » (Baetens 1988 : 196). Précisément, dans le cas de l’artefact numérique, l’inscription sur un support matériel entre de plain-pied dans le processus de la sémiotisation. La notion même de réplique selon Goodman semble disqualifiée, bien que l’image numérique se prête à la reproduction (création de variantes).
Sur le fond de l’opposition goodmanienne, avançons que l’artefact numérique natif est « authentique » non point au sens où, dans le régime autographique, la copie peut justifier l’introduction de l’opposition « vrai vs faux », mais parce que les variantes qu’il appelle en tant qu’artefact éminemment reproductible se caractérisent par la densité syntaxique et sémantique, par la saturation. Tous les éléments doivent être pris en considération, parce qu’ils sont signifiants. Le processus de création est mis en avant. Ce qui veut dire que les reproductions ne sont de l’ordre ni de la copie à l’identique (en art numérique, la diversité est nodale), ni de la réplique pure. D’où l’hypothèse d’une authenticité paradoxale complexe, entre autographie et allographie, dont des traits sont réunis. Elle est à la base de la définition de la fictionnalité de l’œuvre numérique native.
Vérifions donc cette hypothèse en l’opposant, ensuite, à une deuxième : nous verrons en effet que la question de l’authenticité peut être considérée comme non pertinente.
- Note de bas de page 9 :
-
L’image numérique peut également être enregistrée, stockée sur un disque dur ou encore, dans le cas des NFT (non-fungible tokens), sur une blockchain. Elle peut être impliquée dans des échanges dont on garde la trace (manières particulières de conservation). C’est, autant que possible, explorer les possibilités d’une œuvre numérique « unique », non substituable, non modifiable.
Commençons par l’authentification paradoxale complexe. Normalement, l’authentification exige une reconnaissance, sur la base de sources historiques, d’évaluations collectives attestant une origine (voire une originalité ou singularité), au fondement du jugement de fiabilité… (Guillemard 2018). En tant qu’artefact numérique natif (contrairement aux toiles de Rembrandt numérisées dans une base de données), le « Rembrandt » numérique affiche son originalité avec force ; tel quel, pourvu d’un mode d’existence « réel » (avec une « identité » qualitative et numérique propre, au sens où l’entend Genette [1994]), il est authentique. Il est à lui-même sa propre origine. Même s’il est éphémère – il suffit, pour le faire disparaître de l’écran, de changer de page-écran (système de relais comme dans le cas de l’hypertextualité)9.
- Note de bas de page 10 :
-
Cf. des débats nourris autour de la question des archives numériques.
Quand il est question d’un artefact numérique, les notions d’historicité et d’authenticité peuvent être comprises également d’une autre manière. L’historicité est d’abord masquée dans un « présentisme insolent défiant le passage du temps et dans une affirmation faisant fi de la véracité » (Bachimont 2022). Mais Bachimont (ibid.) d’ajouter aussitôt qu’une « diplomatie du numérique » placée sous le signe des digital forensics peut « établir l’authenticité du contenu », ce qui permet de « se fier à ce dernier »10. Si de telles enquêtes sont rendues nécessaires par les fake news, quand les « possibilités de manipulation numérique renforcent les possibilités de falsification et de travestissement » (ibid.), l’art numérique nous invite à poser le problème autrement : le « Rembrandt » numérique natif constitue une version princeps tant qu’il n’est pas manipulé (par exemple, à travers des rotations, l’atténuation des contrastes, des changements chromatiques, etc. [Reyes 2015]).
En ce sens, par rapport aux réénonciations à venir (projection et profilage en direction d’œuvres postérieures), nous avons pu appeler le « Rembrandt » numérique natif une « version princeps ». La mutabilité de l’artefact numérique et l’éventuelle prolifération des variantes numériques sont alors fonction des requêtes sémantiques textuelles (prompts en IA générative), ainsi que de la réinterprétation du code binaire par des programmes et des algorithmes, de la prise en charge par des applications liées à des pratiques (Bachimont 2022) et, enfin, des modalités de l’implémentation et de l’affichage (sur un écran…). Comme pour le régime allographique traditionnel, les variantes respectent une partition (également au sens musical du terme) ou une notation de base, en veillant à l’« identité orthographique ». En même temps, elles autorisent des infléchissements (réinterprétations) qui font sens.
Dans ce cas, comment redéfinir la part fictionnelle d’œuvres d’art numériques telles que le « Rembrandt » numérique natif ? En vertu de la première hypothèse, nous dirons que l’œuvre d’art numérique native est intrinsèquement fictionnelle dans la mesure où elle est (i) paradoxalement authentique, l’artefact ne visant pas à tromper (ni faux ni copie) et faisant valoir toutes ses différences (variantes denses), (ii) réglée sur le principe de l’altérité et (iii) mise en scène (spectacularisation à travers des techniques de visualisation, l’écran (sa taille, la luminosité…) participant à chaque fois à une resémiotisation de l’artefact affiché). Enfin, l’authenticité paradoxale complexe est construite sur une oscillation, voire sur une tension entre la copie et la réplique pures, toutes deux problématisées et niées.
Cependant, une deuxième hypothèse est possible. Comme le rappelle Baetens (1988 : 198) dans Langages de l’art, l’art allographe est dit « unfakable ». Cette qualification pourrait-elle être étendue à l’art autographe et, du coup, serait-ce invalider en partie l’idée de l’authenticité, fût-elle complexe ? Baetens cite Baudrillard (1972 : 115) :
L’œuvre se veut le commentaire perpétuel d’un texte donné, et toutes les copies qui s’en inspirent sont justifiées comme reflet multiplié d’un ordre dont l’original est de toute façon transcendant. Autrement dit, la question de l’authenticité ne se pose pas, et l’œuvre d’art n’est pas menacée par son double. [...] Le faux n’existe pas.
Le commentaire de Baetens (1988 : 198) est éloquent : en renvoyant à l’art antérieur à l’époque moderne, on peut penser l’échange de la copie et de son modèle, l’une et l’autre constituant un « reflet d’un ordre différent ». Tirons-en toutes les conclusions : en vertu de cette hypothèse, la question de l’authenticité (partiellement) est rendue non pertinente.
Authenticité paradoxale, construite sur la mise en tension de traits appartenant aux deux régimes, autographique et allographique, ou dépassement – partiel – de l’opposition « autographie vs allographie » au profit de variantes (i) s’échangeant et se relayant et (ii) construisant des mondes signifiants à chaque fois distincts : on y verra deux manières concurrentes de se saisir de l’œuvre d’art numérique native, de sa reproductibilité et de sa part fictionnelle. L’intérêt réside en partie dans la confrontation de ces deux hypothèses. Significativement, Caliandro (2022) situe le Fake Art « entre le contrefait et le contrefactuel » (nous soulignons). Il se caractérise par une « logique à mi-chemin », voire par un « flottement ».
C’est ce que permet d’observer la série Orogenesis (2002) de Joan Fontcuberta. L’artiste a utilisé un logiciel informatique conçu à l’origine à des fins militaires et scientifiques pour construire des images photoréalistes à partir de données cartographiques. Or, dans cette œuvre, les données ne correspondent pas à des cartes standard, mais à des chefs-d’œuvre de l’histoire de la peinture et de la photographie de paysage des XIXe et XXe siècles, qui sont interprétés par le logiciel d’image de synthèse comme s’il s’agissait de véritables cartes. Fontcurberta se considère comme l’instigateur qui imprime également certaines Orogenèses dans une chambre noire, à l’aide d’un procédé argentique tradition. En même temps, l’autonomie et la marge de manœuvre du système sont réelles. En effet, un style du logiciel a pour effet un certain degré d’uniformisation des paysages créés, tous « grandioses », « sublimes », donnant à voir en trois dimensions des montagnes, des rivières, des nuages et des vallées, quels que soient les peintres et les photographes – Gaspar David Friedrich, André Derain, Salvador Dali, William Turner, Jean-Paul Riopelle, Eugène Atget, Alfred Stieglitz… – convoqués.
Plus précisément, des styles de mélanges (Colas-Blaise 2023a), dont celui de l’hybridation par fusion, font émerger des entités inédites stabilisées. Les images complexes produites par Midjourney AI Art Generator (Manovich 2023) relèveraient, quant à elles, du style du métissage, qui exhibe une divergence (couture) visible entre les éléments qui rappellent Malevich et ceux qui – mais de manière très atténuée, la perspective artistique du XXe siècle s’imposant – renvoient à Bosch :
Figure 1. Image générée par Midjourney, à partir de la requête « Painting by Malevich and Bosch », automne 2022 (Manovich 2023)
Résumons. En quoi un type de fiction particulier émerge-t-il ? Si le discours lexicographique constitue un point de départ précieux, c’est parce qu’il permet de faire ressortir davantage l’originalité de la définition de la fiction numérique. Nous avons vu que celle-ci doit être découplée de l’idée de la feintise. Ainsi, la charge fictionnelle numérique réside dans la mise en avant (spectacularisation) (i) de la variante tendue entre le même et l’autre, (ii) d’une authenticité paradoxale, quand tant la copie que la réplique pure sont niées. Alternativement, elle réside dans un échange de la « copie » et du « modèle » rendant la question de l’authenticité caduque.
Le discours lexicographique suggère également que la fiction constitue une construction imaginaire qui n’a pas de « modèle complet dans la réalité » (CNRTL). Plus sémiotiquement : si cela n’est pas sans nous rappeler que le Fake Art se situe « entre » le « contrefait » et le « contrefactuel » (Caliandro 2022 ; nous soulignons), peut-on généraliser et faire de l’imaginaire une propriété clef des œuvres d’art numériques ? Dans ce cas, faut-il concevoir d’autres types de réel ? Et enfin, en quoi est-ce déclarer peu pertinente l’opposition « vrai vs faux », discutée supra ?
Dans la deuxième partie, nous mobiliserons des cadres théoriques et des approches suffisamment différents pour cultiver la diversité des points de vue et alimenter le débat.
2. La fiction artistique, la simulation et le simulacre
- Note de bas de page 11 :
-
Cf. un emploi spécifique du lexème « simuler » quand est représenté artificiellement le fonctionnement d’un appareil ou d’un système : à des fins d’explication, par exemple, et grâce, notamment, à un programme informatique.
La notion de simulation permet de relancer le débat sur la part fictionnelle de l’art numérique natif approché sous l’angle non seulement de l’opposition « vrai vs faux » – nous avons conclu, supra, que l’art numérique natif ne relève pas d’abord de la simulation-imitation d’une chose « réelle » visant à tromper autrui –, mais encore du couple « réel vs imaginaire »11.
Prenons l’exemple de Unsupervised de Refik Anadol au MoMA (19 novembre 2022-15 avril 2023), une exposition qui recourt à l’intelligence artificielle pour interpréter et transformer des œuvres du MoMA depuis le XVIIIe siècle. Les œuvres d’art se révèlent au spectateur en temps réel, en fonction des variations de lumière, de mouvement, d’acoustique ou encore de météo. L’annonce de l’exposition est particulièrement explicite :
L’IA est souvent utilisée pour classer, traiter et générer des représentations réalistes du monde. En revanche, Unsupervised est visionnaire : il explore la fantaisie, l’hallucination et l’irrationalité, créant une autre compréhension de la création artistique elle-même (nous traduisons).
Figure 2. Refik Anadol, Unsupervised, Museum of Modern Art (MoMA), 2022. Installation View, Courtesy of Refik Anadol Studio
Figure 3. Refik Anadol, Unsupervised, Museum of Modern Art (MoMA), 2022. Installation View, Courtesy of Refik Anadol Studio.
Figure 4. Refik Anadol, Unsupervised, Museum of Modern Art (MoMA), 2022. Installation View, Courtesy of Refik Anadol Studio
Approchons ces œuvres sous l’angle de la « fiction artistique » qui, écrit Schaeffer (2005), déclare son mode de fonctionnement propre et dénonce toute illusion :
[…] une illusion cognitive n’est jamais expérimentée comme fiction mais comme représentation référentiellement validée. À l’inverse, une fiction artistique demande à être reconnue comme fiction pour pouvoir fonctionner correctement. (Ibid.)
La « fiction artistique » constitue alors un type de fiction possible, un des « quatre « attracteurs » discutés dans l’article : l’illusion, proche de l’erreur, la feintise, souvent associée au mensonge, le façonnage, qui mise sur l’invention, et le jeu. Dans le cas de la « fiction artistique », aucune « indexation référentielle » sur le « monde réel » : au contraire, si la fiction est « activée sur le mode de l’immersion », c’est grâce au caractère clos et auto-suffisant d’un « univers virtuel ». D’un point de vue pragmatique attirant l’attention sur la manière dont le spectateur se situe par rapport à l’œuvre d’art, l’immersion ne s’accompagne d’aucune adhésion sur le mode de la « croyance référentielle ».
Il est alors significatif que, dans le cas de la « fiction artistique », la question de la vérité et de la fausseté et celle de la suspension de l’incrédulité soient congédiées, car déclarées non pertinentes.
Quel est l’intérêt, pour nous, d’une approche misant sur l’« étanchéité » de la « mémoire événementielle » par rapport aux « traces mémorielles d’événements vécus imaginairement », ainsi que sur le caractère « endogène » et « endotélique », « autoréférentiel », des représentations numériques qualifiées de fictionnelles (ibid.) ? C’est poser, plus largement, la question de la fictionnalité de tout monde signifiant construit et susciter, d’emblée, une mise en garde : le discours historique, par exemple, ne saurait être considéré comme immédiatement fictionnel (ibid.). Ou, du moins, la définition de la fiction doit-elle être adaptée. Il est d’autant plus intéressant de constater que pour Baudrillard, dans Simulacres et simulation (1981), la « simulation n’est plus celle d’un territoire, d’un être référentiel, d’une substance » : elle est
la génération par les modèles d’un réel sans origine ni réalité : hyperréel. Le territoire ne précède plus la carte, ni ne lui survit. C’est désormais la carte qui précède le territoire – précession des simulacres –, c’est elle qui engendre le territoire […]. (Ibid. : 10)
Trois points retiennent notre attention plus particulièrement, dans la mesure où ils permettent d’engager le dialogue avec les autres cadres théoriques convoqués. Nous verrons que, mutatis mutandis, les réflexions de Schaeffer et de Baudrillard ajoutent toutes les deux au débat l’opposition « vrai vs faux » et la distinction entre le « réel » et l’« imaginaire », les conclusions dussent-elles diverger.
- Note de bas de page 12 :
-
Baudrillard distingue trois types de simulacre : le simulacre de contrefaçon, le simulacre de production industrielle, en relation avec la notion de série, et le simulacre de simulation. Cf. notamment Pascuito (2014).
D’abord, chez Baudrillard, l’hypothèse d’un dépassement des oppositions « vrai vs faux » et « réalité vs imaginaire » trouve une assise théorique. Si « […] feindre, ou dissimuler, laissent intact le principe de réalité : la différence est toujours claire, elle n’est que masquée », la simulation « remet en cause la différence du “vrai” et du “faux”, du “réel” et de l’“imaginaire” ». Parler d’« hyperréel », c’est parler d’un « plus réel que le réel » (ibid. : 10) qui est « à l’abri de l’imaginaire, et de toute distinction du réel et de l’imaginaire » (ibid. : 11-12)12.
Ensuite, si le « réel » est « enveloppé » par l’imaginaire, l’hyperréel constitue un « produit de synthèse, irradiant, de modèles combinatoires dans un hyperespace sans atmosphère ». Tout en évitant les rapprochements indus, qui feraient fi de choix théoriques et épistémologiques spécifiques, osons relire ce passage à la lumière de l’artefact numérique : celui-ci ne se fonde-t-il pas, à sa façon, sur des « matrices et des mémoires », sur des « modèles de commandement » qui autorisent sa reproduction « un nombre indéfini de fois » (ibid. : 11) ? Si l’on adopte ce point de vue – non sans problématiser la notion de reproduction –, sans doute peut-on avancer que, de la même manière que la carte précède le territoire, l’art numérique fait advenir quelque chose de fictionnel.
Résumons. L’œuvre d’art numérique construit un monde signifiant, que l’on qualifie celui-ci d’imaginaire et d’autoréférentiel avec Schaeffer ou que l’on suppose, après Baudrillard, que le réel sans imaginaire produit à partir de « matrices », de « modèles de commandement » et de combinaisons n’est « plus du réel », mais un hyperréel (idem).
Enfin, demandons-nous si les œuvres numériques relèveraient d’« une expérimentation de tous les processus différents de la représentation : diffraction, implosion, démultiplication, enchaînements et déchaînements aléatoires […] bref [d’]une culture de la simulation et de la fascination, et non toujours celle de la production et du sens […] » (ibid. : 99).
Le non-sens guetterait-il ? Y a-t-il dans l’art numérique une prolifération incontrôlée des variantes numériques qui aurait pour effet un effondrement de toutes les valeurs (Bergen 2010) ? Nous choisissons de mettre l’accent sur la créativité computationnelle, sur son pouvoir de renouvellement fictionnel, qui est lui-même régulé, sur les potentialités inhérentes aux artefacts numériques dont l’exploitation est en partie régie par un code. Notre réflexion croise celle de Baudrillard quand ce dernier rapproche l’« hyperréel » de l’« hypotypose » et de la « spécularité » (Baudrillard 1981 : 75). Osons avancer qu’en vertu de l’hypotypose, la réénonciation numérique non seulement met en lumière, rehausse et donne à voir, mais encore insuffle de la vie à des constructions régies par un code, en jouant également sur la sensibilité perceptive.
- Note de bas de page 13 :
-
L’indétermination peut être inhérente au code (Fazi 2018).
- Note de bas de page 14 :
-
Pour Deleuze lui-même, les techniques de formalisation véhiculent du discret et excluent en cela l’intuition et le potentiel vécu de la pensée sensible.
Dans la foulée, adressons à Deleuze, qui introduit la notion de simulacre, une double demande : (i) un réexamen du couple « original vs copie » ; (ii) une mise en avant de la puissance créatrice inhérente au virtuel opposé au possible. Nous cherchons à dépasser l’opposition entre le discontinu du code et le continu sensible en défendant l’idée que l’artefact numérique naît au point de jonction du continu et du discontinu, du flux et du devenir métamorphique, d’une part, et des segmentations/regroupements codiques, d’autre part, c’est-à-dire du qualitatif et du quantitatif13. Il n’est pas anodin que des chercheurs en IA mobilisent les théories de Deleuze pour rendre compte de la continuité d’un processus, au-delà ou à côté du caractère discret du code, et de la mutabilité (devenir métamorphique) de l’artefact numérique. Anna Munster (2006) développe une esthétique, voire une esthésie digitales, en accord avec les notions de perception et de sensation digitales14.
D’abord, le simulacre constitue une « forme supérieure », aux dépens du modèle et de la copie (Deleuze 1968 : 91-93) :
Renverser le platonisme signifie ceci : dénier le primat d’un original sur la copie, d’un modèle sur l’image. Glorifier le règne des simulacres et des reflets. […] Le simulacre a saisi une disparité constituante dans la chose qu’il destitue du rang de modèle. […] La chose est le simulacre même, le simulacre est la forme supérieure […].
Si le simulacre permet de cultiver la différence, c’est parce qu’il
n’est pas une copie dégradée, il recèle une puissance positive qui nie et l’original et la copie, et le modèle et la reproduction. Des deux séries divergentes au moins intériorisées dans le simulacre, aucune ne peut être assignée comme l’original, aucune comme la copie (Deleuze 1969 : 302-303).
- Note de bas de page 15 :
-
Pour une acception technique de « virtuel », cf. l’espace de partage et de collaboration virtuel, les environnements virtuels d’apprentissage, les environnements simulés grâce à des casques de réalité virtuelle. etc.
- Note de bas de page 16 :
-
Cf. Fabbri (2009) et Bertrand (2012) au sujet du simulacre et de la croyance.
Adaptons ces propos à notre cas d’étude : la réénonciation numérique native est fictionnelle en ce qu’elle suppose la différenciation, la variabilité in(dé)finie, dans l’instant, qui recèle selon Deleuze une « puissance positive ». Celle-ci donne son fondement, à côté du code, aux capacités créatrices de la générativité computationnelle. Précisément, ajoutons à la notion de possible celle de virtuel. Si, pour Deleuze, la réalisation du possible n’ajoute rien, le virtuel – le potentiel ou la virtualité (Deleuze 1968 : 237)15 – présuppose un impersonnel afin de faire éclater les états de choses, de créer cet événement qui instille une énergie nouvelle, notamment au profit de forces convergentes et divergentes à la fois canalisées (par le code, le programme, l’algorithme…) et débordant le déjà présent. Nous considérons que, comme tout art, mais de manière plus ostensive et en engageant des passions vives (du plébiscite au rejet), l’art numérique natif met en circulation des simulacres fictionnels co-construits en production et en réception, de manière intersubjective16.
Selon le cadre théorique mobilisé, on peut ainsi considérer les productions signifiantes (i) comme des représentations imaginaires endogènes, le spectateur choisissant de ne pas adhérer sur le mode de la croyance référentielle, (ii) comme des modèles et des combinaisons grâce auxquels la simulation peut « générer » un « hyperréel » et (iii) comme des simulacres dont la « puissance positive » réside dans la négation à la fois de la copie et du modèle. Nous voyons ainsi à quel point les notions d’imaginaire, de simulation et de simulacre, entretissées, permettent de caractériser la part fictionnelle de l’œuvre d’art numérique native plus finement. Tout se joue au niveau des oppositions entre le vrai et le faux, entre le réel et l’imaginaire, entre l’original et la copie.
Dans la dernière partie, nous privilégierons l’angle de la fiction-façonnage ou fabrication, en rendant attentif à la puissance créatrice de la technologie.
3. La fiction-façonnage et le geste technique
Nous l’avons suggéré supra, la génération d’images numériques « artificielles » plus ou moins inédites mobilise des interventions au niveau du codage sous forme binaire (discrétisation), de l’assemblage, de la programmation avec la formulation d’instructions de contrôle, de pratiques liées à des applications et, enfin, de l’affichage interprétant le code.
Poursuivons. En raison, plus particulièrement, de sa dimension collective impersonnelle, la créativité computationnelle est investie dans la construction de « mondes signifiants » : le mode d’existence de la fiction [FIC] selon Latour (2012) devient
probablement, d’un point de vue sémiotique, celui qui ordonne toute instauration d’un monde signifiant, en tant que monde, et en tant que signifiant, justement parce qu’il convoque explicitement la participation active d’un collectif tout entier (Fontanille & Couégnas 2018 : 79).
- Note de bas de page 17 :
-
Cf. l’idée d’une fictionnalité intrinsèque à toute construction sémiotique d’un monde signifiant.
Ainsi peut se vérifier l’idée que le mode [FIC] décrit l’« énonçabilité des mondes, et la possibilité d’instaurer des sémioses à partir des propriétés des mondes » (ibid. : 80)17.
- Note de bas de page 18 :
-
Touchdesigner est un logiciel de programmation nodale, qui peut intégrer de la 2D et de la 3D. Il est capable de créer une interface avec tous les protocoles standards du son et de la lumière (capteurs numériques), pour un contenu multimédia interactif, chaque opérateur se voyant confier une tâche spécifique.
Produire des sémioses en instituant la fiction-façonnage non seulement en condition, mais encore en composante essentielle de la mise en scène, c’est très exactement ce que vise le spectacle multimodal Synaesthesia (Emile V. Schlesser et le trio de jazz Reis-Demuth-Wiltgen, Luxembourg, novembre 2022). Grâce, essentiellement, au langage de programmation visuel TouchDesigner18, développé par la société Derivative (Toronto), il fait assister à la conversion en temps réel de compositions musicales plus ou moins improvisées par le trio de jazz en une profusion d’images projetées sur un rideau séparant la scène de la salle et sur les parois de la salle. L’effet d’immersion provoqué par ce spectacle enchanteur est mis en tension, immédiatement, avec la technicité des gestes qui rendent possible le mappage des fonctionnalités audio et visuelles (visualisation du geste sonore). Il est significatif qu’une toile mi-transparente séparant la scène de la salle joue sur la frontière, son accentuation et son effacement, en érigeant en objet du voir le processus même de la mise en correspondance de la musique et de l’image, avec sa part d’indétermination, d’aléatoire, mais aussi de rigueur dans la programmation.
D’une part, le régime d’authenticité complexe que nous avons voulu définir supra peut nous fournir des critères pour statuer sur les degrés d’esthéticité et d’artisticité des œuvres : ici, des compositions comme champs de forces convergentes et divergentes, mais aussi des formes coulées dans un langage symbolique avec des conventions et des règles, qui s’inscrivent sur le support, se chevauchent, s’entrechoquent, fusionnent, se relayent, se défont :
Figure 5. Emile V. Schlesser et Reis-Demuth-Wiltgen, Synaesthesia, Luxembourg, novembre 2022
- Note de bas de page 19 :
-
Cf. Gabriela Patiño-Lakatos (2018) au sujet de la « valeur » à chaque fois différente attribuée à des gestes largement répétitifs (dextérité apprise, maîtrise).
D’autre part, l’événement, c’est également la performance interactive comme telle, l’orchestration, réinventée à chaque fois, des gestes collaboratifs (chorégraphie collective), avec son volet hautement technique – non seulement les gestes des musiciens, mais encore ceux d’Emile V. Schlesser manipulant des instruments de contrôle tels que des curseurs kob qui permettent de répercuter, en direct, des changements d’intensité, de vitesse… de la musique. Ce qui est visé, c’est l’accord entre organes du corps/gestes et prothèses techniques (contrôleurs gestuels), grâce à une connectivité générale. L’imprévu peut trouver son fondement dans de possibles désaccords (par exemple des désynchronisations)19.
Figure 6. Emile V. Schlesser et Reis-Demuth-Wiltgen, Synaesthesia, Luxembourg, novembre 2022
Figure 7. Une capture d’écran du réseau d’opérateurs (image fournie par Emile V. Schlesser)
L’art numérique peut ainsi être défini comme un art fictionnel qui renforce avec éclat les choix opérés par l’art contemporain : l’attention se détourne (partiellement) de la « chose produite » comme objet esthétique au profit de la « construction de stratégies d’adresse » (Lenain 2022), quand il devient possible et urgent d’étudier la beauté du geste technique (la beauté du code, de la programmation, de l’interaction, etc.), au-delà de la composition interne ou de la gestion chromatique d’un artefact numérique (Colas-Blaise 2023b). Désormais, le « contenu créatif de l’œuvre » (Lenain 2022) réside dans la construction elle-même : dans le façonnage qui est fictionnel et dans l’exhibition des moyens (notamment techniques) mis en œuvre.
Ainsi, quels que soient les styles de mélange, le compositing numérique (Arnaud 2022) peut être au service de la féerie qui subjugue ou maintenir visibles les coutures et appeler au repli réflexif ; il peut attirer l’attention sur la virtuosité des gestes, entre geste machinal et invention. Dans tous les cas, la question barthésienne du « ça-a-été » s’efface devant celle du « ça-peut-être » et la multiplicité des possibles contenus dans l’image-matrice selon Edmond Couchot (1988). Elle perd de sa pertinence devant le « comment » : il s’agit de hisser au rang de l’événement cognitif et sensible, en deçà ou au-delà de l’artefact numérique produit, telles interprétations du code, telle activation des réseaux et nœuds, telles manipulations de l’interface.
Conclusion
Le Fake Art n’est pas l’équivalent de l’Art Fake : ainsi, de la tromperie d’un Wolfgang Beltracchi qui fait croire en l’authenticité de plus de cinquante-cinq « faux », de Max Pechstein à Max Ernst... Au terme de nos investigations, il apparaît qu’aborder l’art numérique natif sous l’angle de la fiction permet d’en préciser les spécificités – d’abord, son « authenticité paradoxale complexe ». Ensuite, sous certaines conditions théoriques, l’artefact numérique natif peut être considéré comme une représentation endogène. À condition d’être pensé sur le modèle de la « carte », il peut également être dit précéder le « territoire ». Souhaitant avoir une vision plus surplombante et cultiver le débat, nous avons consenti à un autre déplacement du point de vue : problématisant la copie et le modèle, nous nous sommes demandé si l’artefact numérique est réglé sur le principe d’une différenciation incessante, à la base du simulacre. Enfin, nous avons voulu approfondir la réflexion sur les conditions de la fabrication/du façonnage d’un monde numérique moins imaginaire qu’autre.
Approcher l’œuvre numérique native sous l’angle de la fiction artistique et de la fiction-façonnage, de la simulation et du simulacre, c’est avant tout mettre l’accent sur la construction de mondes signifiants : sur les potentialités que l’œuvre recèle et sur la génération computationnelle de possibles au croisement du codage et du flux du devenir, du discontinu et du continu, de la discrétisation/assemblage et de la poussée sensible et perceptive, du calcul et du virtuel.
Élargissons la perspective pour finir : l’art numérique fictionnel ainsi caractérisé manifeste-t-il une forme de vie ? Il propose une scénarisation qui invite à la réflexivité. Il donne ainsi un retentissement maximal à l’échange d’énoncés artistiques thématiques, figuratifs et plastiques, auxquels sont attachés des rôles et des passions. Il met en valeur son aptitude à se donner en partage, en manifestant, plus largement, la forme de vie de la connectivité.